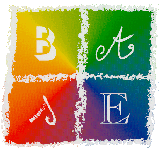- Accueil
- Volume 29 (2025)
- Numéro 4
- Les exploitations agropastorales du Nord-Cameroun confrontées au défi de la valorisation de leurs coproduits végétaux et animaux pour accroitre leur résilience
Visualisation(s): 0 (0 ULiège)
Téléchargement(s): 0 (0 ULiège)
Les exploitations agropastorales du Nord-Cameroun confrontées au défi de la valorisation de leurs coproduits végétaux et animaux pour accroitre leur résilience

Document(s) associé(s)
Version PDF originaleRésumé
Description du sujet. L’intégration agriculture-élevage est l’une des stratégies adoptées par les agropasteurs de la région du Nord-Cameroun pour réduire les risques liés à la pression démographique et aux changements climatiques afin d’améliorer leur productivité.
Objectifs. L’objectif de l’étude est de caractériser les systèmes et pratiques de gestion et de recyclage des coproduits animaux et végétaux dans les exploitations agropastorales du Nord-Cameroun car cela constitue une des clés de l’agro-écologie dans les systèmes agropastoraux.
Méthode. Une enquête approfondie a été réalisée dans 108 exploitations choisies de façon raisonnée. Les données ont été analysées par une analyse multivariée (ACP) suivie d’une classification (CAH).
Résultats. La caractérisation selon la structure des exploitations, les pratiques de gestion des coproduits mises en œuvre et les performances techniques a permis de dégager quatre classes d’exploitations, à savoir la classe des petites exploitations orientées principalement sur les productions végétales (classe 1), la classe des exploitations spécialisées dans l’élevage (classe 2), celle des exploitations de taille moyenne combinant cultures et élevage (classe 3) et enfin celle des grandes exploitations agropastorales (classe 4). En moyenne, les exploitations enregistrent un taux de valorisation des coproduits végétaux de 28 % pour couvrir 25 % de leurs besoins en fourrage (pailles, fanes) et un taux de valorisation des coproduits animaux de 23 % pour couvrir 35 % de leurs besoins en fumure organique (déjections animales).
Conclusions. Cette étude a montré que le recyclage des coproduits dans les exploitations agropastorales est faible mais en voie de progression.
Abstract
Agropastoral farms in northern Cameroon face the challenge of adding value to their plant and animal coproducts in order to increase their resilience
Description of the subject. Agriculture-livestock integration is one of the strategies adopted by agropastoralists in the North Cameroon region to reduce the risks associated with demographic pressure and climate change, in order to improve their productivity.
Objectives. The aim of the study was to characterize the systems and practices for managing and recycling animal and plant co-products on agropastoral farms in northern Cameroon, as this is one of the keys to agroecology in agropastoral systems.
Method. An in-depth survey was conducted on 108 selected farms. The data were analyzed using multivariate analysis (PCA) followed by classification (CAH).
Results. Characterization according to farm structure, co-product management practices and technical performance enabled us to identify four classes of farm, namely small farms mainly focused on crop production (class 1), farms specializing in livestock farming (class 2), medium-sized farms combining crop production and livestock farming (class 3) and very large agro-pastoral farms (class 4). On average, farms used 28% of plant by-products to cover 25% of their fodder requirements (straw, tops), and 23% of animal by-products to cover 35% of their organic manure requirements (animal waste).
Conclusions. This study showed that the recycling of co-products in agro-pastoral farms is low but increasing.
Table des matières
Reçu le 1 octobre 2024, accepté le 26 aout 2025, mis en ligne le 24 septembre 2025.
Cet article est distribué suivant les termes et les conditions de la licence CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)
1. Introduction
1Dans les savanes soudano-sahéliennes de l’Afrique, l’intégration des cultures et de l’élevage est l’une des stratégies adoptées par les agropasteurs pour diversifier leurs sources de revenus. Cette intégration leur permet de s’adapter aux changements climatiques et à l’augmentation des prix des intrants (engrais minéraux, aliments pour le bétail) (Kossoumna, 2008). De plus, les pratiques agricoles extensives et les pratiques d’élevage fondées sur la mobilité sont de plus en plus difficiles à tenir à cause de l’augmentation de la pression foncière (Milleville & Serpentié, 1994). Ces pratiques sont remplacées progressivement par des stratégies d’intensification à moindre coût basées notamment sur l’intégration des cultures et de l’élevage (Vall et al., 2017). Dans le nord du Cameroun, 85 % de la population pratique la polyculture et l’élevage, constituant ainsi la principale activité socio-économique des agropasteurs (Dugué et al., 2021). La pression démographique encourage l’intégration de ces deux activités. Au Nord-Cameroun, la pression foncière ne cesse de progresser et le taux d’occupation agricole des sols, atteignant 70 %, entraine la disparition de la jachère ainsi que les aires de parcours et de réserves forestières (Gonné & Seignobos, 2006). De plus, l’exposition de la région du Nord-Cameroun aux effets du changement climatique augmente les besoins de sécuriser la production agricole et la gestion des ressources naturelles (Donfack et al., 1996). Dans le même contexte, la pratique de la polyculture et de l’élevage dans un même territoire est susceptible d’entrainer une relation de complémentarité positive mais aussi une source de conflits potentiels dus à l’augmentation de la pression humaine. Les règles de gestion traditionnelles ne permettent plus de gérer paisiblement (Lhoste & Richard, 1993 ; Dongmo, 2009 ; Dongmo et al., 2012).
2Afin de s’adapter aux effets du changement climatique, les agropasteurs du Nord-Cameroun valorisent les résidus agricoles en fourrage pendant la saison sèche (Dugué et al., 2013). Plusieurs résidus végétaux délaissés sont de plus en plus valorisés en fourrage (tige de cotonnier, pailles de céréales amandées à l’urée minérale, fanes de légumineuses) et certains agroéleveurs commencent déjà à adopter plusieurs cultures fourragères dans leur système de culture (Brachiaria, sorgho fourrager, niébé fourrager, etc.) (Dugué et al., 2011). Durant la saison pluvieuse, les animaux pâturent les espaces non cultivés comme les jachères et les parcours naturels (Kossoumna Liba’a, 2014).
3Pour renforcer les capacités d’adaptation des agropasteurs, des avancées en matière de recherche et développement sont apparues ainsi qu'une démarche de conseil stratégique individualisé, un renforcement des capacités des producteurs au travers des formations et la promotion des innovations et de la recherche participative (Djamen et al., 2003). Ces avancées ont conduit à la diffusion des pratiques innovantes de valorisation des résidus de cultures, de production de fumure organique et de cultures fourragères (Djamen et al., 2003 ; Dugué et al., 2013). En effet, des améliorations de la valorisation des résidus de récolte ont vu le jour grâce aux différents projets et programmes réalisés par les parties prenantes dans cette partie du pays (Landais & Lhoste, 1990 ; Awono & Havard, 2001 ; Dongmo, 2009 ; Dugué et al., 2021). Bien que ces pratiques soient bénéfiques, elles sont très peu adoptées par les agropasteurs (Dugué et al., 2021). Le contexte sahélien du Cameroun met en évidence une faible valorisation des coproduits animaux et végétaux.
4Les activités agropastorales génèrent pourtant des quantités importantes de coproduits sur les exploitations. Une partie importante des coproduits n’est pas bien récupérée ou dispersée dans la nature ni brûlée, elle est donc négligée, autrement dit globalement perdue pour celles et ceux qui la produisent (Vall et al., 2017 ; Loabé et al., 2020 ; Dugué et al., 2021). Ces coproduits ont une valeur fourragère et fertilisante appréciable ainsi qu’une valeur monétaire qui, si elle n’est pas correctement rentabilisée, conduit à une perte financière conséquente pour l’exploitation (Vall et al., 2017). Ce faible recyclage de biomasse in situ en fourrages, en fumure organique (FO) et en mulch contribue à la baisse de la fertilité des sols et fragilise l’activité d’élevage en saison sèche par manque de ressources fourragères. Il s’avère donc nécessaire de prendre connaissance des différentes pratiques de gestion de coproduits mises en œuvre par les exploitants agropastoraux du Nord-Cameroun afin de déterminer les difficultés qu’ils rencontrent à valoriser efficacement leurs coproduits et envisager une amélioration dans leur mode de gestion des résidus.
5Dans cette perspective, l’objectif de ce travail a été de caractériser les systèmes et les pratiques de gestion de coproduits animaux (cpa) et de coproduits végétaux (cpv) mises en œuvre par les agropasteurs de la région du Nord-Cameroun afin d’évaluer leur niveau de valorisation et de mettre en évidence les obstacles à la sous-valorisation de ces coproduits en fourrage, en fumure et en mulch.
2. Matériel et méthodes
2.1. Présentation de la zone d’étude
6La zone d’étude se situe dans le bassin de la Bénoué, zone d’installation d’agriculteurs migrants et de sédentarisation d’éleveurs depuis la fin des années 1970 (Figure 1). Notre choix a porté sur la région du Nord-Cameroun car il s’agit de la région d’intervention du projet Renforcement des Systèmes d’Innovations Agro sylvo pastoraux (ReSI-NoC) qui a financé cette étude. L’étude a été conduite plus précisément dans la zone fortement peuplée et dégradée autour de Garoua, située dans le bassin de la Bénoué. Dans cette zone, la polyculture et l’élevage sont les principales activités pratiquées (Dugué & Kossoumna, 2010) et génèrent d’importantes quantités de coproduits animaux et végétaux.

Figure 1. Carte de localisation de la zone d’étude — Location map of the study area.
2.2. Matériel
7Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire (Gestion des coproduits animaux et végétaux) digitalisé sur la plateforme Kobo Toolbox en 2023. Les données ont été transcrites automatiquement dans un tableau Excel qui a servi de base de données pour l’analyse. Le questionnaire, composé de questions ouvertes et fermées, était subdivisé en trois parties : la partie identification de l’exploitation centrée sur le profil de l’exploitant et la structure de l’exploitation, la partie production végétale centrée sur les pratiques de mise en culture et le mode de gestion des coproduits végétaux et enfin la partie production animale qui porte sur les pratiques d’élevage et le mode de gestion des coproduits animaux.
2.3. Méthode
8L’étude a été conduite dans quatre arrondissements du département de la Bénoué : Garoua 3è, Ngong, Lagdo et Pitoa, plus précisément dans les villages : Mafa kilda, Mayo Dadi, Israël ; Ngong : Laïnde Massa, Ndjola ; Lagdo : Bamé, Bamsi, Ouro labbo 2 ; Pitoa : Badjouma, Bajengo et Be. La technique d’échantillonnage raisonnée a été utilisée. Le choix de ces localités s’explique par le fait que les agriculteurs et les éleveurs qui y exercent leurs activités sont exposés à la pression démographique, la baisse de la fertilité des sols et sont obligés de diversifier leur source de revenu par la pratique de la polyculture et de l’élevage et à autoproduire leurs fourrages et leurs fertilisants par la combinaison de ces deux activités. Les études précédentes (Dongmo, 2009 ; Vall et al., 2017) avaient montré que toutes les potentialités de cette pratique n’étaient pas exploitées par les agropasteurs de la région du Nord-Cameroun.
9Pour le choix des exploitations à enquêter, deux critères de sélection ont été retenus, la superficie cultivée et le cheptel, en se basant sur les typologies structurelles existantes dans la zone d’étude (Vall et al., 2006 ; Dongmo et al., 2012 ; Sib et al., 2018 ).
10Nous avons collecté deux types de données durant l’année 2023 : les données primaires, qui ont été collectées lors de l’enquête auprès des exploitants agropastoraux (108) et les données secondaires qui proviennent de l’analyse documentaire disponible à la bibliothèque de l’IRAD, au sein de ReSINoC, dans le rapport du projet PASGIRAP et sur Internet. L’enquête sur le terrain s’est déroulée du 3 août au 6 septembre 2023 avec un entretien à passage unique. Dans chaque village, l’introduction a été faite auprès du chef traditionnel ou auprès de son représentant. Ainsi, 10 exploitants (chefs de ménage : principalement des hommes) ont été choisis par localité dans les arrondissements de l’étude pour un total de 108 exploitations. Les données qualitatives et quantitatives recueillies lors de l’enquête ont été analysées. Une analyse multivariée (ACP) suivie d’une classification (CAH) a été réalisée à l’aide du logiciel Excel (2013) associé au logiciel XLSTAT (2020). Le taux de valorisation des coproduits animaux et végétaux et le taux de couverture des besoins des exploitations en fourrage et en fumure ont été déterminés. Le taux de valorisation des cpa en FO (TVcpa) est égal à la quantité de cpa valorisé en FO durant la campagne n+1 rapporté au cpa disponible pendant une année. Elle se calcule selon cette formule :

11avec cpa valorisé = 2 x Quantité totale de FO épandue car lors de la production de FO, environ 50 % de cpa est perdue (volatilisation). Le cpa disponible est estimé en fonction de la taille du cheptel, sachant qu’un UBT produit 1 000 kg de FO par an (Berger, 1996).
12Le taux de valorisation des cpv en fourage (TVcpv) est le rapport entre la quantité de cpv valorisé (consommé) par les animaux en fourrage et le cpv disponible :

3. Résultats
13Pour cette étude, 107 exploitants enquêtés ont fait l’objet d’analyse, l’individu 108 ayant été écarté à cause des valeurs très extrêmes obtenues dans son exploitation (il s’agissait d’une exploitation « hors normes » dirigée par un chef coutumier possédant une grande surface cultivée [250 ha] et ayant accumulé un cheptel très important [54 UBT]).
14La prise en compte de ce dernier rend l’échantillon hétérogène, ce qui justifie l’exclusion de l’analyse factorielle.
3.1. Analyse des systèmes de gestion des coproduits
15Taux de valorisation des cpv et cpa en fourrage, en fumure organique et couverture des besoins. D’après les données d’enquête, 28 % des cpv sont stockés pour servir de fourrage en saison sèche, ce qui montre un faible taux de valorisation. Toutefois, il est intéressant de remarquer que les cpv de qualité (légumineuses) sont privilégiés pour le stockage (30 %) par rapport aux fourrages grossiers (28 %). Les besoins des exploitations en fourrage sont évolutifs en fonction du cheptel (nombre d’UBT) présent et de la quantité de fourrage à distribuer chaque jour par UBT pendant la saison sèche chaude (120 jours) pour satisfaire le besoin du cheptel, qui est fixée à 5 kg MS·UBT·j-1. Les besoins en fumure des parcelles sont évalués en fonction de la superficie cultivée (ha) et de la norme standard de 2 500 kg MS·ha-1 de fumure organique minimum à épandre (Berger, 1996 ; Blanchard et al., 2013). En conclusion, les exploitants enquêtés valorisent 23 % de cpa en fumure organique pour couvrir 35 % de leurs besoins et 28 % de cpv sont valorisés en fourrage pour couvrir 25 % de leurs besoins, ce qui montre une faible adoption de cette pratique par les agropasteurs de la région du Nord-Cameroun.
16Construction de la typologie des exploitations (ACP - CAH). La projection des variables sur le premier plan factoriel de l’ACP (42,77 %) (Figure 2) montre que :
17– un premier groupe de variables (cheptel, naissances de bovins et petits ruminants, ressources de l’exploitation et valeurs des équipements de transport) contribue fortement à la construction de l’axe 1. Ce résultat démontre que plus on se déplace vers la droite de l’axe 1, plus les valeurs des variables énumérées ci-dessus augmentent (plus on est en présence d’exploitations où l’élevage est important ) ;
18– un second groupe de variables (habitat des animaux, équipement de stockage de fourrage, équipement de stockage de fumure organique et surface cultivée) contribue fortement à l’axe 2. Ce résultat renseigne que, plus on va vers le haut de l’axe 2, plus on trouvera des exploitations où les superficies cultivées sont importantes et où l’équipement pour gérer les coproduits végétaux (cpv) et animaux (cpa) est important.

Figure 2. Cercle de corrélation des variables actives de l’ACP — Correlation circle for active PCA variables.
19La CAH a été réalisée sur les coordonnées factorielles des individus issus de l’ACP. Nous avons retenu une classification en quatre classes. La figure 3 présente la projection des individus et des classes 1, 2 et 3 sur le premier plan factoriel de l’ACP. La classe 4, comprenant seulement deux individus, n’est pas représentée sur la figure 3 (elle se situe à l’extrême droite de l’axe 1).

Figure 3. Projection des individus enquêtés et des classes sur le premier plan factoriel de l’ACP — Projection of surveyed individuals and classes on to the first PCA factorial plane.
20Il est intéressant de souligner qu’un certain nombre d’exploitations, malgré leur rattachement à des classes différentes, possèdent tout de même des caractéristiques communes.
3.3. Description des classes d’exploitation
21Le tableau 1 présente les caractéristiques des différentes classes d’exploitations en se basant sur les variables retenues pour l’ACP.

22Les exploitations se répartissent en quatre classes ayant une importance numérique et des caractéristiques bien différentes. Nous proposons de désigner chaque classe d’exploitations par des éléments faisant référence à leur taille (petite, moyenne, grande) et à leur orientation agropastorale principale (polyculture, élevage ou les deux). Ainsi, nous avons distingué : les petites exploitations orientées polyculture (classe 1), les exploitations orientées élevage (classe 2), les exploitations moyennes combinant polyculture et élevage (classe 3) et enfin les très grandes exploitations agropastorales (classe 4).
23Classe 1 : petites exploitations orientées agriculture. Cette classe regroupe la majorité des exploitations enquêtées (64 %). Ce sont des exploitations qui ont un petit troupeau (11 UBT) et qui cultivent une petite surface (5,2 ha). Elles disposent aussi de peu de main-d’œuvre et de peu de moyens de transport. Leur niveau d’équipement en dispositif de stockage de fourrage, de stockage de la fumure organique, d’habitat des animaux est non négligeable.
24Classe 2 : exploitations orientées élevage. Cette classe regroupe 20 % des exploitations enquêtées. Les exploitations se caractérisent par un cheptel important (en moyenne 54 UBT) et une surface cultivée très modeste (en moyenne 2,7 ha). Il s’agit de la plus faible des quatre classes. En réalité, ce sont des exploitations dont l’orientation économique principale est tournée vers l’élevage. Ces exploitations disposent d’une main-d’œuvre légèrement supérieure à la moyenne. En termes d’équipement de stockage des fourrages, en termes d’habitat des animaux et d’équipement de stockage de fumure organique, c’est la classe qui présente les statistiques les plus faibles. Cependant, elle utilise une quantité non négligeable de cpv en fourrage et leur production de fumure organique est assez élevée.
25Classe 3 : exploitations moyenne combinant agriculture et élevage. Cette classe regroupe 14 % des exploitations enquêtées. Ce sont des exploitations de dimension moyenne tant en termes de surface cultivée que de cheptel (11,9 ha et 21 UBT) . Elles disposent d’une main-d’œuvre moyenne (12 personnes actives) et d’un bon niveau d’équipement de transport (846 kF). Ce sont les exploitations les mieux équipées pour le stockage du fourrage, de la fumure organique et pour l’habitat des animaux.
26Classe 4 : très grandes exploitations agropastorales. Cette classe regroupe une minorité d’exploitation (2 % des cas). Elles se caractérisent par une grande surface cultivée et un cheptel très important (19,9 ha et 203 UBT). Elles disposent d’une main-d’œuvre bien supérieure à la moyenne (18 personnes actives). Ce sont les mieux équipées en moyens de transport. Le bétail est conduit de façon plutôt traditionnelle et extensive, si bien que les équipements de stockage de fourrage sont peu importants et l’habitat des animaux plutôt sommaire (parcs). En revanche, ce sont les producteurs les mieux équipés en moyens de stockage de la fumure organique.
4. Discussion
4.1. Diversité des systèmes de gestion et de recyclage des cpa et cpv dans le Nord-Cameroun
27Quatre classes d’exploitation ont été analysées, elles diffèrent par leur structure et par leurs pratiques de gestion des coproduits. La classe 1 des petites exploitations agricoles (superficie ≤ 5,18 ha ; cheptel ≤ 11 UBT avec un nombre d’actifs ≤ 7) représentait la majorité des cas (64 % des exploitations) et la classe 3 des exploitations de taille moyenne (entre 5,18 ha ≤ superficie ≤ 12 ha ; 12 UBT ≤ cheptel ≤ 21 UBT avec un nombre d’actifs ≤ 12) représentait 14 % des cas, soit au total 78 % des cas. Cette proportion d’exploitations de petite taille et de taille moyenne est similaire aux petites exploitations agricoles retrouvées en Côte d’Ivoire avec des superficies < 5 ha (Sib et al., 2018), aux moyennes exploitations retrouvées dans l’Ouest du Burkina Faso (Koumbia, 11,7 ha) (Vall et al., 2006), du Niger (8,8 ha) et du Sénégal (Wassadou, 8,4 ha) (Lhoste et al., 2010). Ces résultats montrent la prédominance des petites et moyennes exploitations dans le Nord-Cameroun tout comme en Afrique de l’Ouest. Grace aux efforts qu’ils déploient dans la valorisation de leurs coproduits, ces exploitations se révèlent comme étant une cible très intéressante pour des travaux de recherche. La classe 4 des très grandes exploitations agropastorales (superficie ≥ 21 ha ; cheptel > 21 UBT et nombre d’actifs > 18) est similaire aussi aux grandes exploitations rencontrées au Sud du Mali (superficie entre 18 et 19 ha ; nombre d’actifs > 12) (Sangaré et al., 2006). Cette dernière est très faiblement représentée dans la région du Nord-Cameroun tout comme dans le Nord de la Côte d’Ivoire (Sib et al., 2018) et la taille importante du cheptel n’est pas très adaptée pour produire efficacement de la fumure organique dans des parcs par l’élevage en stabulation. Enfin, la classe 2 des exploitations orientées élevage (superficie ≤ 2,68 ha ; cheptel ≥ 54 UBT ; nombre d’actifs ≤ 11) avec des effectifs autour de 20 % inclut en majorité des éleveurs peuls sédentarisés similaires à leurs pairs du Burkina Faso cultivant des surfaces mesurant entre 1 et 2 ha (Dongmo, 2009). Ces exploitations orientées élevage demeurent limitées à la pratique d’élevage extensif et donc trouvent peu d’intérêt à valoriser efficacement leurs coproduits.
4.2. Obstacles à la valorisation des cpa et cpv
28De façon générale, les coproduits animaux et végétaux sont sous-valorisés à cause de facteurs internes à l’exploitation et externes (l’environnement dans lequel se trouve l’exploitation).
29Parmi les facteurs internes, nous pouvons mentionner le manque de moyens de transport disponibles dans la grande majorité des exploitations. Les exploitations du Nord-Cameroun sont sous équipées en moyens de transports en traction animale et motorisés, contrairement à d’autres pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal en Afrique de l’Ouest. Zoungrana et al. (2023), dans leur étude réalisée au Burkina Faso, ont bien montré que le niveau de valorisation des coproduits était fortement corrélé au niveau d’équipement en matériel de transport. L’ancrage ethnique contribue aussi à la prise de décision ou au choix des pratiques. En effet, certaines pratiques de gestion des coproduits transmises de génération en génération sont conservées au sein d’une population appartenant à une même ethnie (Tega et al., 2025). Un autre facteur déterminant est le manque de maitrise de la technique de production de la fumure organique de qualité (60 % de cpv et 40 % de cpa) promu par la recherche et un manque de prise de conscience de l’importance d’adopter une telle pratique. Par ailleurs, il est intéressant de souligner le manque de moyens financiers et de main-d’œuvre disponible pour réaliser les tâches relatives au stockage, au transport, à l’entretien des fosses et des tas de compostage. Pour les producteurs, cette valorisation est une charge supplémentaire qui exige des efforts.
30Les facteurs externes sont représentés par la saturation foncière. En effet, le défrichement entraine la diminution progressive des espaces de pâturage et accentue la vaine pâture. Il s’agit d’un obstacle non négligeable qui sévit dans beaucoup de villages enquêtés où vivent les éleveurs sédentarisés (Israël, Ndjola, Ouro labbo 2, etc.). Il devient donc difficile pour les agriculteurs de sécuriser leurs résidus pour le stockage.
5. Conclusions
31Cette étude nous a permis de caractériser les pratiques de gestion et de recyclage des coproduits animaux et végétaux dans les localités du Nord-Cameroun. Une enquête approfondie a été réalisée dans 108 exploitations choisies de façon raisonnée. Les données ont été analysées (analyse multivariée [ACP] suivie d’une classification [CAH]). En moyenne, les exploitations enquêtées ont un taux de valorisation des coproduits végétaux de 28 % qui couvre 25 % de leurs besoins en fourrage (pailles, fanes) et un taux de valorisation des coproduits animaux de 23 % qui couvre 35 % de leurs besoins en fumure organique (déjections animales). Les exploitations se répartissent en quatre classes prenant en compte les caractéristiques structurelles, les pratiques de gestion des coproduits végétaux et animaux, et quelques indicateurs de performances techniques : la classe des petites exploitations orientées vers la polyculture, la classe des moyennes exploitations combinant la polyculture et l’élevage, la classe des très grandes exploitations agropastorales et enfin la classe des exploitations orientées vers l’élevage. Globalement, en raison d’un niveau d’équipement très bas en moyens de transport, en dispositifs de stockage de fourrages et de production de fumure organique, il est nécessaire de constater que les cpv et cpa produits sont finalement très peu valorisés dans toutes les classes d’exploitations. Il existe donc des marges de progression très importantes pour la valorisation des coproduits, à condition que les niveaux d’équipements des exploitations soient sérieusement améliorés. Bien évidemment, d’une classe à l’autre, il est possible d’observer des différences en termes d’équipements et de pratiques de gestion des cpv et cpa, ce qui signifie que les marges de progression ne seront pas les mêmes selon les types d’exploitations. Le conseil pour améliorer ces pratiques devra donc prendre en compte les spécificités des exploitations, des objectifs et des possibilités des producteurs.
32Finalement, les résultats de cette enquête justifient pleinement la suite du travail proposé dans cette étude, à savoir le test d’un outil de bilan/conseil en gestion des cpv et cpa à l’échelle d’une exploitation agropastorale. Dans le contexte du Nord-Cameroun, la marge de progression est très importante pour mieux valoriser à l’échelle de l’exploitation les cpv en fourrages et les cpv et cpa en fumure organique au bénéfice des animaux d’élevage, des sols et des comptes financiers des agropasteurs (réduction des dépenses en engrais et en aliment pour le bétail). Ce travail contribue à dresser un état des lieux de l’intensification des systèmes de production associant l’agriculture et l’élevage et ses impacts socio-économiques et environnementaux. Il sera important d’améliorer la valorisation des coproduits : conscientiser les producteurs sur l’intérêt de stocker les résidus de culture ; renforcer les diffusions des techniques de production de la FO et de compostage ; sensibiliser les producteurs à l’impact de la fertilité des sols, à l’utilisation de la FO, à l’apport de la litière (pailles) pour augmenter la quantité de FO produite et à l’amélioration de l’habitat des animaux. De plus, il sera notamment important de sensibiliser les producteurs aux pertes occasionnées par la pratique du brulage des tiges de cotonniers et à la possibilité d’en faire du mulch, de proposer aux producteurs une technique accessible de compostage des tiges de cotonnier et de prendre en compte les autres facteurs (ethnies, vaine pâture) qui freinent la valorisation des cpa et cpv dans les approches d’accompagnement des exploitations vers une intégration agriculture-élevage réussie.
Bibliographie
Awono B.C. & Havard M., 2001. De la production de fumure organique au conseil à l’élevage dans les exploitations d'agro-éleveurs au Nord-Cameroun. Convention de service N° 03/PH2/DPGT_IRAD. Thème 4 : appui/conseil aux exploitations agricoles. Garoua, Cameroun : Station polyvalente IRAD.
Berger M., 1996. L’amélioration de la fumure organique en Afrique soudano-sahélienne. Agric. Dév., numéro hors-série.
Blanchard M., Vayssieres J., Dugué P. & Vall É., 2013. Local technical knowledge and efficiency of organic fertilizer production in south Mali: diversity of practices. Agroecol. Sustainable Food Syst., 37(6), 672-699, doi.org/10.1080/21683565.2013.775687.
Djamen N.P., Djonnéwa A., Havard M. & Legile A., 2003. Une démarche de conseil stratégique auprès des agriculteurs du Nord-Cameroun. Cah. Agric., 12(6), 393-399.
Donfack P., Seiny Boukar L. & Mbiandoum M., 1996. Les grandes caractéristiques du milieu. In : Actes de l’atelier d’échange agricultures des savanes du Nord Cameroun : vers un développement solidaire des savanes d’Afrique centrale, 25-29 Novembre 1996, Garoua, Cameroun. Montpellier, France : Cirad.
Dongmo A.L., 2009. Territoires, troupeaux et biomasses : enjeux de gestion pour un usage durable des ressources au Nord-Cameroun. Thèse de doctorat : Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement, AgroParisTech (France).
Dongmo A.L. et al., 2012. Du nomadisme à la sédentarisation : l’élevage d’Afrique de l’Ouest et du Centre en quête d’innovation et de durabilité. Rev. Ethnoécologie, 1, 147-161.
Dugué P. & Kossoumna Liba’a N., 2010. Sédentarisation des éleveurs Mbororo et évolution de leurs systèmes de production au Nord Cameroun. Cah. Agric., 19(1), 36-42, doi.org/10.1684/agr.2009.0327
Dugué P., Kossoumna Liba’a N. & Torquebiau E., 2011. Pastoralisme, agriculture et insécurité au nord du Cameroun : quelles marges de manœuvre pour les acteurs locaux ? Grain de sel, 54, 24-26.
Dugué P. et al., 2013. Introduction de Brachiaria ruziensis dans les systèmes de production de la zone des savanes au Cameroun. In : Vall et al. (eds.). Amélioration de la production fourragère en Afrique de l’Ouest : enjeux, acquis et perspectives. CIRAD-RECAO, 91-104.
Dugué P. et al., 2021. Évaluation agro-socioéconomique et environnementale des techniques agroécologiques (agriculture, élevage et foresterie) diffusées dans le cadre du PASGIRAP. Mission d’assistance technique au Programme d’Appui à la Sécurisation et à la Gestion Intégrée des Ressources Agropastorales. Missions à Garoua du 11 au 22 avril 2021 et du 3 au 18 décembre 2020. Montpellier, France : CIRAD.
Gonné B. & Seignobos C., 2006. Nord Cameroun : les tensions foncières s’exacerbent. Grain de sel (Revue inter-Réseaux), 36, 16-18.
Kossoumna Liba’a N., 2008. De la mobilité à la sédentarisation : gestion des ressources naturelles et des territoires par les éleveurs Mbororo du nord Cameroun. Thèse de doctorat en géographie : Université Paul Valéry-Montpellier III (France).
Kossoumna Liba’a N., 2014. Les territoires de mobilité pastorale : quelle mobilité dans un contexte de pression sur le territoire rural en zone soudano-sahélienne du Nord Cameroun ?, https://www.memoireonline.com/02/24/14490/Les-territoires-de-mobilite-pastorale-Quelle-mobilite-dans-un-contexte-de-pression-sur-le-t.html, (22/09/2025).
Landais E. & Lhoste P., 1990. L’association agriculture-élevage en Afrique intertropicale : un mythe techniciste confronté aux réalités du terrain. Cah. Sci. Humaines, 26(1-2), 217-235 (numéro spécial sur les sociétés pastorales).
Lhoste P. & Richard D., 1993. Contribution de l'élevage à la gestion de la fertilité à l'échelle du terroir. Bull. Réseau Érosion, 14, 463-489.
Lhoste P., Havard M. & Vall É., 2010. La traction animale. Versailles, France : Quae ; Wageningen, Pays-Bas : CTA ; Gembloux, Belgique : Presses Agronomiques de Gembloux, 224.
Loabe A.P., Yamndou T.S., Damba R. & Dzeufack A.D., 2020. Évaluation qualitative des espèces fourragères présentes dans le département de la Bénoué (Nord Cameroun). Int. J. Biol. Chem. Sci., 14(4), 1381-1389, doi.org/10.4314/ijbcs.v14i4.17
Milleville P. & Serpantié G., 1994. Intensification et durabilité des systèmes agricoles en Afrique soudano-sahélienne. In : Promotion de systèmes agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne : séminaire régional, Dakar (SEN), 1994/01/10-14. Wageningen, Pays-Bas : CTA, 33-45.
Sangaré M. et al., 2006. Situation et dynamique agropastorale de Dentiola (Mali) : diversité et pratiques. Sikasso, Mali : IER/CRRA.
Sib O. et al., 2018. Intégration agriculture-élevage dans les exploitations agropastorales au Nord de la Côte d’Ivoire. Agron. Afr., 30(1), 57-71.
Tega E. et al., 2025. Évolution des pratiques agricoles endogènes dans les communes rurales du nord du Burkina Faso. Cah. Agric., 34, 6, doi.org/10.1051/cagri/2025005
Vall E, Dugué P. & Blanchard M., 2006. Le tissage des relations agriculture-élevage au fil du coton. Cah. Agric., 15(1), 72-79.
Vall E., Marre-Cast L. & Kamgang HJ., 2017. Chemins d’intensification et durabilité des exploitations de polyculture élevage en Afrique subsaharienne : contribution de l’association agriculture-élevage. Cah. Agric., 26(2), 25006, doi.org/10.1051/cagri/2017011
Zoungrana S.R. et al., 2023. Recycling crop and animal co-products on agropastoral farms for the agroecological transition: more than 60% potentially recoverable in Western Burkina Faso. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 27, 270-283, doi.org/10.25518/1780-4507.20537