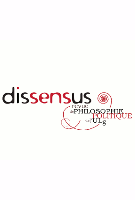Vers une théorie de la révolution non-violente
Manuel Cervera-Marzal est diplômé de Sciences Po Paris et actuellement en Master 2 à l’Université Paris-Diderot (Paris 7). Il rédige un mémoire de recherche sous la direction de M. Etienne Tassin.
Résumé
Le citoyen ordinaire comme le chercheur en sciences sociales associent instinctivement « révolution » et « violence ». Cette évidence demande pourtant à être questionnée. Le fait que, lors des quarante dernières années, cinquante des soixante-sept renversements de régimes autoritaires aient abouti grâce à la résistance civile non-violente impose de redéfinir la notion de révolution en la détachant de celle de violence. En partant des quelques recherches déjà disponibles à ce sujet, mais en s’appuyant surtout sur la philosophie de Martin Luther King, cet article ambitionne de penser une théorie politique de la révolution non-violente : étant entendu que tout ou presque a déjà été dit et expérimenté du côté de la version « violente » de la révolution, une révolution non-violente est-elle historiquement possible, théoriquement concevable et, le cas échéant, quel sens donner à cette notion et quelles sont les caractéristiques de ce phénomène ?
Abstract
The ordinary citizen and the social scientist instinctively associate “violence” and “revolution”. However, this obviousness needs to be questioned. The fact that, during the forty past years, fifty out of sixty-seven reversals of authoritarian regimes are due to nonviolent civil resistance requires redefining the concept of revolution, detaching it from the notion of violence. Starting with some research already available on this subject, but relying primarily on the philosophy of Martin Luther King, this article aims to conceive a political theory of nonviolent revolution : knowing that almost everything has been said and experienced on the “violent” side of revolution, is a nonviolent revolution historically possible, theoretically conceivable and, if so, what is the meaning of this notion and what are the characteristics of this phenomenon ?
1 On peut aborder la question de la « révolution non-violente » d’au moins deux manières. Soit, en mettant l’accent sur le second terme de l’expression, on s’interroge sur la nature « politique » de la non-violence : est-elle réactionnaire (bourgeoise, disait Fanon), réformiste (comme le soutient Rawls) ou révolutionnaire ? Soit, en nous focalisant à l’inverse sur le premier des deux termes, la question devient : étant entendu que tout ou presque a déjà été dit et expérimenté du côté de la version « violente » de la révolution, une révolution non-violente est-elle historiquement possible, théoriquement concevable et, le cas échéant, quel sens donner à cette notion et quelles sont les caractéristiques de ce phénomène ? Tel est le problème que cet article souhaiterait éclaircir.
2 La conception dominante veut que la violence soit un phénomène inhérent à tout processus révolutionnaire1. Charles Tilly inclut la violence dans sa définition de la révolution. Mais avant lui Mao annonçait déjà que cette dernière ne serait pas un dîner de gala. Pour le citoyen ordinaire comme pour le chercheur en sciences sociales, violence et révolution sont indissociables. Leur lien a beau être morganatique, il ne saurait être rompu. Mais cette évidence – comme toute évidence d’ailleurs – doit être questionnée. Alain Rey, linguiste et lexicographe, nous rappelle que si la révolution est histoire, le mot « révolution » a lui aussi son histoire. L’événement de 1789 est le grand repère symbolique qui modifie les conditions de l’emploi de ce vocable et les contenus du signifiant. La Révolution française a significativement contribué à donner au terme de « révolution » la dimension violente, brutale et sanguinaire qu’on lui adjoint généralement aujourd’hui. En Angleterre et en Russie, le déclenchement de la guerre civile en 1643 par les Têtes rondes de Cromwell et le renversement du Tsar en 1917 ont joué le même rôle que 1789 pour les Français. Le caractère historique du lien symbolique entre violence et révolution a pour effet d’ouvrir à la possibilité de rompre cette alliance. Mais, bien plus encore, l’histoire du XXe siècle a donné naissance à une nouvelle forme de révolutions, qualitativement différente du modèle jacobin-bolchévique. Le fait que, lors des quarante dernières années, cinquante des soixante-sept renversements de régimes autoritaires aient abouti grâce à la résistance civile non-violente2 impose de redéfinir la notion de révolution en la détachant de celle de violence. Les chercheurs en science politique – hormis quelques-uns, parmi lesquels Gene Sharp aux États-Unis, Timothy Garton Ash en Angleterre, Etienne Balibar et Hourya Bentouhami en France – n’ont pas encore pris la mesure de cette tâche. C’est sur Martin Luther King lui-même qu’il faut nous focaliser puisqu’il est, à nos yeux, le véritable initiateur de l’idée de « révolution non-violente », comme en témoigne l’ouvrage éponyme traduit en français en 19633. Cependant, avant d’explorer plus en détails la conception kingienne de la révolution et le dispositif conceptuel dans lequel elle s’insère, nous souhaiterions présenter et discuter les élaborations théoriques des quatre chercheurs mentionnés à l’instant. Les contributions scientifiques à la notion de « révolution non-violente » sont trop rares pour que nous nous permettions de ne pas les mentionner.
A) Tour d’horizon des théorisations académiques de la révolution non-violente
1/ Analyse phénoménologique : le modèle anglo-saxon
3 Gene Sharp et Timothy Garton Ash proposent une approche phénoménologique du concept. Elle vise à saisir les critères et à identifier les caractéristiques d’une révolution non-violente. En cela, elle se distingue de l’approche philosophique à la française qui, plutôt qu’une description, cherche à comprendre les conditions philosophiques de la révolution non-violente et la dynamique qui la sous-tend.
4 Gene Sharp, dans un article fondateur daté de 19594, élabore une typologie des différentes formes d’action non-violente et de résistance civile. Son effort de distinction – même s’il révisera plus tard sa typologie – fut salutaire en ce qu’il vint mettre de l’ordre dans la confusion généralisée à propos des formes que peut prendre la « non-violence générique ». Parmi elles, il place, en neuvième et dernière position, la « révolution non-violente ». Elle est selon lui la manifestation historique la plus récente de l’action directe non-violente. Aussi ne s’agit-il pas d’une idéologie ni d’un programme fixé, mais d’une « pensée en développement » et d’une pratique politique encore expérimentale. L’idéologie qui la soutient puise sa source au croisement de trois traditions politiques : une certaine forme de pacifisme telle qu’on la trouve chez Tolstoï et les quakers, la doctrine du satyagraha de Gandhi, et les idéologies de la révolution sociale telles que le socialisme et l’anarchisme. En se fondant sur ce socle théorique, les « révolutionnaires non-violents » cherchent, au niveau pratique, à réaliser des changements sociaux, économiques et politiques radicaux par des moyens qui rejettent à la fois l’action parlementaire et l’emploi de la violence. Cependant fait remarquer Sharp, la nature incomplète du programme et de l’idéologie de la révolution non-violente handicape fortement la diffusion de cette nouvelle forme d’action collective, en particulier dans les pays occidentaux. Cinquante ans plus tard, nous ne pouvons que souscrire à ce constat.
5 De son côté, en conclusion d’un ouvrage collectif ambitieux visant à renouveler le programme de recherche international sur l’action non-violente5, Timothy Garton Ash fait valoir que, depuis 1960, les phénomènes de résistance civile – lors desquels le peuple agit en masse pacifiquement, que ce soit dans la rue, par des grèves, des sit-ins ou d’autres formes de manifestations – ont aidé à redéfinir la révolution dans un sens « non-violent ». Cette multiplication de révolutions sans violence est perceptible dans le champ sémantique des adjectifs qui lui ont été successivement accolés ces dernières décennies : révolution auto-limitée, évolutive, des œillets, de velours, de jasmin, chantante, dansante, rose, orange, négociée, électorale, pacifique, ou même révolution non-révolutionnaire. Selon Ash, ces mobilisations de masses pacifiques mais radicales ont ceci de spécifique qu’elles nouent un rapport complexe et récurrent avec deux autres éléments : les élections et les négociations. Ce n’est pas un hasard, ajoute-t-il, si ce qui est la première de ces nouvelles formes de révolution en Europe, la Révolution des œillets au Portugal en 1974, est tenue pour avoir initié ce que Samuel Huntington appelle la troisième vague de démocratisation. Ces révolutions non-violentes donnent souvent le coup d’envoi de négociations, qui culminent en élections (Pologne 1988-89, Afrique du Sud 1994). A plusieurs reprises la mobilisation de masse s’est donnée pour objectif l’inscription des électeurs (Chili 1988) ou la protection de ce que l’on croit être le véritable résultat d’élections truquées ou « volées » (Serbie 2000, Géorgie 2003). Ce but ne peut alors être atteint que par des négociations, soutenues par l’action de masse, et menant à d’autres élections (Ukraine 2004). Ainsi, conclut Ash, les séquences et les permutations varient, mais les ingrédients restent les mêmes.
6 Cependant, la description de Ash n’est pas exempte de critique. Il nous semble en effet qu’il adopte une définition trop restrictive du phénomène. A le lire, la révolution non-violente désignerait exclusivement le passage d’un régime politique autoritaire à une démocratie libérale parlementaire. Toute révolution non-violente serait une révolution démocratique ou, en termes marxistes, une révolution « bourgeoise ». La réalité est différente. L’action non-violente ne se limite pas à la poursuite d’objectifs libéraux. Au cours de ses recherches, Anders Corr a documenté l’utilisation extensive de l’action non violente dans les luttes pour la terre et pour le logement à travers le tiers-monde et les pays développés. Or la remise en cause de la propriété privée peut difficilement être qualifiée de « libérale-démocratique » ou de « bourgeoise »6. Dans la même veine, le mouvement zapatiste nous semble illustrer la possibilité qu’une révolution non-violente aille plus loin que l’avènement d’une démocratie parlementaire. Le zapatisme promeut une démocratie radicale se rapprochant du modèle conseilliste (mandar obedeciendo, dit leur mot d’ordre, qui s’incarne dans les assemblées communautaires) et une organisation économique fondée sur l’autogestion et le collectivisme (notamment à travers la tradition de l’ejido, gestion communale et collective des terres). En cela la pratique zapatiste s’oppose frontalement à la démocratie représentative mexicaine et au libre marché capitaliste de l’ALENA. Mais si la dimension révolutionnaire du zapatisme est indubitable, la question de son rapport à la violence est autrement plus complexe. Nous l’abordons ici en ayant conscience qu’elle mériterait d’être creusée davantage. Ce n’est pourtant pas le but de notre travail, aussi nous contentons-nous d’ouvrir quelques pistes de réflexion, car l’expérience zapatiste nous semble être un biais privilégié pour qui souhaite aujourd’hui s’atteler à une étude de cas sur les formes de la révolution non-violente. Qu’en est-il, donc, du rapport qu’entretiennent les zapatistes à la violence ?
7 Le 1er janvier 1994, jour d’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) initie une insurrection armée dans l’état du Chiapas, dans l’objectif annoncé de défendre les populations indigènes contre les grands propriétaires terriens et les méfaits de la mondialisation néolibérale. Malgré les douze jours de guerre et la cinquantaine de morts qui ouvrirent l’année 1994, April Carter – dont l’ouvrage bibliographique consacré à la non-violence fait référence – répertorie ce mouvement social parmi les actions non-violentes car, explique-t-elle, il s’est progressivement appuyé sur les méthodes non-violentes7. Carter ne développe pas cette idée. Mais nous y souscrivons car il nous semble en effet que, de 1984 à 2010, le mouvement zapatiste connaît une pacification progressive de ses moyens d’action. Lors d’une première phase (1984-1994) des intellectuels marxistes théorisent une insurrection armée sur le mode exclusivement guévariste de la guérilla. Entre 1994 (soulèvement armée le 1er janvier) et 2001 (adoption de la réforme constitutionnelle par le parlement mexicain) l’on voit émergé, de façon ponctuelle, des actions non-violentes en parallèle de la résistance armée : marche pacifique sur Mexico en 1996, marche des 1111 sur le Zocalo en 1997, proposition de démilitarisation faite au gouvernement. Enfin, depuis 2001, on assiste à une troisième phase de pacification : l’abandon de la lutte armée se traduit par une attention portée vers la mise en place de ce que Gandhi appelait un « programme constructif », durable et étendu. Les communes zapatistes gèrent de manière entièrement autonome de l’État mexicain leurs écoles, leur système de santé, la production agricole, la justice, etc. Le gouvernement zapatiste a fini par évincer le gouvernement officiel des territoires rebelles, et a érigé un modèle de société largement débarrassé des violences structurelles et sociales dont souffrait le Chiapas avant 19948. Par ailleurs, le 20 novembre 2005, l’ancien Front Zapatiste de Libération Nationale est remplacé par un nouveau FZLN dont les principes fondateurs affirment explicitement son caractère « civil et pacifique ».
8 Les causes de cette pacification d’un mouvement révolutionnaire originairement fondé sur l’emploi des armes doivent être interrogées – d’autant que la pacification des zapatistes ne s’accompagne nullement d’une pacification du conflit et de la zone. A nouveau, nous avançons des hypothèses explicatives qui mériteraient d’être approfondies et vérifiées. Nous pouvons supposer que la pacification des zapatistes soit due à la pression de l’opinion publique nationale. En effet, le 12 janvier 1994, pour répondre aux exigences des millions de manifestants qui défilent à Mexico, les zapatistes décident de mettre fin aux onze jours d’affrontements armés avec le gouvernement mexicain. De même, en août 1995, les zapatistes organisent une « consultation nationale pour la paix et la démocratie », où ils invitent 1,3 millions de Mexicains à donner leur avis sur les objectifs et les moyens futurs du mouvement social. L’EZLN, tenant ses promesses, répond aux exigences de cette consultation par une déclaration du 1er janvier 1996. Un second facteur d’explication serait le souci des zapatistes de se présenter à l’opinion publique internationale comme un mouvement pacifique et respectable. Les zapatistes bénéficient en effet de nombreux soutiens (à la fois matériels et symboliques) grâce à leur rôle d’avant-garde du mouvement altermondialiste – mais, pour conserver ces soutiens, il leur faut remplir certaines conditions, dont l’une est de refuser la violence. Depuis qu’ils ont organisé, le 27 juillet 1996, les Rencontres Internationales pour l’Humanité et contre le Néolibéralisme, les zapatistes réunissent à un rythme régulier des rencontres avec les « peuples du monde ».
2/ Compréhension philosophique : le modèle français
9 Etienne Balibar, dans une conférence donnée au Colloque « Marx International » de 2004, suggère que la confrontation de Lénine et Gandhi, les deux plus importants « théoriciens-praticiens » de la révolution, constitue la « rencontre manquée » du XXe siècle. Deux éléments permettent de rassembler sous l’appellation commune de « mouvement révolutionnaire » les mobilisations menées par Lénine en Russie et par Gandhi en Inde. La première de ces caractéristiques est la place accordée aux mouvements de masse, qui se maintinrent sur la longue durée tout en échappant au contrôle et à la discipline des institutions. Ils surent allier spontanéité et organisation en évitant toute forme de récupération par les instances de l’ordre établi. La seconde caractéristique commune est la place accordée à « l’antinomisme », en entendant par là le rapport conflictuel et contradictoire entretenu avec la légalité et le pouvoir étatique. La dictature du prolétariat et la désobéissance civile visent toutes deux à saper les fondements de l’État et à en subvertir les principes constitutionnels. S’élabore alors chez ces deux penseurs un concept du politique qui déborde l’étatique. Ainsi, ce qui fait du gandhisme comme du léninisme les deux grands paradigmes révolutionnaires du XXe siècle se résume dans la formule à résonance negriste : « le pouvoir constitué est reconduit au pouvoir constituant, à l’élément insurrectionnel de la démocratie ».
10 Ayant posé ce point préliminaire – Gandhi et Lénine sont l’archétype de ce que veut dire « être révolutionnaire » –, Balibar entre dans le vif du sujet qui nous préoccupe : d’après lui, il serait simpliste et erroné d’accoler à Gandhi la version « non-violente » de la révolution et de voir chez Lénine le représentant de sa forme « violente ». Ne serait-ce que parce que la décolonisation de l’Inde a abouti à de terribles violences interreligieuses et à la partition du pays alors que le mouvement initié par Lénine s’inscrit dans une « économie de violence généralisée » qui dépasse et précède la simple Révolution d’octobre. En témoigne le mot d’ordre léniniste de « transformation de la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire ». Mais soyons clair, si Balibar refuse de loger l’intégralité de la théorie gandhienne dans la « révolution non-violente » et de cantonner strictement Lénine à la « révolution violente », il reconnaît cependant que ces deux catégories permettent de dresser une typologie pertinente des évènements révolutionnaires modernes. Et c’est effectivement vers Gandhi qu’il faut se tourner pour saisir les conditions philosophiques qui sous-tendent le projet de révolution non-violente. Balibar n’hésite pas à qualifier l’innovation théorique gandhienne – innovation absolument étrangère à la théorie léniniste et à la tradition marxiste dans son ensemble – de « révolution dans la révolution ». Gandhi développe de manière systématique la double idée selon laquelle l’usage de la violence ne fait pas que nuire à celui qui la subit mais altère aussi l’identité de celui qui l’emploie, et le fait que la violence révolutionnaire a un coût humain et social toujours supérieur à ce que l’on peut s’imaginer. De cet avertissement, il tire des leçons stratégiques pour le satyagraha : toute lutte politique non-violente doit respecter un principe d’auto-limitation. Cette exigence remplit deux fonctions. Elle doit permettre d’interrompre la révolution lorsque celle-ci risque soudain de basculer de la non-violence à la violence communautaire ou terroriste. Elle doit par ailleurs laisser un moment d’ouverture à l’adversaire pour lui offrir l’opportunité de transformer son point de vue. Cette pratique dialogique de la lutte est totalement étrangère aux traditions communistes et anarchistes de la révolution.
11 Cette théorisation de la révolution non-violente a beau sembler convaincante, Etienne Balibar avance l’hypothèse de « l’aporie interne » du modèle gandhien (aporie ne voulant pas dire absurdité ni inefficacité). Elle porte sur la modalité de constitution du lien collectif qui rend possible l’émergence d’un sujet politique révolutionnaire. Selon Balibar, le lien moral qui unit les Indiens et fait la force de résistance de la masse réside dans leur amour commun pour la personne du dirigeant. Chaque participant à la lutte se perçoit comme sujet supposé d’un amour quasi-maternel de la part de Gandhi et trouve dans cette promesse affective la force lui permettant d’endurer les sacrifices qu’exige le combat. Balibar n’étaye pas son propos. Il le reconnaît d’entrée de jeu, il s’agit là d’une hypothèse risquée. Mais une des seules études sociologiques réalisées sur la perception de la non-violence par les satyagrahis eux-mêmes9 vient confirmer l’idée de Balibar selon laquelle ces derniers supportaient les inconvénients de la lutte grâce à leur foi en leur leader charismatique. La majorité des participants aux trois satyagrahas de Bardoli, Rajkot et Pardi reconnaît ouvertement que « leur attachement à la personne de Gandhi a joué un rôle prépondérant dans leur foi en l’action non-violente » (et les sacrifices qu’elle impose).
12 En 2009, Hourya Bentouhami, agrégée de philosophie, soutint sa thèse sur la non-violence en partant des théories critiques post-coloniales et des théories de la reconnaissance. Le quatrième chapitre est consacré à la question qui nous intéresse. A l’instar de Balibar, dont elle revendique la paternité et qui participa à son jury de thèse, Bentouhami élabore sa théorie de la révolution non-violente à travers une confrontation entre Gandhi et, non plus Lénine, mais Fanon. A dire vrai, Bentouhami s’intéresse moins à la « révolution non-violente » qu’à la « non-violence révolutionnaire » puisque son entreprise revient à démontrer la possibilité pour la non-violence d’être véritablement une action révolutionnaire10. Mais au-delà de ce chiasme il suffit de constater que ces deux notions recouvrent une même réalité – à savoir la théorie gandhienne, la décolonisation de l’Inde et tous leurs héritiers – pour reconnaître que le travail de Bentouhami traite bien de la révolution non-violente.
13 Partant, elle se propose d’examiner la tension apparente entre les deux modèles révolutionnaires de Gandhi et de Fanon. Alors que tout semble les opposer, Bentouhami insiste sur « ce qu’il y a de commun » entre le projet de la violence révolutionnaire et celui de la non-violence révolutionnaire. Il y a, bien sûr, l’implication dans un mouvement de libération nationale et l’importance accordée à la théorie de l’action. Mais, plus profondément, Gandhi et Fanon se retrouvent au niveau de la fin : l’édification d’un monde commun, la mise en place d’une société non-violente. Concrètement, cette société sans violence serait une société d’amis d’où les causes principales des maux sociaux auraient été éradiquées, notamment la propriété privée et l’État. Philosophiquement, ce monde « à édifier » est celui dont parle Arendt lorsqu’elle explique qu’un véritable monde est celui où existe un espace entre les hommes, des intervalles qui permettent en retour de distinguer les hommes et de les faire entrer dans une sphère de reconnaissance11. On retrouve la poursuite de ce monde dans la violence révolutionnaire de Fanon autant que dans la non-violence révolutionnaire de Gandhi.
14 Cependant, si Gandhi a su reconnaître les vertus de la violence révolutionnaire (qui vaut toujours mieux que la lâcheté), on ne peut en dire autant de Fanon qui, pour sa part, se refuse à admettre chez la non-violence la moindre qualité révolutionnaire. Elle est selon lui passivité et lâcheté voire, pire, une forme hideuse de réformisme bourgeois qui se contente de dénoncer une partie du système qu’il faudrait en réalité mettre à bas dans sa totalité, ce que seule la violence est en mesure de réaliser. Ceci étant dit, Bentouhami précise à raison que Fanon se méprend ici profondément sur la non-violence. La non-violence telle que la prône Gandhi – mais aussi King, Zinn, Muller et d’autres – est incontestablement révolutionnaire (et non réformiste) puisqu’elle vise à éradiquer le mal social de la violence à sa racine.
15 Les critiques de Fanon sont certes infondées, elles n’en sont pas moins compréhensibles. Elles reflètent deux éléments majeurs qui, derrière le projet commun d’édification d’un monde, différencient la non-violence révolutionnaire de la violence révolutionnaire. C’est en premier lieu la question des moyens et des fins. Alors que Gandhi insiste sur leur consubstantialité, au sens où l’on ne peut choisir le mal pour faire le bien, Fanon défend résolument l’idée que la violence peut servir d’instrument pour la justice. Bentouhami identifie une seconde opposition entre non-violence et violence révolutionnaires : alors que la première se fonde sur une politique de l’espoir, la seconde s’appuie sur une politique du désespoir. En effet, explique-t-elle, « le gandhisme est certainement doué d’une espérance plus grande que celle qui habite Fanon, puisqu’à la triple question kantienne à propos de l’homme (que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ? Qu’est-ce que l’homme ?), Gandhi répond qu’il suffit de repenser l’histoire non pas à partir de sa destruction mais à partir de sa survivance comme monde »12. La manifestation éloquente de cette espérance réside dans les mots souvent cités de Gandhi : « Qu’il y ait autant d’hommes vivants dans le monde montre qu’il n’est pas fondé sur la force des armes mais sur celle de la vérité, ou de l’amour. Par conséquent, la preuve la plus positive et la plus incontestable du succès de cette force se trouve dans le fait qu’en dépit des guerres, le monde continue d’exister »13. A l’opposé de cette croyance en la survivance du monde, la politique de Fanon repose sur la crainte de sa disparition.
16 Ainsi, mettre en avant certains aspects de l’histoire plutôt que d’autres déterminerait nos existences et notre comportement face à l’avenir. Considérer le pire incline à la violence. En revanche, insister sur les lieux et les époques qui ont vu tant de gens se conduire avec générosité donne la force de lutter sans violence pour un autre monde14. Nous souhaiterions appuyer cette thèse du lien entre non-violence révolutionnaire et politique de l’espérance en invoquant le cas d’Howard Zinn, militant invétéré de la non-violence, qui – ce n’est pas anodin – intitule la conclusion de son autobiographie : « Des raisons d’espérer »15. Sa philosophie de l’histoire (les bonnes nouvelles sont toujours inattendues) et son analyse du monde contemporain (il y a partout, toujours, des petits groupes d’hommes et de femmes qui luttent en vue de changer le monde) fournissent déjà deux bonnes raisons de « ne pas perdre espoir » et de ne pas croire que ce dont nous sommes témoins dans le présent existera toujours. Gardons-nous cependant d’en déduire trop rapidement que les résistants non-violents le sont du fait de leur optimisme ou de leur foi en l’humanité. Dans bien des cas – la majorité peut-être – ceux qui résistent sans armes face à un adversaire armé le font non par conviction non-violente mais pour la raison très pragmatique qu’ils ne possèdent pas d’armes et n’ont pas les moyens de s’en procurer (c’est souvent le cas des opprimés). Leur non-violence n’est pas volontaire, elle est littéralement employée en désespoir de cause, faute de mieux.
B) Martin Luther King et le pouvoir de l’amour
17 Les recherches sur la non-violence se concentrent principalement sur la personne de Gandhi. C’est qu’il est légitime de reconnaître en lui le père de la non-violence. Mais il ne faudrait pas pour autant en déduire que la pensée de King ne serait qu’une reformulation christianisée du satyagraha gandhien. Comme l’a montré Thomas Weber, on surestime trop souvent l’impact de Gandhi sur King16. En conséquence, la pensée du second a fait l’objet de bien moins d’attention que celle du premier. Il y a en cela une part de justice, car au niveau de la réflexion éthico-politique, King fait preuve de moins d’originalité que Gandhi ; il a d’ailleurs lui-même reconnu l’ampleur de sa dette intellectuelle envers le Mahatma et sa doctrine de la non-violence. Mais la théorie politique de King mérite d’être examinée pour deux raisons. D’une part, parce qu’elle est élaborée dans un contexte autrement différent de celui de l’Inde gandhienne17. D’autre part, parce que King était un brillant théoricien et, aux dires de ses professeurs d’université, un chercheur d’exception. Au moment où l’horreur de l’injustice raciale a croisé son chemin et l’a définitivement voué à l’action militante, le docteur en théologie Martin Luther King se voyait déjà offrir des postes d’enseignant dans les grandes universités américaines. Par ailleurs, on trouve chez lui, plus que chez Thoreau ou Gandhi, un véritable souci de légitimer la désobéissance civile, dont témoigne sa propension à débattre avec ses adversaires ségrégationnistes du bienfondé des actions du mouvement des droits civiques. Rappelons-nous que l’histoire des débats politiques télévisés commence le samedi 26 novembre 1960 sur le plateau de la NBC, où King et l’éditeur ségrégationniste James Kilpatrick s’affrontent concernant la constitutionnalité de la ségrégation et des manifestations des Noirs.
18 Nous nous intéresserons ici à ce qui est selon nous l’élément central de la réflexion politique de King, à savoir la révolution non-violente, le principe d’espérance qui la sous-tend, l’exigence d’amour qui l’anime, et les logiques de consentement et de haine auxquelles elle s’oppose. Mais avant de développer ce que signifie une « révolution animée par l’amour », remarquons que cette innovation théorique produit un tel écart avec la conception traditionnelle de la révolution – qui depuis Netchaiev sépare explicitement l’amour de la révolution18 – que, en conséquence, l’innovation de King risque de rompre toute possibilité de dialogue entre l’ancienne et la nouvelle conception de la révolution. Or cette rupture est indésirable car, tout comme la liberté des Modernes doit rester « comparable »19 à celle des Anciens en vue de les combiner, la révolution non-violente doit maintenir des préoccupations communes à celles de la révolution violente. En effet, dans cette dernière, il ne s’agit pas de tout rejeter. Au contraire, les deux types de révolution partagent un socle commun et, avant toute chose, un même objectif : l’avènement d’une société non-violente, d’un « monde commun ». Expliquons maintenant dans quelle mesure King est effectivement « révolutionnaire » au sens classique du terme. Nous pourrons ensuite nous attarder sur les innovations susmentionnées qu’il apporte à la théorie et la pratique révolutionnaires.
1/ King, la radicalisation inachevée d’un révolutionnaire traditionnel
19 Dans une lettre de jeunesse adressée à sa fiancée, King avoue préférer que le changement social vienne « d’une évolution et non d’une révolution ». Onze ans plus tard, il dénonçait ceux qui pour guérir le pays de la ségrégation ne proposaient que « la vaseline du gradualisme »20. Si l’on s’en tient aux premières années de militantisme du jeune pasteur afro-américain, force est de constater qu’il se réfère davantage à la « réforme », la « Constitution » et « l’État de droit » qu’à la « révolution », la « démocratie économique et sociale » et « l’anticapitalisme ». Pourtant, ces trois derniers mots d’ordre deviendront progressivement ses orientations politiques majeures. La trajectoire politique de King est celle d’une radicalisation permanente. Plus son expérience des luttes grandit, plus il prend ses distances vis-à-vis de l’État et du mode de production capitaliste. En 1963, suite aux difficultés rencontrées lors du mouvement de Birmingham, il tire le constat que « le moment est venu d’aller plus loin dans la réflexion et dans l’action »21. King substitue progressivement au combat ponctuel et aux revendications timorées la mise en œuvre une action collective visant à subvertir le système jusque dans ses racines les plus profondes. En 1967, en pleine préparation de la Marche des pauvres – que son principal biographe Stephen B. Oates qualifie de « mouvement de classe à coloration révolutionnaire » –, King confie à ses associés : « Pendant des années, j’ai œuvré dans l’idée de transformer les institutions existantes dans le Sud: un petit changement par-ci, un petit changement par-là. Maintenant, je ressens les choses tout autrement. Je pense qu’il faut reconstruire toute la société, qu’il faut un renversement total des valeurs » et qu’il faut « affronter les fondements économiques du système » capitaliste22 puisque ce dernier, générateur d’inégalités, de misère, d’impérialisme et de matérialisme, est incapable de saisir l’essence sociale de la vie humaine.
20 Dans un éditorial d’avril 1967 intitulé « L’erreur du docteur King », le New York Times décréta que le Vietnam et la cause de l’égalité des Noirs étaient deux problèmes « distincts et séparés » et reprocha à King de les mêler « trop facilement », « ce qui desservait l’une et l’autre cause et, loin d’apporter des solutions, ne faisait qu’accroître la confusion »23. Mais, conscient des causes profondes des maux sociaux, King se rallie à la stratégie révolutionnaire de la convergence des luttes. Il savait en effet que le racisme servait les plus riches au détriment des plus pauvres, que la ségrégation interne aux États-Unis n’était que l’envers de l’impérialisme américain et que donc le mouvement des droits civiques se devait d’être solidaire des luttes anticolonialistes du Vietnam et d’Afrique, que l’exploitation économique et le chômage touchaient autant les Blancs que les Noirs, que la guerre était un phénomène de classes, bref, que toutes les formes d’oppression étaient intimement liées et qu’en conséquence la question de l’unité des luttes et des travailleurs était cruciale pour leur victoire. Il y avait entre ces problèmes une « relation manifeste, des plus faciles à percevoir »24.
21 Mais le caractère révolutionnaire du mouvement des droits civiques et des idées de King ne semble pas admis par tout le monde. Aux États-Unis, plusieurs théoriciens de la désobéissance civile considèrent que l’usage de la persuasion morale plutôt que de l’insurrection violente et la soumission de King à la peine juridique traduisent son acceptation du régime politique en vigueur, son respect de l’autorité légale et sa reconnaissance de l’existence d’une obligation morale à se conformer aux lois25. D’après nous, ils imputent ainsi à King des idées qui ne sont pas les siennes et ils dressent un portrait historiquement erroné de son action. Chez King, l’acceptation de la peine répond à des choix stratégiques et nullement à un principe éthique. Par ailleurs, son engagement dans des méthodes non-violentes ne manifestait pas son respect du système établi. La radicalité n’est pas pour lui synonyme de violence. Cette dernière au contraire détourne l’attention des vrais problèmes, délégitime le mouvement et finit par nuire à l’amélioration de la situation des Noirs. Comment comprendre alors que certains aient pu faire de King le promoteur de réformes modestes plutôt que d’un changement radical ? Outre un probable aveuglement idéologique par lequel ces penseurs attribuent au pasteur américain leurs propres idées, il se peut qu’en se focalisant sur les premières années du militantisme de King – celles qui précèdent sa radicalisation – ils aient obtenu une image faussée de son positionnement politique.
22 Une révolution ne saurait se dérouler selon un plan soigneusement préétabli. Il serait absurde de vouloir transformer – au sens propre de donner une nouvelle forme – le social à partir d’un idéal déjà finalisé. On n’élabore pas en pensée un nouveau modèle de société que l’on s’applique ensuite à réaliser dans et par la pratique. Car, et l’on peut supposer que King souscrirait ici aux mots de Castoriadis, « l’idée centrale de la révolution, c’est que l’humanité a devant elle un vrai avenir, et que cet avenir n’est pas seulement à penser, mais à faire »26. Une révolution ne se règle pas comme un ballet. Action créatrice et réflexion théorique avancent d’un même pas, s’alimentant l’une l’autre. Et la révolution de King, à l’instar de l’autonomie de Castoriadis, n’est pas une fin en soi. Au contraire d’Arendt, pour qui l’action politique est à elle-même sa propre finalité, la révolution et l’autonomie font advenir un Autre. Mais quel Autre ? Pour les Grecs, répond Castoriadis, « il s’agit de la création d’êtres humains vivant avec la beauté, vivant avec la sagesse, et aimant le bien commun »27. King, lui, appelle « pouvoir neuf » ce que la révolution est censée rendre possible.
23 Qu’est-ce que ce pouvoir neuf dont King fait la finalité de l’action révolutionnaire ? Selon lui, l’origine des maux sociaux dénoncés plus haut « vient de ce qu’en Amérique [le pouvoir] est inégalement distribué »28. King se soucie ici moins du pouvoir économique que du pouvoir politique, par lequel il désigne le « droit de vote » et l’accès à une citoyenneté normale dont, par des mesures discriminatoires de toutes sortes, 90% des Noirs du Sud étaient privés. Or, King cite Cicéron qui remarquait à raison qu’« être libre, c’est participer au pouvoir ». Sans un « pouvoir neuf », c’est-à-dire équitablement réparti entre nations, groupes et personnes, il est donc impossible de résoudre les problèmes sociaux (le racisme bien sûr, mais aussi la pauvreté et l’impérialisme).
24 Mais King prévient deux fausses pistes. Tout d’abord, s’il est légitime et nécessaire que les Noirs américains participent enfin au pouvoir, cela ne signifie pas qu’ils doivent s’en emparer dans sa totalité. En effet, un pouvoir exclusivement noir n’est pas plus une garantie contre l’injustice qu’un pouvoir exclusivement blanc. Une telle situation ne saurait aboutir qu’à une oppression raciale inversée. Deuxièmement, les Noirs doivent faire attention à ne pas être dupés par ce que King appelle le « tokenisme », qui consiste à intégrer quelques Noirs aux élites blanches. En réalité, selon King, la diversification de l’élite permet de masquer et de maintenir les inégalités au sein du reste de la société. La volonté des Blancs d’exhiber quelques exemples de réussite personnelle de Noirs n’est qu’un « trompe-l’œil destiné à masquer la réalité persistante de la ségrégation et de la discrimination »29. Au sein de la pyramide du pouvoir, le mouvement des droits civiques ne vise pas la diversité au sommet mais l’égalité à la base.
25 Contrairement à une « révolte », qui ne touche que les hommes, une révolution est donc un mouvement qui transforme les hommes et les institutions, puisqu’elle procède à rien moins qu’une redistribution intégrale du pouvoir, selon la logique du « pouvoir neuf ». Mais si nous avons dit que le changement ne se fait pas selon un programme préétabli, il n’en résulte pas moins que pour King une révolution victorieuse ne peut faire l’économie d’une méthodologie adaptée aux circonstances. Il s’agit pour lui de la méthode non-violente. En adaptant la pratique révolutionnaire traditionnelle à la philosophie gandhienne de la non-violence, King opère un changement de paradigme philosophico-politique que nous souhaitons maintenant aborder.
2/ Pour une révolution non-violente
26 Nous adoptons la proposition « pour » car, en même temps que King théorise la révolution non-violente, il travaille ardemment à la légitimer. Élevé dans le christianisme, converti adolescent à la non-violence et adulte à la révolution, sa pensée se tient au croisement de ces trois traditions a priori bien distinctes. De leur articulation, King déduit deux idées : que l’amour peut être un puissant instrument de transformation sociale ; et que la traduction politique de l’agapè est la révolution non-violente, fondée sur l’espérance.
27 A la dichotomie habituelle qui prétend que sous le joug de leurs maîtres les opprimés n’ont le choix qu’entre la soumission et la révolte, King substitue la trichotomie soumission, révolution violente, révolution non-violente. Mais attention, la distinction entre révolutions violente et non-violente n’est pas de second ordre. Autrement dit, le couple soumission/révolte est définitivement invalidé, politiquement et épistémologiquement.
28 La première réaction des opprimés à l’oppression est donc l’acceptation. Ils se résignent au sort qui leur est fait, supportent sans broncher la situation, s’y adaptent et, parfois, finissent par s’en satisfaire. Tout mouvement d’émancipation connaît ses opprimés qui préfèrent le rester, ne serait-ce que parce qu’on désire rarement ce qu’on ne connaît pas : la liberté. Mais aux dires de King, la soumission n’est pas la solution ; ou plutôt, elle est la solution des lâches. Car, accepter passivement un système injuste, c’est en fait collaborer avec lui. Celui qui ignore le mal s’en fait complice. En effet la force réelle de la ségrégation est qu’elle bénéficie de la tolérance de la majorité dite silencieuse. L’émotion, face à la violence, est légitime, mais elle n’est pas suffisante. Pour ne pas qu’elle s’estompe et se transmue en résignation et en accommodation, l’émotion doit rapidement devenir action. Il s’agit d’une obligation morale, sans laquelle l’opprimé devient autant pêcheur que l’oppresseur, puisque accepter passivement l’injustice, c’est signifier discrètement mais clairement à l’oppresseur que ses actes sont moralement bons.
29 La seconde réponse à l’oppression revient à réagir par la violence physique et la haine. C’est l’attitude au fondement des révolutions violentes, qui n’obtiennent que des résultats éphémères, mais n’apportent jamais de paix durable et ne résolvent aucun des problèmes sociaux. Au contraire, elle ne fait qu’en produire de nouveaux, plus profonds que les premiers. Selon King, la violence révolutionnaire est aussi inefficace qu’immorale. Inefficace car elle engendre une spirale de violence conduisant à l’anéantissement général. Si régnait la loi du talion, le monde serait rapidement peuplé d’aveugles. Immorale car elle veut humilier l’adversaire et non le convaincre, l’anéantir et non le convertir. Reposant sur une telle haine d’autrui, elle rend impossible toute fraternité humaine. La solution est donc à chercher ailleurs. Elle réside, pour King, dans l’action directe non-violente.
30 Tirant leçon de la synthèse hégélienne, la révolution non-violente refuse l’immoralité de l’acceptation et de la violence, mais cherche à concilier ce qu’il y a de vrai dans chacune d’entre elles. « Le résistant non-violent reconnaît, comme ceux qui se résignent, qu’il ne faut pas attaquer physiquement l’adversaire ; inversement, il reconnaît, avec les violents, qu’il faut résister au mal »30. Les groupes et les individus employant la méthode non-violente s’abstiennent grâce à elle de se résigner au mal et de recourir à la violence. A l’exact opposé du consentement et de la haine, King fait valoir l’amour, comme principe de la révolution non-violente.
31 Mais l’amour peut-il avoir un sens politique ? Depuis que Gunther Anders a fait du « mignon » une catégorie politique, on a du mal à voir ce qui ne pourrait pas constituer une notion politique. Et si la théologie politique a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse, c’est davantage en mobilisant le droit naturel, la souveraineté divine et le rapport entre cités céleste et terrestre qu’en s’adonnant à des réflexions sur l’amour proprement dit. Ce dernier n’a a priori jamais été constitué comme objet de philosophie politique. Mais Martin Luther King nous semble justement poser les prémisses d’une théorie politique de l’amour.
32 King s’élève contre ceux, nombreux, qui jugent que l’amour – au sens d’agapè – et le pouvoir s’opposent, se contredisent. Ceux-là identifient « l’amour à une démission du pouvoir et le pouvoir à un déni de l’amour »31. King attaque Nietzsche, d’une part, qui parce qu’il glorifiait la « volonté de puissance » a cru devoir rejeter le concept chrétien d’amour32. Il attaque les Églises chrétiennes, d’autre part, qui au nom de l’amour ont refusé tout engagement dans les affaires temporelles et se sont cantonnées à la quête de l’au-delà. Or, pour King, l’Évangile chrétien est social, autant que spirituel. L’amour appelle l’engagement politique : « une religion qui prétend avoir le souci des âmes, mais qui se désintéresse d’une situation économique et sociale qui peut les blesser, est une religion spirituellement moribonde, condamnée à disparaître »33. Contre cette disjonction indue, King ne dit pas que l’amour et le pouvoir peuvent aller de pair, mais qu’ils le doivent. Désirer le pouvoir sans éprouver d’amour est téméraire et abusif, et un amour impuissant ne témoigne que d’une sorte de sentimentalité falote. Ainsi, le véritable amour désire le pouvoir, non pour lui-même, mais en tant que moyen permettant d’accomplir la justice.
33 King, en réconciliant amour et pouvoir, résout indirectement la dialectique de l’amour et de la justice. En quoi consiste cette dialectique, cette « impossible synthèse »34 ? Luc Boltanski, dans L’amour et la justice comme compétences, a brillamment décrit l’incompréhension et le désarroi résultant de la rencontre entre une personne en régime de justice et une autre en régime d’amour. Tandis que celui qui est en régime d’agapè donne gratuitement sans se préoccuper de recevoir en retour, puis oublie, celui qui est dans la justice interprète ce don dans la logique du don/contre-don, et s’efforce de satisfaire à la règle qui prévaut dans ce cas (respect du délai, choix d’un objet différent mais de valeur équivalente)35. Paul Ricœur insiste lui aussi sur l’alternative « amour ou justice » davantage que sur l’articulation « amour et justice »36. La pratique individuelle de l’amour du prochain et l’exercice collectif de la justice garante d’équité s’inscrivent dans deux univers éthiques incompatibles. D’un côté prévaut la logique du don sans attente de retour, de l’autre prévaut la stricte équivalence dans distribution des biens et des charges, des droits et des devoirs. Ricœur ne cherche à aucun moment à nier l’incompatibilité entre le langage de la surabondance et celui de l’équivalence et la réciprocité attendues. Il convient au contraire de saisir le potentiel émancipateur de ce conflit des deux logiques. La négation d’un des deux pôles entraîne inévitablement des effets pernicieux. Le pur amour risque de glisser vers l’immoralité, tandis que la seule logique de l’échange porte en germe une dérive utilitariste. La philosophie kingienne offre une tentative de conciliation. King, en élaborant une théorie politique de l’amour, donne à ce dernier la dimension collective et publique permettant d’envisager sa réconciliation avec la notion de justice. Le politique constituerait ainsi la passerelle – jusqu’ici introuvable – susceptible de combiner enfin justice et agapè.
34 Lorsque King parle du pouvoir qu’a l’amour de réaliser des améliorations sociales, il s’agit de l’amour chrétien au sens d’agapè, non d’éros et/ou de philia. De même, lorsque King et Gandhi élèvent l’amour au-delà des relations entre individus et affirment que les maximes « tendez l’autre joue » et « aimez votre ennemi » valent entre groupes et nations, il s’agit aussi de l’amour en tant qu’agapè, qui signifie compréhension, bonne volonté envers les hommes, amour désintéressé de l’humanité. Il serait en effet absurde de demander aux hommes d’aimer leur adversaire comme ils aiment leur femme ou leurs amis (philia), ou d’éprouver pour eux du désir (éros).
35 Ayant ainsi fait de l’amour un concept politique – ce qui n’empêche pas qu’il reste aussi bien sûr un concept théologique –, King est en mesure d’en donner les implications politiques. Il ne s’agit pas pour l’amour de prôner l’irénisme, l’idéalisme, de nier l’histoire et de récuser les conflits. Il se met au contraire au service de la lutte puisque King n’hésite pas à en faire le fondement de la révolution non-violente. S’opposant à la haine et la violence physique, l’amour anime la révolution non-violente comme pour Montesquieu la vertu anime la république et l’honneur la monarchie. Elle est « ce qui la fait agir », son principe, c’est-à-dire la passion humaine fondamentale qui se répand dans la conscience et le cœur des résistants non-violents, qui structure leurs attitudes et leurs comportements politiques. L’amour est aussi le principe qui, une fois la révolution terminée, caractérise le « pouvoir neuf », la société non-violente. Elle facilite son avènement, son existence et son maintien.
36 Étroitement liée à l’amour, l’espérance constitue le second fondement de la révolution non-violente. Nous disions plus haut que Gandhi s’oppose à la crainte fanonienne de disparition de l’homme, lui préférant une politique de l’espoir, entendue comme croyance en la survivance du monde. Mais contrairement à Gandhi, qui n’a pas théorisé son opposition au désespoir, King s’en fait le fervent pourfendeur. Aux révolutions anciennes, c’est-à-dire fondées à la fois sur l’espoir – de voir poindre à l’horizon la liberté et la justice – et sur la haine – des responsables de l’ancien régime – la décolonisation de l’Inde et le mouvement des droits civiques ont substitué un nouveau modèle révolutionnaire, fondé uniquement sur l’espérance en un monde meilleur. Évacuée, donc, la haine et ses effets destructeurs. Le désespoir initial est transformé en une énergie féconde, celle de la non-violence. Mais comme nous l’avons dit plus haut, la révolution n’est pas chez King un but en soi. Si elle ne parvient pas à obtenir les objectifs fixés, l’espérance disparaît et la haine se concentre sur ceux qui l’avaient fait naître. Le paradoxe de la révolution est le suivant : son feu s’attise de la flamme de l’espérance, mais si les espoirs ne sont pas rapidement satisfaits, ils laissent place au désespoir, qui conduit à la colère, la violence et la perte de la révolution puisque dans l’esprit de King « plus il y a de violence, moins il y a de révolution ». Pour sortir de cette impasse, il faut apprendre à distinguer la déception du désespoir. Les échecs sont toujours possibles. Lorsqu’ils surviennent, ils doivent être acceptés et vécus comme une déception momentanée qui n’altère pas l’espoir persistant au-delà du temps présent. Par-delà la contingence des vents du triomphe et du succès – qui peuvent à certains moments nous être favorables tandis qu’à d’autres ils nous seront durement contraires –, il faut maintenir au fond de soi un courage d’être. Il ne s’agit pas de nier échecs et déceptions, mais de maintenir, envers et contre tout, l’espérance qui permet d’avancer sans violence. « Tel est le sens des instants où l’on revient à soi, écrit Karl Jaspers : ils inspirent une attitude fondamentale qui persiste derrière tous les états affectifs et tous les mouvements de la journée, qui vous lie, et qui jusque dans les égarements, la confusion, les mouvements passionnés, empêche que l’on sombre tout à fait »37. Par-delà la déception, l’espérance. Ce leitmotiv est au fondement de la conception kingienne de la révolution non-violente.
En guise de conclusion : foi et révolution
37 Nous savons désormais qu’amour et espérance sont selon King les deux piliers d’une révolution non-violente. Mais l’expérience nous apprend qu’un corps physique trouve plus facilement son équilibre sur trois points d’appui que sur deux. Or, amour et espérance, si on y ajoute la foi, ne forment-elles pas les trois vertus théologales ? Lorsqu’on connaît l’influence du christianisme sur la pensée de King, on est tenté de prolonger sa réflexion en étudiant la relation entre foi et révolution. Le nombre de références religieuses dans les ouvrages de ce que Razmig Keucheyan appelle les « nouvelles pensées critiques » est édifiant38. C’est le cas par exemple de l’ouvrage d’Alain Badiou consacré à saint Paul39, ou de celui de Zizek sur le « fragile absolu », sous-titré Pourquoi l’héritage chrétien vaut-il d’être défendu ?40 On connaît aussi l’influence de Pascal sur Agamben ou Bensaïd qui, dans Le Pari mélancolique41, dresse l’analogie entre l’engagement révolutionnaire et le pari pascalien. Pour Keucheyan, le rapport des pensées critiques contemporaines à la religion est loin d’être anecdotique. Il a trait à un problème spécifique, celui de la croyance. La question soulevée par Paul ou Pascal est de savoir comment continuer à croire lorsque tout semble aller à l’encontre de la croyance, lorsque les circonstances lui sont radicalement hostiles. L’échec presque systématique de l’ensemble des expériences socialistes du XXe siècle rend cette question parfaitement légitime. « Comment continuer à croire en la faisabilité du socialisme alors que les faits ont brutalement et à de nombreuses reprises invalidé cette idée ? » Selon Keucheyan la théologie, dont la spécialité est de croire en l’inexistant, offre bien des ressources à ce problème. Lorsque le démenti empirique invalide une fois pour toutes le déterminisme historique d’un certain marxisme orthodoxe, les tenants de la révolution se tournent logiquement vers la question de la foi42.
38 Si l’on en revient à la question de la révolution proprement non-violente, il semblerait alors que la foi exigée soit inversement proportionnelle à l’efficacité qu’on attribue à la méthode non-violente. Autrement dit, l’adhésion à l’impératif éthique non-violent doit être d’autant plus ferme que l’on considère la non-violence comme une stratégie politique peu efficace. La confession de Jacques Ellul confirme cette logique de vases communicants : « Par conviction spirituelle, je ne suis pas seulement non-violent mais je suis pour la non-puissance. Ce n’est sûrement pas une technique efficace. [...] Mais c’est ici qu’intervient pour moi la foi. [...] On ne peut pas créer une société juste avec des moyens injustes. On ne peut pas créer une société libre avec des moyens d’esclaves. C’est pour moi le centre de ma pensée »43. Pour Ellul, l’engagement non-violent résulte très clairement d’une croyance de nature quasi-religieuse, et non d’un choix pragmatique. L’élément spirituel prime sur les considérations d’ordre utilitariste. L’opposition kantienne du savoir – suffisant subjectivement et objectivement – et du croire – suffisant subjectivement mais insuffisant objectivement44 – prend alors tout son sens. Les révolutionnaires ne sachant pas si la non-violence portera des fruits optent malgré tout pour elle à cause de leur foi en sa validité morale et de leur croyance en sa possible efficacité – croyance qui n’est donc pas un savoir. La foi en la non-violence se déploie ainsi selon deux axes : foi en sa validité morale, qui ne va de soi, puisqu’il existe de nombreux arguments en faveur de la légitimité éthique de la violence révolutionnaire ; et foi en sa possible victoire, car ne pas savoir que la violence est efficace n’empêche pas d’espérer qu’elle le sera. Cette double disposition gnoséologique se donne à voir dans l’étude sociologique des satyagrahas de Rajkot, Pardi et Bardoli mentionnée plus haut. Les témoignages des participants recueillis par Amrut Nakhre révèlent en effet que la majorité d’entre eux (84%) définit la non-violence comme une « foi », davantage que comme une « tactique » (13%).