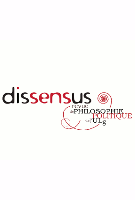L’argot dans les discours hugolien et célinien. Une lecture symptômale des apories du concept de fraternité.
Ancienne étudiante Erasmus Mundus Europhilosophie, Oriane Petteni prépare un projet de thèse en philosophie politique, sur les questions de la souveraineté, de la territorialité et du droit à partir de Hegel, Schmitt et Deleuze. Publications : « Le nomadisme et l’État. Un cas d’application à l’aire géographique "Turquie, turcs, turcophones" », dans V. Milisavljevic & G. Sibertin-Blanc (éd.), Violence, État et institution chez Gilles Deleuze, Belgrade, Institut de Philosophie et de Théorie Sociale / Toulouse, Éditions Europhilosophie, 2012. À paraître : « Le Narrateur kafkaïen ou la conscience malheureuse prisonnière en régime hégélien. L’exemple du Terrier », Philosophy and society (Belgrade), « The dialectic of Aesthetics and Politics in Hegel’s Philosophy ».
1Dans cet article, nous aimerions aborder la question d’un phénomène déconcertant conceptuellement, l’argot, qui présente aux théoriciens linguistiques de redoutables problèmes de définition. Ainsi le Littré qualifie-t-il l’argot de « langage particulier aux vagabonds, aux mendiants, aux voleurs et intelligible pour eux seuls ». L’argot se présente donc d’abord comme une forme cryptée. On aurait cependant tort d’y voir un problème strictement linguistique. En réalité, l’argot est, dans sa forme même, révélateur du problème qui ne cesse d’affecter l’idéal moderne de la communauté politique : le problème de ses marges et de ceux qui ne s’y intègrent pas, de ses zones d’ombres et de ses refoulés – vagabonds, mendiants, voleurs, etc. L’argot joue dans le langage ce que Giorgio Agamben appelle la question des deux p-Peuples. Par « peuple » avec un « p » minuscule, nous entendons le peuple de l’ombre qui sourd, menaçant, derrière l'idéal des Citoyens représentés et pleinement intégrés dans le corps de la cité, qu’on nommera le « Peuple » avec majuscule.
2Une telle question est constitutive de la philosophie politique moderne et G. Agamben nous paraît l’avoir formulée de la manière la plus claire à l’aide de son double concept précédemment cité. C’est dans cette mesure qu’il nous a paru pertinent de commencer notre interrogation avec lui. À partir du moment où l’idéal politique est celui d’une unité de citoyens égaux, d’une communauté politique, comment penser les figures en excès ou en défaut de cet idéal ? Dans l’imaginaire et les institutions de la république française1, la fraternité a joué le rôle de nécessaire complément de la liberté et de l’égalité, comme opérateur de la réalisation quasi-naturelle de l’union nationale. Ainsi les révolutionnaires français dès 1790 (Discours sur l’organisation des gardes nationales de Robespierre) comptaient-ils sur le concept de fraternité afin d’unir un peuple orphelin de la figure paternelle du roi. Ce concept offrait le principe spirituel du lien entre citoyens désireux de faire partie de cette communauté que devenait le peuple français. Cependant, nous relevons déjà une contradiction qui nous occupera tout au long de cet article : la contradiction entre la littérarité du concept et sa portée métaphorique. D’un point de vue littéral, la fraternité renvoie à un schème familialiste et biologique, donc nécessaire et non choisi. En revanche, les révolutionnaires français ont souhaité l’utiliser de manière simplement métaphorique (comme si nous étions frères) afin de penser le lien entre citoyens qui permet de constituer une communauté de libre adhésion. Il nous faudra nous demander si la littéralité du concept de fraternité (et ses tendances exclusives, fondées sur un naturalisme plus ou moins étendu) ne menace pas l’idéal de libre adhésion, par la citoyenneté, au pays de la Révolution, de la liberté et de l’égalité.
3En effet, la question de la confrontation se pose alors entre l’idéalité d’un rapport social sans reste et ce reste qui existe effectivement, in-intégrable à l’idéal. Si l’on ne parvient pas à l’intégrer, il faut alors le refouler loin des yeux du Peuple. C’est ce procédé, qui tout à la fois dualise et invisibilise les marges que nous observerons alors plus concrètement, à travers la lecture symptômale d’un cas littéraire de l’époque : Victor Hugo, chantre de la fraternité qui eut sur la République française une grande influence, notamment sur la troisième République, qui lui offrit des funérailles nationales. Cela fait de lui une référence obligée et encore actuelle de la démocratie qui nous est contemporaine. C’est dans cette mesure que cette figure protéiforme, à la fois politique (discours à la Chambre des pairs par exemple) et littéraire (pléthore de romans et de poèmes qui ont éduqué des générations d'écoliers), nous intéresse particulièrement. Nul plus que lui n’a développé l’idée de « fraternité », leitmotiv de tous les discours de rassemblements nationaux. À partir du texte hugolien, de ses symptômes et de ses zones de clair-obscur, nous pourrons éclairer, d’un point de vue singulier, le travail de déconstruction de ce concept fondateur des États-nations des dix-neuvième et vingtième siècles. Il nous faudra cependant le mettre en perspective avec un autre discours, qui lui succède et lui répond quasiment mot pour mot, de manière épidermique, celui de Céline, figure majeure, polémique et haineuse, de la littérature de l’entre-deux-guerres. C’est en tant que voix s’élevant sur les ruines et les échecs des républiques successives (lorsque Céline écrit, les ligues fascistes se multiplient en France et la droite classique se rigidifie davantage, menant à la ruine de la devise républicaine au profit de « Travail, famille, patrie ») qu’elle nous intéressera et il nous faudra écouter la violence de sa critique afin d’en tenir compte dans notre travail d’interrogation du concept de fraternité comme lien entre les citoyens représentés.
Les deux P-peuples
4Dans les chapitres « Qu’est-ce qu’un peuple ? » et « Les langues et les peuples » de ses notes sur la politique intitulées Moyens sans fins, G. Agamben construit le concept des « deux peuples » afin d’exprimer la contradiction principale de la démocratie moderne. Dans l’ensemble des langues européennes modernes, le mot « peuple » recouvre deux réalités : aussi bien le « corps politique unitaire2 » que les classes inférieures. L’unité sémantique cache une scission et une ambiguïté profonde, plus exactement « une amphibologie inhérente à la nature et à la fonction du concept de peuple dans la politique occidentale3 ». Le concept de peuple peut avoir deux sens possibles dialectiquement opposés.
D’une part l’ensemble Peuple comme corps politique intégral, de l’autre le sous-ensemble peuple comme multiplicité fragmentaire de corps besogneux et exclus ; là une inclusion qui se prétend sans reste, ici une exclusion qui se sait sans espoir4.
5D’un côté donc, il y aurait les « citoyens », véritable corps de la nation, de l’autre ceux que la Nation ne parvient pas à intégrer à sa souveraineté – ceux qui en sont exclus. La constitution d’un corps politique dans le monde moderne ne semble pouvoir fonctionner qu’à travers ce couple inclusion/exclusion. Dans le cas français, le problème, remarquablement relevé par Derrida dans Politiques de l’amitié, se cristallise autour de l’idée de fraternité. C’est Victor Hugo, dans sa Déclaration de paix, que Derrida cite à l’appui de sa démonstration : « L’homme Un, c’est l’homme Frère, c’est l’homme Égal, c’est l’homme libre5 ». L’équation comporte en ses termes l’unité, la fraternité et l’égalité. Mais comment la comprendre ? Comment de telles abstractions trouvent-elles une signification concrète ? Au moyen, souligne Derrida, de tout un dispositif métaphorique qui est en réalité une véritable « embryologie » : Hugo use et abuse de la métaphore naturaliste afin de modeler le visage du monde fraternel à venir. Ainsi, dans Paris, il écrit :
Le continent fraternel, tel est l’avenir [...]. Avant d’avoir son peuple, l’Europe a déjà sa ville. De ce peuple, qui n’existe pas encore, la capitale existe déjà. […] Le fœtus des nations se comporte comme le fœtus de l’homme, et la mystérieuse construction de l’embryon, à la fois végétation et vie, commence toujours par la tête6.
6Il y a là un exemple de ce que disions précédemment sur la dangereuse collusion possible entre la métaphore (de l’ordre du comme si) et son socle littéral. C’est ici le rôle de la déconstruction derridienne de montrer le discours implicite (l’embryologie) qui pointe sous le discours idéologique hugolien (la révolution, moteur de progrès politique et social qui intégrera toutes ses marges dans un esprit œcuménique). Le concept de frère reste, du point de vue littéral, une notion d’ordre « généalogique, ethnocentrique et androcentrique7 ». D’où la difficulté, voire l’aporie, à l’utiliser comme modèle, même métaphorique, d’une citoyenneté qui se veut ouverte à la libre adhésion. Penser l’unité du peuple fondée sur la libre adhésion à partir d’un concept qui risque de glisser vers le schème familialiste pose des problèmes intenables. Ce schème suppose en effet une unité qui s’agence autour du semblable, mais bien plus, une unité qui s’aligne sur le modèle français que prône V. Hugo ci-dessus. Il poursuit ainsi :
Ils [les peuples étrangers] savent qu’il existe un peuple de réconciliation, une maison de démocratie, une nation ouverte, qui appelle chez elle quiconque est frère ou veut l’être […]. Phénomène magnifique, cordial et formidable, que cette volatilisation d’un peuple qui s’évapore en fraternité. […] Toi France, devient le monde !8
7Ici la tension entre la naturalisation impliquée par le concept de fraternité, et son utilisation dans la perspective d’une citoyenneté volontaire (donc non naturelle) est patente. Nous constatons en effet un glissement entre l’ordre naturel (« est frère », donc de fait, naturellement) et l’ordre non naturel de libre-adhésion (« veut l’être »). Le premier terme risque bien de contaminer le second. Qui « veut être » frère devra se rendre semblable au frère naturel. C’est en tout cas une potentialité du texte de V. Hugo, qui procède par mouvement excentrique, partant du centre, la France, pour arriver au tout (le monde). C’est le principe premier, la France, qui embrasse le monde et non l’inverse. Un frère, oui, mais un frère français, un frère semblable. Des « frères français », citoyens éclairés qui composent une unité restreinte, voire élitiste, qui ne peut assimiler le dissemblable. Le concept de peuple se fractionne alors en deux pôles dont les relations peuvent devenir antagonistes. Comme le montre Derrida, le problème de la compréhension du lien entre les membres d’une communauté est hanté, depuis les Grecs, par le spectre de la guerre civile, par la peur de l’auto-destruction du corps social.9 On en appelle donc à des figures autoritaires et fondatrices (c’est le rôle de l’oraison funèbre par exemple), aux contours paternels (les majores), afin de refonder le socle social qui menace de s’effondrer. On remotive la métaphore familialiste. Mon frère ne peut pas être mon ennemi. Si donc la métaphore fraternelle s’écroule, en ne parvenant pas à intégrer tous les membres de la communauté, surgit la menace d’une « classe dangereuse » susceptible de se retourner contre la communauté. Ces zones d’ombre qui menacent le peuple unifié, en réalité introuvable, formeront chez V. Hugo des figures en clair-obscur dualisant la société française en deux camps. D’où vient cette angoisse de guerre civile ?
8C’est l’introduction de cette idéologie fraternelle à partir de la Révolution française qui fait de la tentative d’incorporer les non-citoyens un problème qui remonte à la fin de la royauté et à l’instauration de la première République française. Il faut souligner également que le problème n’est pas franco-français, quand on songe à la popularité qu’ont eue les thèses des Lumières et des révolutionnaires français sur la formation d’États-nations au XIXème siècle. Qu’on pense par exemple au nombre de Sociétés de pensée qui se créent alors dans les Balkans, encore sous domination ottomane, et qui mèneront aux revendications d’autonomie. Parmi de nombreux exemples, nous pouvons donner celui des trois marchands grecs Xanthos, Scouphas et Tsakalov qui fondèrent en septembre 1814 à Odessa une société des Amis en s’inspirant du mouvement maçonnique. La Turquie de Mustafa Kemal fera également un usage complexe et radical de cet héritage révolutionnaire français largement diffusé dans la région, notamment grâce à la création de lycées français dont le plus célèbre est celui de Galatasaray. Mais la France ayant été l’un des plus zélés prosélytes des Lumières, c’est en se penchant sur son cas que nous trouverons des clefs de réponse à ce problème des deux peuples.
9Revenons donc à la Révolution française. La souveraineté est confiée au peuple, qui en est le dépositaire unique, « Le peuple devient une présence embarrassante, et misère et exclusion apparaissent pour la première fois comme un scandale en tout point intolérable10. » Le terme de scandale est ici à comprendre de manière double, ce qui nous aidera à mieux comprendre les symptômes d’angoisse du texte hugolien sous l’optimisme apparent de la forme. Il peut produire à la fois la compassion, ce que dit à la lettre le texte de V. Hugo. La volonté de voir disparaître cette misère en l’intégrant au fur et à mesure, par l’éducation notamment, au corps sain des citoyens éclairés. Dans un autre chapitre des Misérables, « Le peuple latent », V. Hugo écrit ainsi :
Cette foule peut être sublimée. Sachons nous servir de ce vaste embrasement des principes et des vertus qui pétille, éclate et frissonne à de certaines heures. Ces pieds nus, ces bras nus, ces haillons, ces ignorances, ces abjections, ces ténèbres, peuvent être employés à la conquête de l’idéal […]. Ce vil sable que vous foulez aux pieds, qu’on le jette dans la fournaise, qu’il y fonde et qu’il y bouillonne, il deviendra cristal splendide, et c’est grâce à lui que Galilée et Newton découvriront les astres11.
10Cependant si l’unité est impossible, elle devient scandaleuse au sens d’insupportable. Elle produit alors l’angoisse chez le bourgeois jacobin dont le modèle politique universel se heurte à l’épreuve du particulier. Dans ce cas, la volonté d’occulter le problème et sa visibilité dans l’espace public risque d’être l’autre tendance du projet politique révolutionnaire. Ce « peuple » jette en effet une ombre sur l’idéal d’unité ouvert par la Révolution française et la période contemporaine n’aura de cesse de tenter de faire disparaître l’écart creusé entre Peuple et peuple.
11Comment donc comprendre ce geste idéologique sans le renforcer, sans chercher à occulter les peuples exclus ? Quels sont les mobiles idéologiques qui rendent ce « peuple » intolérable au monde contemporain post-révolutionnaire ?
12Nous aimerions répondre à cette question en trois temps. Tout d’abord, nous présenterons une lecture symptômale du chapitre traitant de l’argot dans l’ouvrage phare de Victor Hugo, Les Misérables. Dans un second temps, nous confronterons la réponse que Louis-Ferdinand Céline élabore à cette conception et à cette pratique discursive de l’argot, réponse qui relève d’une conception tout autre de la souveraineté et du rapport à l’État moderne. Enfin, nous examinerons le traitement agambenien d’inspiration benjaminienne de ce problème politico-linguistique.
La définition hugolienne de l’argot
13Dans la seconde partie des Misérables, Victor Hugo s’étend le temps d’un chapitre en une longue digression sur le phénomène argotique, s’interrogeant tour à tour sur ses origines et sur ses racines, à la manière d'un généalogiste.12 Pour ce faire, il emprunte plusieurs figures, celle du « sondeur13 » qui descend le long d’un gouffre, celle du « médecin14 » face à une plaie purulente, celle du « naturaliste15 » face à une vipère ou à un scorpion, enfin celle de « l’historien des mœurs16 » qui ausculte la société et révèle ses symptômes dans une perspective progressiste.
14Dans un premier mouvement, Victor Hugo se demande ce qu’est à proprement parler l’argot ; il cherche à circonscrire le phénomène et à le qualifier. En exergue à son long développement, il prévient une objection de la part du lecteur :
Ici on peut nous arrêter, on peut généraliser le fait, ce qui est quelquefois une manière de l’atténuer ; on peut nous dire que tous les métiers, toutes les professions, on pourrait presque ajouter tous les accidents de la hiérarchie sociale et toutes les formes de l’intelligence, ont leur argot17.
15Et de convoquer tour à tour les différentes classes sociales (du marchand jusqu’à la duchesse) en leur associant leur « argot » (ou plutôt jargon), faisant surgir devant les yeux du lecteur tout un monde de stratification linguistique. Le sens précis du terme argot paraît alors instable et ses frontières extensibles à merci. Derrida rencontre un problème similaire avec le terme de « bêtise » dans son séminaire La bête et le souverain, qui n’est pas sans lien, au niveau des conséquences socio-politiques, avec la question de l’argot. Il montre que, malgré les apparences, il est impossible de dire avec certitude ce que l’on entend lorsque l’on accuse quelqu’un de bêtise. Il s’agirait, au sens d’Avita Ronell, d’un quasi-concept, c’est-à-dire d’un terme variable, soumis à la malléabilité et à la plasticité, utilisé pourtant comme un concept au sens circonscrit.18 L’intérêt est de montrer que lorsqu’un terme est utilisé de cette sorte, il n’a pas de fondements stables mais relève en réalité de l’ordre du performatif, du fictif. La bêtise, nous dit Derrida, est inséparable d’une volonté d’insulte et donc de désignation d’un ennemi de classe. Quoique V. Hugo tente de masquer sa malléabilité en parlant d’un « argot véritable », l’argot nous paraît également relever pour lui du quasi-concept. Il n’est pas une langue objectivable qui appartient à un groupe social en particulier, mais la langue particulière d’un groupe social, identifiée par des stigmates arbitrairement choisis. Si tous les jargons peuvent être argot, alors pourquoi en désigner un seul comme « véritable » ? N’est-ce pas un geste sans fondement linguistique autre que performatif, qui permet d’exclure une classe par rapport à d’autres ? Et si le geste est arbitraire, alors le langage particulier de tout groupe social ne pourrait-il pas devenir potentiellement métaphore du langage des exclus ? En ce sens, tomber dans la marginalité et l’exclusion menacerait, comme un impensé du texte de Hugo, l’ensemble de la société. De fait, l’énumération des différents jargons n’est qu’un prétexte pour exclure tous ces vocables d’un argot véritable, qu’il entend au sens restreint, c’est-à-dire la « langue laide, inquiète, sournoise, traître, […]vile, fatale, de la misère19 ».
16L’hypothèse de l’homologie du mécanisme d’accusation de bêtise et de la désignation d’un jargon comme argot est appuyée par cette citation tirée du chapitre « Les bas-fonds » des Misérables :
Les silhouettes farouches qui rôdent dans cette fosse, presque bêtes, presque fantômes, ne s’occupent pas du progrès universel, elles ignorent l’idée et le mot, elles n’ont souci que de l’assouvissement individuel […]. De la souffrance, ces larves passent au crime20.
17L’argot lui permet ici d’isoler et de désigner un groupe social portant les stigmates de la race maudite, celle-là même qui pose problème au bourgeois jacobin précédemment cité. V. Hugo en fait le langage même de la dé-socialisation et de l’exclusion. Le langage de la bêtise propre aux bas-fonds de la société, qui ne seront dangereux que tant qu’ils ne seront pas éduqués et unifiés au peuple révolutionnaire. L’argot véritable, débarrassé des scories qui le rendent transversal aux différentes couches sociales en l’identifiant aux jargons, apparaît dans Les Misérables comme le dénominateur commun qui permet de créer une communauté souterraine d’exclus.
18Cependant, aux adjectifs qu’emploie Hugo, on perçoit un sentiment d’attraction-répulsion face à cette langue chthonienne, complice des crimes les plus noirs. Il y voit en effet le symbole de la misère, mais également celui de la révolte : tel est bien le fil conducteur qui lui permet de démarquer cet argot des autres jargons socio-professionnels. Toutefois, et c’est là que le texte possède une force auto-destructrice insoupçonnée de V. Hugo, si la distinction entre le jargon des groupes sociaux et l’argot des misérables est fictive, alors, nous l’avons dit, tout groupe social peut potentiellement être désigné comme race maudite. L’idée implicite et pourtant refoulée du texte de V. Hugo ne serait-elle pas l’omniprésence de la révolte, qui n’est jamais vraiment localisable et identifiable, tout comme le peuple parlant argot ?
19Il s’agit, dit-il, d’un outil à l’usage de cette misère combattante, qui « se décide à entrer en lutte contre l’ensemble des faits heureux et des droits régnants21 ». C’est là même l’origine de l’argot lui-même : « Pour les besoins de cette lutte, la misère a inventé une langue de combat qui est l’argot22 ». L’argot apparaît tout à la fois comme le symptôme linguistique et le médium privilégié des sans-droits, qui, étant tombés à un tel niveau de misère, ne se trouvent alors pour ainsi dire plus nulle part dans la société. C’est donc une catégorie très étrange que ces misérables décrit par Victor Hugo, qui habitent certes la nation française, mais dans des lieux interlopes : des ban-lieues comme des « chiourmes, des bagnes, des prisons, tout ce que la société a de plus abominable23 ». Victor Hugo va même plus loin dans la descente aux enfers, allant jusqu’à dire qu’il s’agit des « bas-fonds de l’ordre social, là où la terre finit et où la boue commence24 ». Cette population-là n’est plus d’aucun territoire pour faire allusion à Carl Schmitt25, qui voit dans la possession de terre l’origine du droit et de l’instauration d’un ordre légal. Celui qui n’est d’aucun territoire est plongé dans une sorte d’état de nature : les misérables, issus du monde souterrain et nocturne, n’habitant que des lieux bannis de la nation, sont donc dans la situation a-nomique des sans-droits qui n’ont plus rien à perdre ; ou plutôt, qui ont à gagner à se lancer dans la criminalité, aux marges de la société.
20Cette idée se retrouve dans la description de L’impérialisme par Hannah Arendt, dans le chapitre « Déclin de l’État-nation et crise des droits de l'homme ». Les sans-droits ou apatrides ont, dit-elle, tout intérêt à commettre un crime afin d’être réintroduit dans un système de droit et de retrouver une identité. Pour le sans-droit, paradoxalement, se retrouver en prison le réintroduit de fait dans un espace de droit. Il peut avoir de la nourriture, un avocat et être jugé par une Cour. Ce cas-limite montre bien les rapports paradoxaux et mobiles entre l’exclusion sociale et l’intégration à un système de droit et de protection juridique. En occultant les misérables dans le point aveugle de son espace représentatif, la société des citoyens éclairés n’offre à la populace que cet espace obscur dans lequel évoluer et exister. Cependant, elle a beau plonger les misérables dans l’obscurité, comme son refoulé, elle n’est pas moins consciente du danger de révolte qu’ils représentent. D’où l’instauration d’un système juridique qui institue tout un dispositif de jugements et de peines légales afin de punir les crimes perpétrés par les misérables. La criminalisation est le seul biais par lequel la société de droit parvient à inclure ses marges exclues.
21Ces misérables sont en effet souterrains, et donc invisibles ; invisibles donc protéiformes et insaisissables. C’est la métaphore du déguisement, de la mascarade et du carnaval qui est alors privilégiée par Hugo : « Ses habilleurs l’ont grimée; elle [la langue des Misérables] se traîne et se dresse, double allure du reptile. Elle est apte à tous les rôles désormais, faite louche par le faussaire, vert-de-grisée par l’empoisonneur26. » Ces métaphores font sens vers la dissimulation et la subversion (le déguisement se porte normalement lors des jours de fête, qui viennent interrompre un quotidien réglé. Le Carnaval joue quant à lui le rôle de suspension de la norme. On ne peut dès lors manquer de faire l’analogie entre l’argot qui dérange les normes de la grammaire française et le criminel qui menace les normes sociales. Le rapport entre l’argot et le crime s’en trouve renforcé : le combat dont nous parlions plus haut est bien celui de la misère combattante contre la société à laquelle elle ne s’intègre pas et contre laquelle elle s’arme silencieusement.
22Nous disons silencieusement, car la question de l’invisibilité, de l’indistinction et, partant, du brouillage des identités est cruciale. C’est précisément ici qu’est à l’œuvre le refoulement par le Peuple de cet autre peuple qui entache son idéal fraternel. La langue, écrit Hugo, « ayant quelques mauvaises actions à faire, se déguise. Elle s’y revêt de mots masques et de métaphores haillons27 ». Il s’agit, dit Hugo, dans une définition sans appel, de la « langue des ténébreux ». On ne sait donc pas au juste qui appartient à ce monde.28 Il y a les forçats bien sûr, les criminels, les délinquants, les tziganes sans doute. Mais l’important est qu’on ne peut pas dénombrer cette foule grouillante. Il n’est pas anodin que Victor Hugo l’apparente, par le biais de la métaphore, aux insectes. Les misérables semblent ne pas avoir de visage ni d’identité puisqu’ils vivent dans la clandestinité des ténèbres. Ils ne sont pas seulement cachés sous terre, ils sont indistincts. L’enquête anthropologique hugolienne se meut dans un brouillage des partages du visible, qui rend son objet fondamentalement indéterminé.
23Mais Hugo ne s’en tient pas au point de vue descriptif et à ses difficultés propres. L’historien des mœurs diagnostique ; il évalue. Qu’une société comme celle de la nation française ne parvienne à se constituer comme corps politique unifié que par le refoulement des misérables est le signe d’un échec : et un échec qui fait retour. La présence sourde de ces misérables, là même où ils n’ont pas à être – à l’air libre, ou dans la langue française – en est le témoignage gênant. Il s’agit donc de se demander de quel échec il est question. Par rapport à quel projet politique celui-ci est-il diagnostiqué ? C’est dans le problème de l’articulation de l’argot à la langue française que se joue celui, politique, du rapport entre les misérables et la Nation, et que Victor Hugo élabore son diagnostic de la société française.
Le français et l’argot peint en clair-obscur hugolien
24 Cette langue argotique, écrit Hugo, « on peine à la reconnaître. Est-ce bien la langue française, la grande langue humaine ? […] [E]lle ne marche plus, elle clopine ; elle boite sur la béquille de la Cour des miracles29 ». Il s’agit certes de la langue française, mais monstrueusement métamorphosée. L’argot prend une vie propre, en perpétuel mouvement, en marge de la langue française normale – normée par une grammaire. Mais cette vie est singulière : c’est une vie malade. L’argot est comme une plaie, une pustule de la société qui l’engendre, un cancer qui la ronge. Hugo diagnostique alors l’argot à grand renfort de métaphores médicales comme une pourriture réelle nécessaire à étudier pour qui prétend guérir la société.
25Il s’agit, continue-t-il, d’une « langue dans la langue, une sorte d’excroissance maladive, une greffe malsaine qui a produit une végétation, un parasite qui a ses racines dans le vieux tronc gaulois et dont le feuillage sinistre rampe sur tout un côté de la langue30 ». Ce n’est pas une langue étrangère : il y a emboîtement de l’argot dans la langue française mais celui-ci est monstrueux, présenté comme une « excroissance maladive ». Or cette anomalie provient, V. Hugo le souligne avec force, du corps lui-même. Elle se développe à la marge, menaçant de ronger le « vieux tronc gaulois ». C’est donc en tant que maladie infectieuse affectant le corps de la Nation que Hugo, ce chantre de la République française, envisage l’argot. Bien plus, celui-ci, tout comme ces populations souterraines, est certes un parasite de la vieille Nation gauloise, mais il en est surtout la maladie propre. « Chaque race maudite a déposé sa couche, chaque souffrance a laissé tomber sa pierre31. » L’argot, et c’est ce qui va motiver les conclusions de Hugo, est diagnostiqué comme une maladie interne à la Nation française qui s’est stratifiée à travers les âges féodaux puis monarchiques.
26À ce titre, Hugo considère que cette maladie mérite l’attention du penseur et de l’historien des mœurs, dont le rôle est d’ausculter la société dans laquelle il vit. La méthodologie hugolienne part du principe que ce sont les remous souterrains qui affectent la surface. C’est la raison pour laquelle, selon Victor Hugo, étudier l’argot c’est aboutir au « mystérieux point d’intersection de la société régulière avec la société maudite32 ». Il s’agit d’un insaisissable point aveugle qui sépare cette population du reste des Français. Elle est écrite au pluriel, il lui est refusé toute singularité. Hugo confère donc un grand rôle politique (idéologiquement chargé) à l’intellectuel capable de clarifier et de conceptualiser le chaos plébéien afin de mieux le faire disparaître en le réduisant au semblable.
27Cependant, ce peuple obscur ne rappelle-t-il pas le sans-fond des romantiques, théorisé par Schelling (Ungrund) et repris par Deleuze dans Différence et Répétition à l’occasion d’une réflexion sur la gravure, puis sur la bêtise (nous avons déjà dit plus haut que les misérables étaient présentés comme « bêtes » et animalisés) ? À propos de la gravure, Deleuze écrit : « le véritable monstre, c’est de faire monter le fond et de dissoudre la forme. En renonçant au modelé, c’est-à-dire au symbole plastique de la forme, la ligne abstraite acquiert toute sa force, et participe au fond d’autant plus violemment qu’elle s’en distingue sans qu’il se distingue d’elle33. » Or, tout le texte de Hugo est peint dans un clair-obscur de guerre civile, avec d’un côté la lumière, c’est-à-dire la grande langue française, la Nation de la Révolution française, l’ensemble de la société, et, de l’autre côté, les ténèbres, cette foule de misérables en tous genres qui grouille dans l’air miasmatique de la société. Le projet politique sous-jacent à ce diagnostic prend donc la forme d’un V. Hugo, qui se figure en chevalier de la Nation, portant la « lance de lumière de l’idéal » qui sauvera les misérables des ténèbres. Sa volonté est de sublimer ce sans-fond, afin de faire des misérables grouillants un « cristal splendide ». Cependant, Deleuze montre bien, dans le cas de la bêtise également, que l’individuation, qui donne forme aux déterminations, ne peut se séparer de ce fond qu’elle traîne avec soi. La « ligne abstraite », claire, déterminée, du citoyen représenté ne se distingue clairement que parce qu’elle est projetée sur ce fond obscur, qui lui est intrinsèque et la suit aussi nécessairement que son ombre.
28L'échec politique est donc celui d’une société qui a fondé sur la représentation citoyenne l’espoir d’obtenir un corps social harmonieux et homogène. Cependant, sous la surface représentative gronde le sans-fond qui lui est constitutif et par conséquent qui ne peut disparaître.
La philosophie de l’histoire hugolienne
29Dans un troisième mouvement, après avoir défini l’argot en le différenciant des jargons et après avoir emprunté la figure médicale afin d’établir un diagnostic politique des raisons d’être de cette misère, Hugo explicite la métaphore médicale à l’aide d’une pensée de l’histoire et du temps qui lui permet d’inscrire le phénomène argotique dans un moment négatif d’une dialectique s’acheminant résolument vers la concrétisation de l’idéal. L’histoire comme procès au cours duquel la Nation égalitaire intègre ses écarts dans la grande famille fraternelle de la France et, à cette fin, soigne ses propres plaies, corrige ses propres torts. La Révolution française a déjà écarté le danger de la jacquerie, ces révoltes paysannes qui s’en prennent à la propriété privée. « Elle dégagea la question, promulgua la vérité, chassa le miasme, assainit le siècle, couronna le peuple [...]. On peut dire qu'elle a créé l’homme une deuxième fois en lui donnant une seconde âme, le droit34. » L’énumération de la première phrase enchaîne chaque proposition l’une à l’autre de manière nécessaire. Couronner le peuple, lui rendre sa souveraineté permet d’assainir les miasmes, de guérir la Nation de ses dangereux symptômes de maladie sociale. L’homme n’est plus créé à l’image de Dieu, mais à l’image de l’idéal de la Révolution française, il renaît une seconde fois, mais cette fois sa naissance ne détermine pas sa place dans l’un des trois ordres, mais lui donne l’égalité avec tous. C’est donc de la Nation qu’il reçoit l'égalité. C’est la Révolution qui réconcilie le Peuple et la populace.35 Voilà bien le projet politique fantasmé par Hugo dont nous parlions plus haut, que vient menacer l’argot. Cependant, cette menace est vouée à n’être qu’un moment, puisque, déclare fièrement Hugo, « les maladies féodales et monarchiques ne sont plus dans notre sang. […] Depuis 89 le peuple tout entier se dilate dans l’individu sublimé ; […] la dignité du citoyen est une armure intérieure36 ». La citoyenneté est présentée comme le remède aux plaies sociales, comme assainissement (les occurrences de ce mot tout au long du chapitre sur l’argot sont nombreuses) de la « populace ». La République (fantasmatique) française est une république de citoyens, saine et en bonne santé. L’apoplexie fut évitée grâce à la Révolution française ; reste la « phtisie37 », c’est-à-dire la misère. Elle est un reste d’infection des maladies monarchiques, mais Hugo croit fermement au progrès qui fera rajeunir, ressusciter ce corps malade : « le genre humain montant, les couches profondes sortiront tout naturellement de la zone de détresse38 ». C’est donc un devoir fraternel de la part de tous les citoyens, qui sont égaux à leurs frères de misère de travailler pour cette élévation. Idéologiquement, la France révolutionnaire devient le lieu d’une naissance, d’une délivrance, d’une vérité – de l’histoire ? Hugo parle de Jérusalem du vrai – qui ne demandait qu’à s’exprimer. Paris est le lieu de « la révélation révolutionnaire39 ». Quiconque naît au sein de cette Nation doit participer de cette révélation, c’est-à-dire de l’Unité du Peuple. La Populace doit donc disparaître, en s’assimilant au « bon peuple », car le monde post- révolutionnaire ne peut pas accepter une société duale.
30Il faut bien souligner ici que c’est à l'aide du concept de fraternité que Hugo parvient à remettre la dialectique en marche et à dépasser la contradiction qui fait que la plèbe qui parle argot est justement cette populace dont Hugo clame qu’elle a disparu avec la souveraineté du peuple. Cette fraternité se traduit juridiquement dans l’État français par l’accession à la citoyenneté. Insistons donc, à la lumière de notre lecture hugolienne, sur la charge idéologique que porte ce concept de citoyen. Parce qu’il intègre, il exclut tout aussi bien. Parce qu’il prétend représenter, il invisibilise de la même façon. Parce qu’il protège juridiquement, il fragilise d’autant plus ceux qui en sont exclus. Enfin, parce qu’il est valorisé socialement, élevant ceux qui en bénéficient au rang de frères40, il expose ceux qui en sont privés à l’opprobre morale.
31La République idéale, pour Hugo, est donc à venir et ne sera pleinement réalisée que quand cette phtisie sera guérie. « Oui, le Peuple, ébauché par le dix-huitième siècle, sera achevé par le dix-neuvième41. » Hugo n’accepte ce reste de populace que comme un moment, une transition vers la République idéale de la Nation française, la Nation révolutionnaire, qui ne saurait à terme renfermer en son sein ces insectes populaciers grouillants. Ils sont un résidu monarchique, héritiers des distinctions d’ordres, et plus particulièrement du Tiers-État. La souveraineté leur étant désormais confiée, cette maladie ayant trouvé son vaccin, elle ne peut qu’appartenir au passé. Autrement, elle mettrait en crise la fiction originaire sur laquelle repose l’idéal de la Révolution française (la re-naissance d’un homme libre et égal à ses concitoyens) et ses héritières politiques, comme la République française.
L’argot célinien ou la voix haineuse du retour du refoulé
32 C’est ce fantasme politique, ce projet de société idéale qu’il nous intéresse maintenant de confronter à l’autre grande figure du paysage littéraire français à avoir usé de l’argot, Céline. Nous aimerions montrer comment Céline convoque l’argot d’une façon très différente de celle de Hugo, et comment cet usage même est solidaire d’une vision de la communauté, de la citoyenneté et, plus largement, des problèmes politiques liés à la constitution de l’État moderne, totalement dissidente. Quant à l’usage de l’argot, Céline déclare à propos de ses sources : « Non l'argot ne se fait pas avec un glossaire mais avec les images nées de la haine42. » L’argot célinien se différencie de celui de Hugo – qui s’appuie de manière quasi-naturaliste (voire ethnologique) sur un dictionnaire d’argot afin de reproduire le langage des classes laborieuses –, en ce qu’il lui est propre. Il est l’expression même des vociférations de l’auteur et obéit à une logique inhérente qui lie nécessairement musicalité et images crues. Loin d’avoir une fonction mimétique, l’argot est utilisé par Céline comme la seule langue capable par son pouvoir évocateur d’exprimer la marginalité et l’exclusion de ses narrateurs. L’argot célinien, si nous nous basons sur les exemples du Tripod43, fonctionne de différentes façons. Il y a les mots-valises (par exemple « baboulli », construit à partir de « babiller », de « bafouillis » et de « bouillie »), les néologismes ou encore les mots qu’il défigure ou rallonge à l’aide des deux infixes les plus fréquemment utilisés : « ag » et « ar ». Il s’agit donc bien ici de travailler sur la musicalité de l’argot, de défigurer la langue française afin de lui faire perdre ses signifiants habituels, majeurs et donc impuissants à décrire la marginalité et la haine sociale. Il faut donc heurter les mots, les mixer, en faire une bouillie d’où ne s'échapperont que des bribes de sens, non pas directement signifiantes mais plutôt suggestives. Et en même temps, il s’agit d’une écriture extrêmement exigeante et précise, presque une ascèse. Une écriture qui a la prétention de faire concurrence à la philosophie. Sartre est « l’agité du bocal ». L’argot comme écriture anti-intellectualiste ? Écoutons donc Céline, à l’orée de son premier livre, Voyage au bout de la nuit, ou plutôt la voix de son narrateur Bardamu à propos de la « race française », comme une réponse haineuse à Hugo :
La race, ce que t’appelles comme ça, c’est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C’est ça la France et puis c’est ça les français44.
33Plus de place ici pour le Peuple, plus de dualisme hugolien, de clair-obscur, plus d’embryologie. Plus de construction idéologique sur de l’informe (les miasmes que décrit Hugo et qu’il transperce de la lance de l’idéal, faisant ainsi le partage entre le jour et la nuit). Le peuple célinien n’est pas naturalisé. Il s’agit d’un « ramassis », c’est-à-dire d’un assemblage de peu de valeur, hasardeux, de chiens errants qui se seraient trouvés par hasard.
34Écoutons-le continuer, et il s’agit d’une référence presque directe à Hugo, car il évoque la punition du vol du pain qui est un topos chez Hugo. On le retrouve en effet aussi bien dans Les Misérables que dans Claude Gueux (justement fameux par sa « chanson de l’argot »). Cette sévérité envers les menus larcins est pour Céline « une recommandation sévère à tous les malheureux d’avoir à se tenir à leur place et dans leur caste, peinards, joyeusement résignés à crever tout au long des siècles et indéfiniment de misère et de fin45. » Au contraire, lorsque l’élite se met à s’intéresser aux miséreux, c’est pour :
vous tourner en saucisson de bataille... [...] Louis XIV lui au moins, qu’on se souvienne, s’en foutait à tout rompre du bon peuple. […] Il s’en barbouillait le pourtour anal. […] Les philosophes, ce sont eux, note-le encore pendant que nous y sommes, qui ont commencé par raconter des histoires au bon peuple... […] Plus d’illettrés ! Il en faut plus ! Rien que des soldats citoyens ! Qui votent ! Qui lisent ! Et qui se battent ! […] Et ce fut le premier départ des premiers bataillons d’émancipés frénétiques ! Des premiers couillons voteurs et drapeautiques qu'emmena le Dumouriez se faire trouer dans les Flandres !46
35L’argot lui permet donc de désamorcer le contenu idéologique de termes tels que citoyen, vote, drapeau, et plus le mot sonne et résonne, plus nous sentons le poids de la charge que cette grenade linguistique vient de faire exploser. Les charges sont directement dirigées contre l’idéal politique républicain. En ce sens, on peut considérer la voix haineuse de Céline comme celle de l’exclu du peuple hugolien. Le retour du refoulé revient sous la forme des vociférations argotiques qui remontent à la surface lisse de l’espace politique public. Des vomissements argotiques, voilà l’effet symptômal produit chez Céline par le projet hugolien, qui le pousse à chercher ailleurs, en dehors de son peuple-canaille composé d’exclus, des fautifs, en l’occurrence les Juifs : « Les juifs, racialement, sont des monstres, des hybrides, des loupés tiraillés qui doivent disparaître47. »
36Il s’agit de souligner la violence à l’œuvre dans le texte de Céline, une violence qu’on pourrait qualifier de « brute », meurtrière (n’oublions pas les pamphlets antisémites), quasi « féodale » au sens de Bataille dans son livre sur Gilles de Rais48, et qui serait en cela pré-étatique. Une violence d’avant l’instauration de l’État moderne, une violence pour qui le droit, la liberté et l’égalité ne sont pas encore constitués selon le modèle de la fraternité. D’où la recherche incessante de l’ennemi (dans la figure du « juif » par exemple). Il ne cherche pas le frère, il n’y en a pas chez Céline, mais l’ennemi, qu’il appelle de ses vœux et qui est constitutif. C’est là le caractère absolument scandaleux de Céline. Il met en scène, à travers l’argot, comme langue anti-intellectualiste, la violence primaire dont parle Benjamin dans Critique de la violence, que s’approprie l’État par le droit afin de conserver sa puissance. Elle est ici libre de tout droit, incarnée dans la figure de marginaux, d’exclus, de prolétaires (qui parlent argot), que l’État moderne ne peut accepter (Benjamin parle bien de l’attraction-répulsion du peuple pour le « grand criminel ») et il aura toujours tendance à les produire comme individus a-nomos, devant disparaître. Voilà donc pour la réponse argotique de Céline à Hugo, qui déconstruit en bonne et due forme le discours dix-neuvièmiste et son idéal de citoyenneté, écrit en belle langue française. L’argot lui permet, par la déformation qu’il fait subir au français, de se faire « tzigane de sa propre langue » pour reprendre une expression de Deleuze49.
L’argot, langue tzigane
37Deleuze n’est d’ailleurs pas le seul qui associe argot et tzigane. Victor Hugo déjà parlait de Cour des miracles dans le chapitre analysé plus haut et G. Agamben en a fait l’objet d’un article dans Moyens sans fins, intitulé « Les langues et les peuples ». La permanence de l’association nous a interpellée comme un possible tierce moyen d’envisager le problème des deux peuples, à la fois linguistiquement et socialement. G. Agamben met en parallèle l’apparition de l’argot en France avec l’arrivée de bandes tziganes en France au cours des premières décennies du XVème siècle, dans « les années tourmentées marquant le passage de la société médiévale à l’État moderne50 ». Il y aurait donc bien un lien fort entre l’apparition de cette excroissance linguistique qu’est l’argot et l’État moderne, producteur du couple inclusion/exclusion mentionné plus haut. Mais G. Agamben va plus loin, à l’aide de la thèse d’Alice Becker-Ho qui montre la dérivation d’une partie du lexique de l’argot de la langue des Tziganes, le Rom. De cela découle une conséquence qui n’est pas sans rappeler à la fois la peur sociale de Victor Hugo face à l’argot, et l’usage déterritorialisant qu’en fait Céline :
Les Tziganes sont les vestiges de notre Moyen Âge ; une classe dangereuse d’une autre époque. Les termes tziganes eux-mêmes, qui, depuis leur première apparition, ont adopté les patronymes des pays qu’ils traversaient, perdant en quelque sorte leur identité sur le papier aux yeux de tous ceux qui croient savoir lire51.
38L’argot est lié au ban-ditisme, donc aux classes dangereuses, à celles qui sont au ban de la société. Or l’argot vient également des tziganes, ce qui tendrait à faire de ce peuple sans terre non un Peuple mais une populace, dangereuse, et du Rom un jargon, non une langue. L’argot, langue gitane, issue de la Cour des miracles. Nous voyons donc bien que les frontières sont poreuses entre langue et jargon, peuple et populace. La seule frontière entre les deux paraît être l’appartenance ou non à un État, l’État moderne. Celui-ci, selon C. Schmitt dans Le Nomos de la terre, est parvenu à canaliser en Europe la violence guerrière (à l’œuvre dans les textes céliniens) en créant un ordre territorial fixe, avec des frontières clairement marquées.52 D’où la haine des organisations sociales et des langues mobiles et déterritorialisées. G. Agamben, lecteur de Schmitt et de Benjamin, insiste sur l’impossibilité de définir et de circonscrire ce qu’est un peuple ou une langue, hormis que les deux furent liés nécessairement entre eux par l’idéologie romantique. Si la frontière de circonscription d’un peuple ou d’une langue est poreuse, alors nous pouvons très bien retourner le discours et dire avec lui que « tous les peuples sont bandes et coquilles, toutes les langues sont jargons et argots53 ». En effet, lorsque Hugo parle d’une greffe malsaine sur la langue française, il n’empêche qu’il confère à l’argot un statut de langue. Il appelle bien comme telle, celle des « ténébreux ». L’article indéfini leur confère le statut d’une communauté, voire d’un peuple. Le temps de l’analogie donc, argot et populace sont élevés au rang de langue et peuple, démasquant ainsi la construction idéologique que représente désormais dans le monde moderne les termes de « peuple » et de « langue », qui ne reposent sur aucune réalité substantielle. Peu importe la scientificité de l’affirmation « tous les peuples sont bandes, toutes les langues sont jargons », il faut en tirer la puissance libératrice salutaire, envisager les conséquences radicales de cette thèse.
39Il faut se demander ce qui aujourd’hui opère une séparation entre peuple et bande, entre langue et jargon, dialecte, etc. L’exemple de Victor Hugo est à cet égard éclairant. C’est de sa volonté de produire un peuple réunifié, œcuménique que vient la nécessité d’établir un tableau réaliste de la société française. Ce tableau, nous l’avons vu, est peint en clair-obscur, il dualise la société française, plaçant du côté de la lumière et de la raison l’État post-révolutionnaire (dont on sait qu’il s’était attaqué aux dialectes régionaux) qui possède un corps de citoyens « unis » fraternellement, et dans l’ombre et l’indistinction le peuple, la populace, les misérables. Assimiler les misérables au sans-fond romantique révèle de manière symptômale l’angoisse que produit la populace chez le chantre républicain. En voulant unifier, il sépare et stigmatise, car, répétons-le avec Deleuze, la ligne abstraite ne se distingue du fond qu’en tant qu’il reste attaché à elle. Ainsi, le texte de V. Hugo apparaît comme contre-productif. En prenant acte de l’existence des misérables, afin de mieux combattre le problème, il renforce en réalité le mécanisme d’exclusion en les séparant du reste de la société. Sa tentative de clarifier conceptuellement le problème contribue en fait à l’assombrir, le dissoudre dans l’invisibilité. Plus il cherche à circonscrire le problème, moins il parvient à faire émerger les misérables à la surface de la reconnaissance politique. L’effet du texte est alors paradoxalement de leur refuser toute reconnaissance d’identité. Il semble là y avoir un schisme radical au sein du territoire français, héritier des mécanismes de reconnaissance et de représentation juridiques issus de l’idéologie révolutionnaire française dont le plus significatif est la possession ou non de la citoyenneté. Or nous avons vu que son l’obtention flirte toujours, de près ou de loin, avec les métaphores naturalistes et territoriales. Le peuple dont l’unité se fondera sur la fraternité reste introuvable.
40Quelle issue serait donc possible ou envisageable, en poussant les conséquences jusqu’à leur terme ? Il s’agit évidemment de rompre les liens qui lient inextricablement entre eux langue-État-peuple. La thèse qui fait de tous les peuples des tziganes et de toutes les langues des argots a pour mérite de faire apparaître les langues et les peuples comme pluriels c'est-à-dire comme pluralité et masques, comme avatar d’un factum loquendi (le fait qu’il y ait des êtres parlants, qui produisent des formations langagières), d’un factum pluralitatis (le simple fait que des êtres humains forment une communauté). Voilà, semble-t-il, la seule manière sensée de penser les langues et les peuples. Mettre en évidence le fait qu’ils ne sont qu’un moment dans l’histoire du factum loquendi, du factum pluralitatis, qui passe par un certain affranchissement « non pas grammatical mais poétique et politique – des argots eux-mêmes en direction du factum loquendi. Aller vers la pure existence du langage (sans rapport avec un peuple), un jeu poétique du langage, voilà qui se rapproche le plus de l'éthique à l’époque actuelle ». Quel serait son équivalent en termes de peuple ? Aller vers la pure existence du factum pluralitatis ?
41Cette idée d’une langue pure a été inspirée à G. Agamben par Benjamin dans son essai-préface à sa traduction de Baudelaire, La tâche du traducteur. Dans cette voie, la traduction, en tant qu’elle est médiation entre deux différences, deux langues étrangères, et qu’elle ne doit pas être comprise sur le mode de la copie ou de l’imitation, mais bien de la création d’un espace où les deux langues, tout en restant elles-mêmes, communiquent ensemble, pourrait nous offrir une piste afin de penser un être-ensemble des singularités humaines qui ne soit pas compris comme réduction au semblable mais création d’un espace commun où communiquent les différences. Benjamin cite dans son essai un linguiste allemand, Rudolf Panwitz, qui insiste sur l’aspect dialectal des langues lors du processus de traduction :
Nos traductions mêmes les meilleures partent d’un faux principe voulant germaniser le sanscrit […] au lieu de sanscritiser d'helléniser d'angliciser l’allemand. […] [L’]erreur fondamentale du traducteur est de conserver l’état contingent de sa propre langue au lieu de la soumettre à la puissante action de la langue étrangère. […] [O]n n’imagine pas jusqu’à quel degré une langue peut se transformer, à quel point de langue à langue il n’y a guère plus de différence que de dialecte à dialecte54.
42La théorie benjaminienne de la traduction offre donc une piste intéressante qui permet de dé-naturaliser les langues, de les replacer dans leur pluralité babélienne, toujours imparfaites en cela que plusieurs selon le mot de Mallarmé. La parenté entre les langues n’est pas donnée (Babel ou la punition divine de l’incommunicabilité) ; elle est redevable de l’effort de traduction. Il faudrait penser de même la prétendue parenté entre les membres d’un peuple puis entre les peuples.
43Au terme de cette analyse, nous espérons avoir montré les apories résultant de la tension entre une compréhension littérale de la fraternité (naturaliste) et métaphorique (comme adhésion volontaire). Le socle de littérarité menace toujours de contaminer la métaphore, créant par-là des contre-courants sous-jacents au projet déclaré du texte, qui est un idéal œcuménique d’unification des citoyens entre eux, puis de réconciliation des peuples, alignés sur le modèle post-révolutionnaire français. La lecture symptômale du texte révèle un tableau peint en clair-obscur qui sépare en réalité le peuple français en deux, au lieu de l’unifier. Le processus représentatif, nous l’avons ébauché avec Deleuze, que ce soit d’un point de vue gnoséologique ou politique, n’émerge à la surface qui permet le procès de recognition qu’autant qu’il porte avec lui le sans-fond où flottent les indéterminations. Il s’en distingue d’autant plus violemment qu’il le traîne à sa suite. Ce fond restera à jamais là et inassimilable. C’est cette violence présente en creux dans le texte hugolien que nous avons voulu révéler à travers une attention précise portée aux entrecroisements des champs lexicaux utilisés afin de désigner les misérables. Ceux-ci sont bestialisés (sous forme d’insectes), occultés (mention des ténèbres) et indifférenciés (aucun visage propre n’émerge de ce chaos). Ces tensions illustrent bien la problématique qui lie ensemble obtention de droit, existence politique et système représentatif. Ce système ne protège que pour autant qu’il reconnaît, qu’il identifie. De fait, le non-reconnu vient heurter les limites propres du système, qui ne peut que l’invisibiliser. Le système ne peut donc être représentatif qu’en tant qu’il suppose une part d’ombre qui restera son point aveugle. Il ne protège qu’à mesure qu’il exclut également. De fait, les vociférations argotiques de Céline, qui semblent répondre en tout point au discours hugolien, apparaissent comme la voix de ces exclus, comme le retour du refoulé, d’autant plus fort que les mesures d’invisibilisations l’auront également été. Il ne s’agit pas de suivre la voix célinienne afin de sortir du modèle politique représentatif, mais de souligner la force de l’explosion de haine que celui-ci peut provoquer lorsque le fond remonte à la surface. La solution résiderait bien plus dans une dé-naturalisation réelle du discours sur les peuples et sur les langues, débarrassé des métaphores contaminées par leur littérarité contradictoire. Envisager sérieusement de faire communiquer la théorie de la traduction benjaminienne avec une réflexion politique reconceptualisant les liens possibles entre les singularités qui forment une communauté nous paraîtrait alors une piste des plus fécondes.