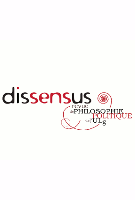Politique, savoir, subjectivation. Recherche sur la question du sujet dans la philosophie politique française contemporaine (2)
Thomas Bolmain est philosophe, chargé de recherches F.R.S-FNRS (ULg). Ses principales recherches et publications portent sur la critique kantienne, la pensée dialectique, leur histoire et leur actualité, en particulier du point de vue de la philosophie (politique) française contemporaine.
Introduction
1. Savoir, fonction-sujet et politisation dans l’Esquisse
2. Du procès sans sujet à la subjectivation (Althusser, Badiou, Rancière, Foucault)
a) Althusser : l’histoire, entre idéologie et procès sans sujet
b) Althusser derechef : fonction-sujet et interpellation en sujet
c) Au-delà d’Althusser : corps et subjectivation (Rancière et Badiou)
d) Foucault envisagé comme symptôme (d’une pensée du sujet)
1[Début de la seconde partie]
3. Figures de l’épistémologie : pensée, rupture, totalité (Althusser et Foucault)
2Un rapprochement opéré entre Althusser et Foucault doit avant tout mettre en évidence le point à partir duquel s’éclairent leurs divergences : une volonté analogue de prolonger le style épistémologique qui était celui de Bachelard et de Canguilhem1. Il y va bien, pour Althusser et Foucault, d’un essai de forger des outils épistémologiques rigoureux de façon à interroger la prétention d’ensembles discursifs à faire science. À ce compte, ce sont surtout leurs travaux respectifs des années soixante qu’il conviendrait de comparer, quand chacun crée sa propre approche théorique de l’historicité de la connaissance et du savoir, soit sous le masque de l’archéologue, ce « positiviste heureux2 », soit par la création d’« un véritable traitement épistémologique3 » de Marx fondé sur une conception de « la connaissance comme production4 ».
3Or il est vrai, Foucault le dira, que cette interrogation épistémologique est intrinsèquement liée à une enquête portant sur les modes de constitution du sujet (voir tout le motif – bachelardien – d’une co-naissance du sujet de et dans l’objectivité scientifique). Aussi le point d’accord avec Althusser sera-t-il désigné comme « une certaine urgence de reposer autrement la question du sujet » dont le thème directeur était sans doute : « Est-ce qu’au fond une science ne pourrait pas être analysée ou conçue […] comme un rapport tel que le sujet soit modifié par cette expérience ?5 ». Critiquer le sujet classique, le déconstruire pour identifier les modalités pratico-discursives de sa production, ce geste trouvait son lieu d’élection dans une mise en question historique (matérialiste) de l’historicité du savoir ; ceci parce qu’un tel geste, loin de se résoudre en une coquetterie formaliste, devait trouver son point d’achèvement dans d’autres expériences possibles du rapport sujet/savoir. Si les pages précédentes ont mis en évidence la matière première théorique exploitées par les auteurs de l’Esquisse lors de leur mise en question des privilèges du sujet, on comprend désormais pourquoi l’objet premier d’application de leur « épistémologie matérialiste6 » fut une « économie restreinte des savoirs ». Il faudrait pour vraiment fonder ceci mener systématiquement le parallèle suggéré entre Althusser et Foucault. Ne pouvant réellement m’y consacrer dans les limites de cet article, je me bornerai à indiquer les lieux textuels et conceptuels à partir desquels ce travail devrait être mené.
a) Pensée et idéologie
4Le point de départ obligé est donc l’insistance commune d’Althusser et Foucault à offrir une définition neuve de la « pensée » pour l’interroger en direction de ses conditions de possibilité proprement historiques, de ce que comme telle elle rend pensable et, corrélativement, de ce qu’en creux elle désigne comme impensable. Il s’agit, au fond, de penser moins la pensée comme faculté intime d’une subjectivité transcendantale principielle et fondatrice que les conditions socio-historiques qui déterminent la pensée comme matérialité, la distribuent en pratiques et en discours, découpent un champ du pensable et, partant, délimitent les positions possibles d’effets de subjectivité. Pour Althusser, le texte de référence est à chercher dans le chapitre introductif de Lire Le Capital :
La « pensée » dont il est ici question, n’est pas la faculté d’un sujet transcendantal […]. Cette pensée est le système historiquement constitué d’un appareil de pensée, fondé et articulé dans la réalité naturelle et sociale […]. C’est ce système défini […] qui assigne à tel ou tel sujet (individu) pensant sa place et sa fonction dans la production des connaissances […]. C’est cette réalité déterminée qui définit les rôles et fonctions de la « pensée » des individus singuliers, qui ne peuvent « penser » que les « problèmes » déjà posés ou pouvant être posés […] [L]a pensée est un système réel propre, fondé et articulé sur le monde réel d’une société historique donnée.7
5Ce point fait directement écho à la théorie de l’épistémè de Foucault, définie comme « ce qui, dans la positivité des pratiques discursives, rend possible l’existence des figures épistémologiques et des sciences » pour une formation historique donnée.8 Plus généralement, Althusser rejoint ici les « systèmes de pensée » dont Foucault se proposait d’étudier l’histoire, et que Jules Vuillemin caractérisait comme « formations pluralistes et contingentes » qui « assignent un cours réglé quoique non immédiatement visible aux pratiques et aux spéculations des hommes9 ». La « pensée » n’est à chaque fois que « le jeu des déterminations matérielles, des règles de pratiques, des systèmes inconscients, des relations rigoureuses mais non réfléchies » qui réserve « une place déterminée et vide10 » où un individu quelconque trouve le lieu de son devenir-sujet. D’une formule, « éliminer le sujet en gardant les pensées », le programme que Vuillemin désignait en 1969 comme celui de Foucault, paraît exactement valoir pour Althusser.
6J’ajoute que ce point de départ devrait être exploré en prenant garde à deux choses. Premièrement à la méthode selon laquelle est investiguée la « pensée » (soit selon un mode kantien hétérodoxe) : il s’agit toujours – suivant l’expression d’Althusser – de rompre avec « une théorie analytico-téléologique » pour demander aux concepts quels sont leurs « titres théoriques » et éprouver leur légitimité11 (comme Foucault le fait par exemple avec les notions d’œuvre ou d’auteur) ; ce qui implique d’interroger un ensemble discursif non selon les catégories d’influence ou de filiation, mais comme un système – ou « un tout réel » (Althusser) –, auquel il faut poser la question de son unité, laquelle réside « dans le système [pratico-discursif] qui rend possible et régit [sa] formation12 ». Deuxièmement, cette subordination du sujet de la pensée au profit de la pensée comme pratique matériellement déterminée dans l’élément de l’histoire permet de comprendre qu’Althusser, comme Foucault, rompe avec la problématique transcendantale de l’origine pour faire apparaître celle d’un Beginn strictement empirique13 – c’est dire qu’« on ne choisit pas son commencement14 » ni la nécessité de sa contingence.
7Soulevant le thème althussérien de la pensée, convoquant également Foucault, c’est un passage de l’article « Sur le jeune Marx » qu’examine pour sa part É. Balibar, passage dans lequel ce concept de « pensée » fait directement signe vers ceux d’« idéologie » et de « problématique » : « Il faut aller jusqu’à la présence de la possibilité de ses pensées : jusqu’à sa problématique, c’est-à-dire jusqu’à l’unité constitutive des pensées effectives qui composent ce domaine du champ idéologique existant, avec lequel un auteur singulier s’explique dans sa propre pensée15 ». Le lieu de la possibilité du pensable est chez Althusser immédiatement rabattu sur celui de l’idéologie. « Ne pas choisir son commencement » signifie que tout effort de pensée (scientifique ou philosophique) s’arrache sur fond d’un champ idéologique lui-même en rapport avec le champ social de la production dans son ensemble : le champ idéologique, dans une profonde inconscience de soi, détermine en lien avec un ensemble de problèmes réels une problématique fondamentale et obligée qui l’unifie, et dans laquelle une pensée neuve creuse ses propres problèmes, en un écart valant pour conquête, jamais achevée, d’un terrain nouveau, où l’idéologie apparait comme telle. Pour sa part, Foucault use du concept d’idéologie de façon plus restreinte, dans un sens proche de Canguilhem16. Il lui assigne une fonction spécifique dans son rapport à la science, comme élément constitutif du savoir pour une formation historico-discursive.17 Reste qu’apparaît dans les deux cas le fait que penser est d’abord penser dans un certain milieu spécifiant le pensable qui lui-même demeure non pensé ; et que la science, la philosophie ou l’archéologie s’introduisent dans cet élément comme autant de fissures, de ruptures.
b) Discontinuité et écart
8Il faudrait donc sur cette voie faire toute sa place au concept de discontinuité et, plus spécifiquement, à ceux de « rupture » ou de « coupure » (épistémologique). Foucault lui donnait sa pleine amplitude, à nouveau dans l’introduction de L’archéologie du savoir : la discontinuité, « à la fois instrument et objet de recherche », ne peut être « simplement un concept présent dans le discours de l’historien » puisque celui-ci « en secret la suppose » ; et de fait, « d’où pourrait-il parler […] sinon à partir de cette rupture18 » ? Je ne peux pas rentrer dans le détail des variations infligées par Althusser à la notion bachelardienne de « rupture épistémologique »19, ni aux déplacements conjoints qui affectent celle-ci et celle d’idéologie, l’idée d’une « coupure continuée » équivalant peut-être finalement à celle d’une « coupure impossible20 ». Je me contente d’indiquer que dès Lire Le Capital, Althusser relativise l’intérêt des notions de (dis)continuité (« qui résument le plat mystère de toute histoire ») en s’appuyant paradoxalement sur Histoire de la folie et Naissance de la clinique21 ; si bien que ce que Foucault écrit en général de la discontinuité (« instrument et objet ») paraît à bien des égards correspondre à ce qu’Althusser nomme plus précisément rupture : c’est une telle coupure qu’il opère dans le continu de son propre champ discursif, c’est elle dont il produit la théorie et qu’il utilise comme instrument pour lire Marx, c’est elle aussi qu’il repère chez ce dernier comme site primordial – la coupure est bien ce qu’il doit supposer et effectuer pour tenir son propre discours. Comment s’étonner dès lors que la « discontinuité » soit ce qui prescrive à l’archéologie de « penser la différence » et à l’épistémologie althussérienne du marxisme de faire apparaître des « différences spécifiques »22 ?
9Plus largement, ce dont sur ce point il conviendrait de dresser la comparaison systématique, ce sont deux styles de la pensée (de la pensée même) ordonnés au motif de l’écart – « au double sens de distance et de décalage », comme l’écrivait Canguilhem23. On peut définir ce que Foucault nomme à la fin de sa vie « travail critique de la pensée sur elle-même24 » comme l’écart que la pensée introduit à l’égard d’elle-même, dans la matérialité de son histoire, de façon à faire apparaître sa propre historicité au titre de problème. « Torsion et […] redoublement », « issue et […] ressaisie de soi-même »25, l’écart critique – auquel s’ordonne la possibilité même de l’histoire de la pensée telle que pensée par Foucault – n’est rien d’autre que ce qu’il nomme « problématisation »26. Plusieurs voies de recherche s’indiquent à ce point : une comparaison minutieuse des notions de problématisation chez Foucault et de problématique27 chez Althusser ; une interrogation conjointe de leur notion respective de critique ; une attention spéciale à leur propension à l’autocritique28, essentielle à l’économie de leurs pensées. On toucherait là à ce qui fonde toute rencontre de concepts d’Althusser à Foucault, au nerf commun qui les noue : l’écart à soi de la pensée chez Foucault, comme décalage et prise de distance, n’est rien d’autre que la fonction qu’Althusser assignait à la philosophie, le tracé d’une « ligne de démarcation » pour autant que celle-ci « n’est même pas une ligne, pas même un tracé, mais le simple fait de se démarquer, donc le vide d’une distance prise29 ».
c) Travail critique et réflexion
10Mais ne pourrait-on aller encore plus loin et suggérer que ce qu’Althusser, dans le cadre de son analyse du procès de la pratique théorique, désigne sous le nom de Généralité I, II et III puisse offrir le modèle formel (en forme d’analogie fonctionnelle) du mode même sous lequel s’opère le « travail de la pensée » à suivre Foucault ? Althusser décrit la production d’une connaissance scientifique selon trois instances : Généralité I est la matière première théorique – soit idéologique, soit correspondant à un certain état de la science – qui sera spécifiée ou déterminée au titre de connaissance scientifique, c’est-à-dire au titre de Généralité III, à la condition d’être l’objet d’un travail de transformation, où s’élabore dans la forme d’une « théorie » la critique de Généralité I. Ce travail de « transformation » est ce qu’Althusser nomme Généralité II30. Or celle-ci, c’est le point essentiel, ne peut pas consister dans le simple développement de la matière première théorique. La différence entre ce qui travaille et ce qui est travaillé est fondamentale : il y va bien, de l’un à l’autre, d’un mouvement d’écart ou de rupture – on dira que « quand la Généralité II travaille sur la Généralité I, elle ne travaille jamais sur elle-même31 ». Si elle était appliquée à certains énoncés de Foucault, l’idée d’une autonomie, voire d’un « primat », du travail de rupture transformatrice, posée par Althusser, permettrait, en l’autonomisant résolument, d’isoler pour mieux le saisir selon son mouvement singulier, « le travail critique de la pensée sur elle-même ».32 On trouverait que ce travail sur soi s’opère, à la lettre, sur l’autre de la pensée, soit sur ce qui en elle demeure non pensé : ce qui relève des limites et de l’au-delà de ce qui est pensable en un point de l’espace social et un moment du temps historique donnés.
11
12Sans compter que ce dernier point donnerait à coup sûr de quoi penser le spinozisme (avéré) d’Althusser en accord avec celui (masqué) de Foucault, il faut encore attirer l’attention sur un dernier élément : partons de l'obstination avec laquelle celui-ci définit dans ses derniers textes le travail de la pensée comme un travail de réflexion33. Ce qui précède quant au thème du sujet impose que cette « réflexion », si elle s’avère liée à un lieu du subjectif, ne puisse en aucune façon être rabattue sur une figure du sujet définie essentiellement par l’instance de sa conscience – au plus loin, donc, de l’identification kantienne de la Bewusstsein et de l’Überlegung. Peu de commentateurs se sont affrontés à ce qui constitue une des pensées les plus difficiles de Foucault ; je ne vois que Matthieu Potte-Bonneville pour signaler l’importance de « ce processus réflexif qui peut être dit, à la fois, "sans sujet" et subjectivant34 ». On pourrait peut-être préciser une telle réflexion de la pensée dans son histoire (au deux sens du génitif) au voisinage d’un Bourdieu. Un tel concept de la réflexion est constamment présupposé par Althusser lors de sa première élaboration du concept de « surdétermination ». La complexification de la contradiction dite « principale » entre Capital et Travail au regard des contradictions multiples [superstructurelles, (trans)nationales] qui l’affectent et la font apparaître comme « déterminante mais aussi déterminée » la qualifie, précisément, comme « surdéterminée »35. Mais, au sens le plus strict, la surdétermination est la réflexion de ces procès divers au sein de la contradiction elle-même, réflexion effectuée en rapport avec la structure globale et complexe du tout du mode de production. Elle est, d’un mot, « la réflexion, dans la contradiction même, de ses conditions d’existence, c’est-à-dire de sa situation dans la structure à dominante du tout complexe36 » : on conçoit qu’aucune conscience n’en soit le sujet. Et on pressent peut-être, qu’incidemment, Althusser offre de quoi éclairer un point difficile mais central de l’œuvre de Foucault.
d) Temporalité, totalité et politique
13 L’ébauche qui précède mériterait à tout le moins d’être reprise systématiquement. Car à la vérité les thèses d’Althusser et de Foucault se complètent utilement. Foucault complexifie la pensée d’Althusser en prolongeant leur critique commune de la catégorie classique de sujet : elle l’ouvre à une pensée différentielle des modes de constitution de l’individu en sujet, et à une description minutieuse des pratiques discursives et de leur pivot, le travail sur soi. Mais certaines thèses althussériennes seraient aussi nécessaires à la cohérence épistémologique et peut-être politique de la pensée de Foucault. Je le montrerai en partant du problème de la temporalité historique.
14À la suite, notamment, des historiens de l’École des Annales, l’archéologie foucaldienne rompt avec la représentation classique d’une temporalité historique linéaire, continue et homogène : elle met en évidence, d’une formation pratico-discursive à l’autre, l’existence de temps multiples, au développement autonome et aux croisements hasardeux. Ainsi voit-on que les ruptures qui scandent l’histoire du savoir telle qu’exposée dans Les mots et les choses ne recouvrent pas celles mises au jour par l’histoire de l’esthétique picturale – le principe épistémique de la représentation, leur pivot à toutes deux, n’est en effet pas destitué au même moment : au début du XIXe siècle, à suivre l’archéologie du savoir, un siècle plus tard, pour une archéologie de la peinture37. Un des enjeux de L’archéologie du savoir est de montrer que l’émiettement du temps de l’histoire en séries de temps distincts n’est pas le dernier mot de Foucault : il tente d’établir la nécessité de nouer ces temporalités disjointes, de tracer « des séries de séries ». C’est, pour l’archéologie, le niveau d’une « histoire générale38 » : « La description archéologique des discours se déploie dans la dimension d’une histoire générale ; [...] ce qu’elle veut mettre au jour, c’est ce niveau singulier où l’histoire peut donner lieu à des types définis de discours, qui ont eux-mêmes leur type propre d’historicité, et qui sont en relation avec tout un ensemble d’historicités diverses39 ». Mais est-on certain que Foucault sur ce point satisfasse à ses propres réquisits ? Ne doit-on pas reconnaître que le niveau d’une « histoire générale » ne fera jamais l’objet d’une élaboration théorique rigoureuse dans son travail, pour autant même qu’elle y soit un jour à nouveau évoquée ?
15Il faut ici se souvenir du chapitre qu’Althusser consacre dans Lire Le Capital à une « Esquisse du concept de temps historique ». À le suivre, la perspective de l’histoire des Annales, pour nécessaire qu’elle soit, est insuffisante : il ne suffit pas de constater « simplement qu’il y a différents temps dans l’histoire40 » et de les juxtaposer ; il faut certes reconnaître l’autonomie de différentes temporalités dans l’histoire, mais il faut encore voir qu’elles ne sont que « relativement autonomes41 ». Il importe en fait de les ramener à un certain concept du tout social, d’une totalité systémique. Ce qui doit servir de point de départ à la réflexion, ce n’est pas la pluralité des temps, c’est « la structure spécifique de la totalité » : « La structure du tout doit être conçue avant tout propos sur la succession temporelle42 ». Mais, demandera-t-on, quel est ce tout, et comment doit-il être pensé ? La réponse d’Althusser est qu’il s’agit d’un tout structuré selon une unité complexe dont les diverses instances sont elles-mêmes inégalitairement structurées – on retrouve le concept de surdétermination, où la contradiction proprement économique, d’être médiée par d’autres types de contradictions, n’apparaît déterminante qu’en « dernière instance ».
16 Défini par Althusser comme « tout complexe structuré à dominante » et toujours déjà donné, ce concept marxien du tout ne trouve à mon avis pas d’équivalent chez Foucault : il est notoire que sa pensée ne se réglera jamais sur la belle sentence selon laquelle « la seule aventure, […] c’est contester la totalité43 ». Pourtant, suivant Althusser, seul un concept de la totalité permet de rendre compte des différences spécifiques de chaque temps historique. Il permet « de penser l’indépendance relative de chacune de ces histoires dans la dépendance spécifique qui articule les uns sur les autres les différents niveaux dans le tout social » et d’ainsi « les rapporter au concept de leur différence, c’est-à-dire à la dépendance typique qui les fonde dans l’articulation des niveaux du tout44 ». Sans l’idée de totalité complexe on ne peut penser ni ce « qui raccorde » ni ce qui varie entre ces temps. On aurait là – c’est à vérifier – une explication de la façon embarrassée dont l’archéologie traite les passages et ruptures (voir la récurrence des épithètes tels que « mystérieux » ou « énigmatique ») qui s’opèrent d’un épistémè ou d’une formation discursive à l’autre – c’est qu’il conviendrait toujours de les rapporter « comme autant de variations, à la structure du tout qui […] commande directement la production de ces variations45 ». Sans même interroger les figures éventuelles de l’invariant selon Foucault, on devine déjà que la conception althussérienne de la totalité paraît bien faite pour poser à nouveaux frais certains de ses problèmes épistémologiques. Mais il est aussi possible que ce point soit indispensable à un certain mode de pensée de la politique, que ne rencontrerait pas Foucault.
17 Deleuze concluait sa lecture de L’archéologie du savoir en repérant dans ses derniers développements « un appel à une théorie générale des productions qui doit se confondre avec une pratique révolutionnaire46 ». On sait que l’inoculation de la pratique dans le discours devait finalement déplacer Foucault vers le champ de la pratique en général envisagée sous le signe d’une analytique du pouvoir. La richesse de cette approche – qui constate l’impossibilité de désigner un lieu central ou dominant du pouvoir et, corrélativement, un site et un mode privilégiés d’opposition à celui-ci – a néanmoins pour contrepartie de se focaliser sur des foyers de résistance et de lutte toujours partiels (dits « micro-politiques »). N’est-ce pas alors le moment de se souvenir qu’à suivre Althusser le concept de « tout complexe structuré à dominante » n’est rien de moins que la condition préalable de toute prise politique, aussi bien d’un point de vue théorique (nécessité de la politique) que pratique (effectivité de la lutte). Je me contente de le citer : « Comment rendre compte de la nécessité de passer par le niveau distinct et spécifique de la lutte politique, si elle n’était […] pas […] le point nodal stratégique, dans lequel le tout complexe […] se réfléchit ? ». Qu’est-ce à dire, sinon que le concept d’une surdétermination du tout « implique une lutte réelle, des affrontements réels situés en des lieux précis de la structure du tout complexe »47, lesquels tendent au final à révolutionner la totalité du tout social lui-même ?
18Mais Foucault n’était ni communiste – sinon un fort bref moment (en 1950, en lien avec Althusser) – ni militant révolutionnaire, et la contestation du tout social lui paraissait moins urgente qu’un travail « micropolitique » – au reste très estimable – mené sur des objets de lutte partiels (prison, sexualité, etc.). Ce qui précède suggère toutefois qu’il ne serait pas inutile de réserver à L’archéologie du savoir, à partir d’Althusser, le même sort que celui fait par d’aucuns à Surveiller et punir à partir de Marx : démontrer la nécessité d’une conceptualité marxienne pour mettre en cohérence l’œuvre de Foucault avec ses énoncés épistémologiques et politiques les plus radicaux.48 Il est désormais avéré que nos deux auteurs se complètent utilement : les travaux de Foucault permettent de penser bien plus loin qu’Althusser les modalités les plus concrètes de production du sujet à titre d’être assujetti ; mais ce dernier lègue à Foucault ce qui lui manque, une conception de l’expérience dont les divers segments sont enfin liés dans le concept d’une totalité complexe.
4. Politisation et finitude (Balibar)
« Personne ne pense plus que la réalité d’une vie commune […] dépende de la mise en commun […] de cette sorte de crispation extatique que répand la mort49. »
19En cherchant en quelque sorte à débattre sur les conditions mêmes du débat, j’ai dégagé la constellation conceptuelle qui forme la matière première et la condition de possibilité théoriques de l’Esquisse considérée comme essai d’épistémologie matérialiste du sujet social de la connaissance. Le développement précédent nous autorise à en venir pour conclure au point (presque) final : la conception de la politique du subjectif qui s’induit des postulats théoriques de l’ouvrage.
20L’Esquisse s’appuie sur Foucault lorsqu’il pose qu’une « définition du politique » donnée a priori fonctionne comme « écran » à l’égard d’un ensemble de « mouvements » virtuellement porteurs d’une politisation nouvelle de l’expérience. C’est pourquoi « repolitiser le champ du savoir » signifie : laisser place aux « mouvements concrets (théoriques et pratiques) » qui comme tels et « immédiatement » constituent « une politisation réelle50 ». Je l’ai dit, la « politique » correspond en ce sens au mouvement même de déterminations réciproques d’une rupture dans l’expérience et d’une transformation du sujet. La politique n’est que la trajectoire d’une politisation portée par un sujet qui y trouve le lieu de sa spécification proprement politique. D’être immanente à la politisation, la politique paraît tautologique : est politique ce qui politise. Or l’Esquisse est à cet égard en parfait accord avec Foucault. La place de la politique est celle d’un entre-deux, où la transformation de l’expérience se renverse dans une transformation du sujet, et inversement : « L’analyse, l’élaboration, la remise en question des relations de pouvoir, et de l’"agonisme" entre relations de pouvoir et intransitivité de la liberté, sont une tâche politique incessante ; […] c’est même cela la tâche politique inhérente à toute existence sociale51 ». Transformation de soi entée sur la transformation du monde, trajectoire d’une contestation, mouvement d’une « remise en question » comme politisation de l’expérience, telle serait la politique. Mais à ce compte, en est-on quitte avec elle ? Peut-on tenir que la question de l’agir politique, de son sens (aux deux sens du terme) et de son contenu, se soutient simplement de l’auto-production d’un sujet (alors intégralement productif) entreprise à la faveur d’un déplacement des conditions improductives, c’est-à-dire habituelles, de la (et de sa) production ?
21L’article « Émancipation, transformation, civilité » d’É. Balibar donne à penser que non. À rebours de ce qui précède, son objet initial est la politique, objet théorique énigmatique qu’il convient d’affronter comme tel, afin de le problématiser et de mettre au jour les concepts nodaux qui l’articulent : « penser » la politique est un préalable indispensable si on veut l’agir, la « faire »52. Conformément à ce qui précède, le raisonnement s’inaugure de l’affirmation d’une autonomie absolue de la politique (au sens d’un travail d’émancipation collectif) accordée à l’affirmation d’une hétéronomie complète de la politique (car tout mouvement d’émancipation s’affronte à des conditions qui le déterminent) : en ce sens, la politique, mouvement absolu d’émancipation cependant relatif à un ensemble de conditions, est une transformation. En tant que telle, elle rencontre la question du sujet : si « tout concept de la politique implique un concept du sujet à chaque fois spécifique », on nommera alors « subjectivation », « l’individualisation collective qui se produit au point où le changement change53 ». Rien de tout cela ne doit nous étonner : on retrouve la contemporanéité (ou « immédiateté ») de la transformation du sujet et du changement dans l’expérience, précédemment identifiée comme la courbe même de la politique au sens de « politisation ». De fait, analysant le texte de Foucault sur lequel je viens de m’arrêter (« Le sujet et le pouvoir »), É. Balibar touche à ce point essentiel : chez Foucault, note-t-il, « la distance entre les conditions et la transformation est réduite au minimum : elles deviennent contemporaines l’une de l’autre ». On ne pourrait mieux dire. Il insiste pourtant sur « l’aporie54 » qui grève pareille position, au moins si celle-ci ambitionne de dire le tout de la politique ou d’en faire la condition de possibilité de la « tâche politique » proprement dite. Établir que la production du sujet est à la fois la norme d’une expérience donnée (au sens d’un assujettissement) et le risque qu’affronte toute expérience (au sens d’une dé-subjectivation possiblement porteuse d’une subjectivation nouvelle) ne permettrait pas d’agir une politique, ainsi qu’en témoignerait chez Foucault « l’oscillation latente entre un fatalisme […] et un volontarisme de fait55 ».
22Penser la politique proprement dite ce sera alors penser l’hétéronomie de l’hétéronomie de la politique56. Mais tel paraît être le niveau de la réflexion (et de la pratique) que n’affronte aucun des auteurs rencontrés jusqu’à présent. Il s’agit maintenant de penser ce qui vient après la « politisation », ce qui inscrit matériellement et symboliquement dans le temps, dans l’espace, dans l’identité, le déplacement auquel le partage initial du politique et du non politique a été soumis, soit le sens d’un agir politique irréductible à l’auto-production du sujet politique qui défaisait les conditions de sa production habituelle à l’occasion d’une transformation de et dans ces conditions mêmes. Notons qu’à suivre É. Balibar cette question, pour être correctement posée, suppose que soit re-pensée la condition d’universalité du mouvement émancipation/transformation, de l’inscrire sous un concept de la « civilité » et, malgré tout, peut-être, dans la forme d’un État.57
23La subjectivation politique ne pourrait en tout cas pas être réduite à un pur mouvement d’émancipation qui s’oppose pour les transformer aux limites ou conditions qui le déterminent, fût-ce au gré de leurs propres transformations. Ce qu’indique É. Balibar est la nécessité de penser quelque chose qui du sujet politique ne soit pas réductible au strict mouvement de politisation, ce qui du sujet reste par-delà elle, ou lui résiste. Il s’agit pour lui de souligner l’insuffisance de ce qu’il identifie comme l’essence même de la politique marxienne (qui sans doute paie par là son tribut à l’idéalisme allemand) eu égard à son orientation non utopique, soit le communisme tel que L’idéologie allemande en donne la définition, « mouvement réel qui abolit l’état existant », définition « la plus sobre », car purement négative, à laquelle selon lui se rattache aussi Althusser (« par sa critique radicale des schèmes de la périodisation et de la transparence58 »), et à laquelle il est clair que J. Rancière et A. Badiou continuent en dernière analyse de souscrire. Ce à quoi conduit alors Balibar n’est rien d’autre que l’exigence de penser l’aporie de la politique ainsi conçue, d’une part, et le rapport de la subjectivation politique en général à quelque chose que nous devons bien nommer « finitude », de l’autre.
24 Aporie n’est pas inanité : « aporétique » se dit chez lui d’une pensée ou d’une pratique à la fois nécessaire et impossible et ouvre à leur problématisation à nouveaux frais59 – emblématiquement, quand il se résout en une « politisation », le concept de subjectivation politique sera dit « aporétique ». Ce concept est nécessaire, d’abord de ce qu’il rompt avec toute orientation utopique de la pensée pour se brancher « immédiatement » sur les rapports de forces actuels. Il est ensuite nécessaire, de ce qu’il brise l’idée que la politique serait la gestion d’un état de fait ou d’un État donné, l’organisation d’une domination par la détention du monopole de la violence légitime, ou une réflexion sur les moyens du bon gouvernement, le meilleur régime, la constitution idéale. Il est nécessaire, enfin, parce que de sa radicalité il défait par indifférence deux objections : d’abord celle – dite « sociale-démocrate » – selon laquelle la politique, comme mouvement de transformation/émancipation doit à sa source être fondée, et qu’elle doit se donner pour horizon la conformité maîtrisée à un programme établi a priori ; ensuite celle – dite « anarcho-gauchiste » – selon laquelle ce mouvement doit ouvrir à la réconciliation infinie de l’humanité avec elle-même. Mais de reprendre tout à la racine, d’être aussi pur que le vide de la négativité même, ce concept se signale aussi comme impossible. Il n’enveloppe en effet aucune thèse sur la discipline, l’organisation ou la représentation, sur le problème du régime et de sa définition (qu’est-ce que le communisme, qu’est-ce que la démocratie ?), sur l’usage de la violence, ni sur la question de la fondation (fût-ce pour y découvrir un abîme) ou celle de la finalité (même pour la dire « sans fin ») : il ne dit rien, enfin, ni des tensions irréconciliables qui parasitent toute subjectivation, ni de la mortalité qui l’habite.
25Cependant, de toucher à l’impossible, la subjectivation politique en son aporie nous ouvre à ce qui apparaît, pour finir, comme le point décisif : la pensée de sa finitude. É. Balibar repère ce dernier thème d’abord chez Althusser. Si la question de la politique marxienne est par excellence celle de savoir « comment rompre de l’intérieur avec le courant même de l’histoire », la réponse proprement communiste est animée d’une tension certaine : « Il faudrait que le communisme soit à la fois un "mode de production" défini, et la "destruction" universelle, infinie, de toutes les formes de la sujétion humaine ». Cette tension s’interprète de multiples façons : É. Balibar en prend occasion pour opposer Althusser à Lukacs. Si Histoire et conscience de classe insiste selon lui sur une désaliénation totale où le prolétariat, Sujet de l’histoire, de ce qu’il est conscience pratique de faire cette histoire, peut éclore à lui-même comme pure et transparente conscience de soi, il apparaît en revanche que pour Althusser « la pratique […] est à jamais irréductible à la conscience » – et la thèse selon laquelle l’idéologie persévérerait dans une société sans classe est bien faite pour conclure à une « limitation structurale » ou une « finitude »60, à « l’existence de limites intrinsèques à la connaissance et à la politique61 ».
26É. Balibar précise sa pensée dans un texte fondamental, déjà mentionné, intitulé « Les universels ». Celui-ci propose d’analyser l’équivocité dite « constitutive » du concept d’universel. Il distingue trois acceptions : l’universel réel (effectivement réalisé sous la forme « mondialisation »), l’universel fictionnel (norme hégémonique de l’humain en fonction de laquelle le petit d’homme, d’y souscrire, devient sujet, et plus précisément sujet « normal »), enfin l’universel idéal. L’universel idéal se manifeste lorsqu’un sujet revendique le droit d’un devenir-sujet a-normal particulier (exemplairement le mouvement féministe) et que cette revendication est proférée dans la forme d’une exigence d’égalité et de liberté absolues, c’est-à-dire lorsque ce droit, quoique essentiellement lié à une situation spécifique et non pas générique, s’assigne pour seule forme possible une liberté valant sans exception pour tous (c’est ce qu’É. Balibar nomme une revendication d’« égaliberté »). En ce sens, le spectre d’une universalité idéale hante tout universel fictionnel normalisant : il est à sa fondation, puisque tout ordre naît historiquement et ontologiquement d’un désordre (c’est ce que Kant savait autant que Canguilhem), mais il est ce que ne peut que refouler ou dénier l’imposition durable de l’universel comme fiction62. Reste que l’émergence de l’universel idéal va toujours de pair avec l’introduction de « la notion d’un inconditionné dans le champ de la politique63 ». On le voit : c’est en fait la politique comme pure émancipation (dans son autonomie rigoureuse) que nous retrouvons ici placée au fondement de l’hétéronomie de la politique. Mais ce n’est pas tout. Certes, la politique transformatrice se soutient d’un inconditionné, l’exigence d’égaliberté, qui est « en elle-même infinie », et qui renvoie « la subjectivité [à] sa propre "infinité" »64 ; pour autant, cela ne signifie pas que les expressions multiples de l’universalité idéale doivent s’accorder ou s’unifier (et d’expérience on sait bien que ce n’est pas le cas) : c’est qu’il faudra toujours reconnaître « un trait de finitude affectant la constitution même de l’idéal d’humanité ». L’unité ou la consistance de la politique – soit ce que je nommerai sa subjectivation proprement dite, l’après-coup (nachträglich) du pur geste de dé-subjectivation – ne peut se déduire du mouvement de l’histoire ou des transformations réciproques de l’expérience du sujet et du sujet de l’expérience : « elle doit être construite »65. Pour le dire nettement, l’autonomie de la politique, son impulsion émancipatrice, la source de toute transformation des conditions de son hétéronomie s’indexe toujours sur un passage à la limite, une percée vers l’infini ; mais l’hétéronomie de l’hétéronomie de la politique, où l’action politique trouve les lieux matériels et symboliques de son développement consistant, bute directement sur le problème de sa finitude. Si la subjectivation politique procède bien d’un passage à l’infini, elle culmine à dire vrai dans l’épreuve de sa finitude – c’est là son risque et sa chance, au moins si l’on parvient à penser cette finitude dans sa positivité même.
27 É. Balibar compris, la subjectivation politique, dans son premier geste de dé-subjectivation – soit la politique proprement dite comme effort de « politisation », effraction de l’égalité dans une situation de mésentente, procédure collective de pensée à la grâce d’un événement singulier, mouvement absolu/relatif d’émancipation/transformation, etc. – renvoie primordialement toujours à quelque chose de l’ordre de la négation : du motif de la soustraction à celui de destruction, l’ensemble des philosophèmes envisagés ici, de ce qu’ils articulent l’idée d’une modification transformatrice (vers plus de liberté, d’égalité, de puissance commune, etc.) de l’expérience du sujet (individuel ou collectif) à la faveur d’une modification de et dans son expérience, font bien prioritairement signe vers un travail du négatif – c’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la fortune actuelle des recours à Hegel (lacanisé en proportions variables) dans la pensée philosophique de la politique réputée radicale (de J. Butler à A. Badiou). La subjectivation politique émerge à même une dé-formalisation – un décrochage, un décollement – des conditions qui déterminent les formes habituelles de l’identité subjective, et commence donc par l’expérience d’un dés-assujettissement. Sur cette base générale commune, chacun y va naturellement de sa particularité théorique. En s’attachant à la façon dont les uns et les autres d’une part réfléchissent le lien d’une subjectivation politique à la limite – ou conditions (sociales) – qui la détermine et, d’autre part, plus généralement, se rapportent au thème de la finitude ou de la mortalité, on pourrait peut-être, sous les deux noms propres cités à l’instant, distinguer deux paradigmes actuels de la philosophie de la politique d’émancipation quand elle se règle sur le concept de subjectivation.
5. Vers une politique d’après la finitude
28J. Butler serait alors l’archétype d’une définition de la politique comme rapport de subjectivation « spasmodique » à ses limites et conditions. Tout le problème de J. Butler est de trouver un mode de mise en question de la loi – qui, en l’assujettissant, fait de l’individu un sujet – restant compris dans les limites de cette loi (sans quoi il y aurait purement et simplement perte de l’identité, ce qui ne serait pas exactement viable). D’où son insistance sur les phénomènes de déplacements et de retournements parodiques (de catachrèse), entrepris aux limites de la loi, lesquels sont toujours marqués d’une insondable mélancolie, et portés par un travail de deuil interminable, liés à la perte de l’objet primordial du désir sur laquelle fait fonds le procès d’assujettissement. Pour le dire brutalement, penser des normes limitatives (au dehors toujours plus intime) occasionnant par leur bougé un bougé des positions subjectives qu’elles produisent, selon un mouvement de contestation qui ne peut être qu’intérieur à cela même qui est contesté, aboutit sans doute à une pensée de la résistance exactement coextensive à ce qui la contraint, et confortablement assurée d’aujourd’hui ne pas se soumettre à ce qu’elle acceptera mieux demain66. La position d’un Badiou paraitra par contraste séduisante. Celui-ci ne renonce certes pas à penser la subjectivation politique sous conditions, à médier son autonomie absolue d’une hétéronomie radicale : il n’y a de politique que pour autant que l’éclair d’un événement singulier strie et bouleverse un état de chose donné, et qu’il laisse dans son sillage la trace d’une vérité dont un corps, qui en est d’abord saisi, va témoigner dans un monde, de ce qu’il décide de lui être fidèle, de le traiter point par point en ses conséquences. Dans le système d’A. Badiou, cette dimension d’un certain « subir », qu’on dirait essentiellement nécessaire à une décision active ultérieure, va de pair avec une méditation sur l’échec des événements politiques récents (de la Commune de Paris à la Révolution Culturelle). Cependant, le rapport d’une subjectivation politique aux limites qui le spécifient est d’une négativité nettement plus radicale que dans le cas précédent : elle brise et bouleverse, ouvre à une révolution des conditions habituelles qui forment la limite d’une situation donnée, à une transgression qui n’a plus rien d’interne à leur système – rapport non plus spasmodique, mais d’insurrection. En ce sens, le sujet parvenu à ce point vit selon Badiou « en immortel » : il s’expose à l’éternité des vérités et déclare inessentiel la dimension mortelle qui lui échoit en tant qu’être naturel (animal humain). La politique est donc toujours d’« après la finitude », et celle-ci n’est que le thème d’élection du « matérialisme démocratique », le supplément d’âme malheureuse du capitalisme parlementaire qui toujours réduit l’humain à sa nature biologique – là contre, une pensée des vérités politiques affirme sans fausse pudeur, avec joie sans doute, les droits de l’absolu et de l’infini sur la pensée et l’action67.
29Ces deux paradigmes – que je caricature quelque peu afin de les faire fonctionner comme tendances idéaltypiques de la pensée philosophique actuelle de la politique – ont été justement critiqués par d’autres.68 Si l’on me permet de tenter d’articuler un sentiment, je dirais que l’exigence d’absolu constitutive de la politique en général n’autorise pas que soit déniée ce que je nommerai (par antiphrase) le Faktum de sa finitude ; et que le capitalisme de cette saison – système-monde sans dehors – n’impose pas d’en rabattre sur les exigences impossibles et inconditionnées. Nous retrouvons ce qui était avancé plus haut : penser l’hétéronomie de l’hétéronomie de la politique, l’agir politique logé dans l’après-coup du mouvement de politisation, est non seulement faire droit à un inconditionné, au tracé d’un infini que marque aux limites d’une situation tout procès d’émancipation, mais également envisager comme problème la finitude de ce procès lui-même et mettre en débat la mortalité qui fatalement le hante. Escamoter ce dernier point, ce serait penser trop court : quoi qu’on en ait, rabattre l’agir politique sur une production de politisation est accepter de s’absorber dans la contemplation fascinée d’une négativité pure – c’est faire l’impasse sur la problématisation et la construction des conditions d’institution possible d’un nouvel ordre de positivité. Par hypothèse, disons qu’une voie possible de réflexion serait de penser la détermination proprement politique de ce que Foucault, à la suite notamment de Bataille et du motif de la « transgression », identifiait comme « épreuve de la finitude69 » – à proximité d’un certain Kant (et de Sade), plutôt que de Hegel. Afin de plier l’origine littéraire de ce thème en direction d’une détermination politique possible, je suggérerai de le penser en rapport avec trois autres propositions.
30D’abord avec l’idée d’« un communisme de la finitude », telle que l’avance André Tosel. Prenant son point de départ dans « la critique des limites et des apories de la critique marxienne70 », sans rien cependant céder de ce qui d’elle est aujourd’hui requis pour critiquer le système-monde capitaliste, cette perspective s’arc-boute sur une conception de la « finitude positive » d’inspiration spinoziste, selon laquelle « il est possible à l’homme mode fini de conquérir des degrés de puissance », de les mettre en commun, et d’ainsi « se libérer sans pour autant espérer coïncider avec la causalité infinie de la nature71 ». Le premier point théorique sera alors de renoncer à penser l’au-delà du Capital sous les espèces d’une téléologie infinie ou d’une maîtrise intégrale de la production – le « communisme de la finitude » positive, ce sera précisément ce qui permet aussi bien « de conjurer le fantasme de la maîtrise » que « de ne pas fétichiser comme condition finale ce qui est forme dépassable de servitude72 ». C’est-à-dire de détruire à l’horizon de la pensée et de l’action politiques toute forme de certitude, qu’elle s’apparente aux rêveries consolantes de l’infini ou aux ruminations sécurisantes du fini.
31On pourrait ensuite préciser le problème de la mise en commun de la puissance que conquiert le sujet sous l’idée de communauté désœuvrée telle que Jean-Luc Nancy a investiguée. Par-delà la « métaphysique du sujet », ce qui fait le commun, ce qui est en commun, ne peut qu’être la finitude elle-même, la mort, qui n’est rien de moins que la « vérité » de la communauté : il y a, par la mort, « révélation de l’être-ensemble ou de l’être-avec […] cristallisation de la communauté autour de la mort de ses membres, c’est-à-dire autour de la "perte" (de l’impossibilité) de leur immanence, et non autour de leur assomption fusionnelle dans quelque hypostase collective73 ». On le voit, entre Bataille et Heidegger (et partiellement contre eux), Nancy recoupe à un niveau presque ontologique les thèses directement politiques d’A. Tosel. La communauté désœuvrée des êtres finis retrouve bien, à son voisinage, dans la forme d’« une tâche infinie au cœur de la finitude74 », ce que nous venons d’identifier comme « finitude positive ». Selon la perspective de J.-L. Nancy, logée au fondement de la possibilité même de la politique75, elle sera l’expérience du partage du commun, de l’« en » de l’en-commun comme tel, une expérience en dernière analyse littéraire, qui se doit d’écrire et d’inscrire, de communiquer, la mort à l’œuvre que partage et qui partage la communauté : si « c’est l’être en commun qui est littéraire76 », le communisme de la finitude doit se dédoubler en un « communisme littéraire77 ».
32Enfin, on pourrait se demander si cette politique ou épreuve de la finitude résolument communiste, et d’essence littéraire, ne devrait pas être pensée en rapport avec l’économie des pulsions et des désirs telles que la psychanalyse la révèle. En tout cas, prenant acte du fait qu’un mouvement d’émancipation, un événement politique, est toujours porté par un désir qui est autre chose que le besoin de satisfaire les fonctions nécessaires à la reproduction biologique de l’animal humain, en un mot qu’« il [n’]y a politisation réelle […] [que] lorsque l’on quitte le plan des intérêts référés à la reproduction de la vie biologique pour passer sur le plan du désir », d’aucuns ont pu suggérer que la politique d’émancipation doit être pensée avec le Freud d’Au-delà du principe de plaisir, parce qu’elle a « quelque chose à voir, nécessairement, structurellement, avec la pulsion de mort78 ». Entendu qu’un sujet politique, à l’instar de l’organisme, « ne veut mourir qu’à sa manière79 », tout le problème, alors, sera de se hisser à la hauteur des conditions sous lesquelles un tel sujet renverse sa négativité constitutive en une positivité seconde, de trouver les ressources et les moyens de débattre collectivement la mort qui l’habite, pour l’écrire (communisme littéraire) et l’agir (communisme de la finitude), choisir le risque de l’inscrire durablement, matériellement et symboliquement, dans le temps, l’espace, la pensée et l’expérience.
33Les quelques hypothèses précédentes indiquent la décision de la pensée de ne pas déserter lorsqu’il lui faut réfléchir l’hétéronomie de l’agir politique que découvre, dans son après-coup, l’auto-production du sujet politique, lorsqu’il s’agit, aussi bien, de penser ce qui doit rester après la dé-subjectivation qu’ouvre la dé-formalisation d’un état de chose donné dans l’expérience, soit la subjectivation politique comprise dans la pleine positivité de sa finitude. Cette décision de ne pas flancher, qui est le point d’honneur de la pensée, révèle un champ d’investigation théorique et pratique qui s’ordonne toujours à ce point : l’expérience d’un passage au dehors témoignant de la frappe de l’impossible et de l’infini mais qui se sait, et qui dès lors se construit, en tant que finie.
Conclusion
34 L’aspect parfois aventureux ou hâtif de ce texte témoigne de son caractère d’essai et de recherche, et de son lien de dépendance directe à un événement ponctuel de la vie académique adressé aux étudiants. J’y ai trouvé une occasion de retracer la généalogie d’une certaine pensée actuelle du sujet politique, puis de l’interroger pour elle-même. D’où le résultat parfois ambigu de la recherche, à la fois récapitulatif et prospectif (voire programmatique). Plus que jamais en cours, elle est aussi, je l’espère, collective.
35 Que signifiait éclaircir les présupposés du petit livre qui a servi de pré-texte à cette recherche, mettre au jour sa matière première théorique et sa différence spécifique ? En fait tirer une ligne de force conceptuelle, allant d’Althusser à Foucault, ponctuée des noms de Rancière, Badiou et Balibar, dont l’unité tient à une certaine modalité commune de position de la question du sujet, la destruction de son concept classique (et la destitution corrélative de l’anthropologie et de l’humanisme philosophiques) se renversant en une enquête sur les conditions de la production et de la dépendance d’un sujet assujetti, laquelle pointe finalement la possibilité de subjectivations alternatives elles-mêmes indexées, d’abord et avant tout, sur un travail négateur de dé-subjectivation (déduite d’une dés-objectivation, d’une dé-formalisation des conditions normales de la production). Il m’a paru possible de montrer ensuite que le mode même de position de cette question était comptable d’une perspective spécifiquement épistémologique, telle que Foucault et Althusser l’ont chacun pour leur compte pratiquée, dans des directions à la fois divergentes mais peut-être aptes à se compléter, et qui, en tout cas, recoupent celle de l’Esquisse : étudier « la connaissance comme production » (Althusser).
36Au total, les figures du « sujet connaissant » qu’ébauche le livre me paraissent s’inscrire exactement dans le champ textuel, conceptuel et thématique que j’ai parcouru, qui lui prescrit sa condition de possibilité et donc aussi, peut-être, sa limite. Celle-ci m’a semblé se concentrer autour du concept de « politique » proposé. Identifié à un mouvement de « politisation de l’expérience », il correspond au moment de décrochage et de dé-subjectivation nommé à l’instant). Une étude des mêmes auteurs a indiqué qu’un tel concept de la politique, précisément, semble normalement impliqué par la déconstruction épistémologique du sujet classique du savoir : il pouvait apparaître comme leur culmination obligée. À la suite d’une recherche qui s’est risquée à poser un diagnostic d’homogénéité à propos du concept de politique commun à un certain mode de questionnement philosophique (d’obédience marxienne) du sujet, j’ai simplement tenté, à l’aide d’É. Balibar, d’articuler – d’inscrire – un sentiment d’insatisfaction éprouvé face à ce concept. Pour autant, l’idée d’une « épreuve politique de la finitude », problématisée entre marxisme et littérature, même si elle est peu de chose, me paraît ouvrir une voie à la réflexion, un site à partir duquel penser dans sa positivité un moment éminent de l’agir politique – je veux dire l’ouverture, dans son plein déploiement et sa plus grande puissance, au pli négateur du procès de dés-assujettissement, d’une subjectivation politique qui d’être finie serait surtout, pour un temps au moins, viable, et vivante.
37 L’évocation d’une « épreuve politique de la finitude » est encore terriblement vague. Je ne peux pour finir que proposer de la penser sous l’Idée de « subjectivation politique » et simplement esquisser la formule abstraite et générique de cette dernière : soit l’événement qui, à la condition de trouver de quoi subjectiver collectivement la règle de son autonomie, qui est aussi celle de sa finitude, crée de quoi s’instituer, sans rien céder ni sur son auto-position, ni sur la nécessité d’inventer sa norme propre. L’important est aujourd’hui « de promouvoir de nouvelles formes de subjectivité80 » : gageons que pour vague qu’elle soit, l’idée d’une subjectivation politique en forme d’épreuve de la finitude, d’assumer à sa guise une soustraction primordiale qui excède la logique du « retournement » et du « renversement »81, évitera à cette intuition de Foucault de ne renvoyer dans les faits (in der Tat) qu’à certains « exploits dérisoires dans une situation d’égarement82 ».