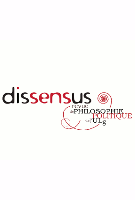D’un principe de justice à un standard d’efficacité : la rationalité régalienne à l’épreuve de la logique gestionnaire
Thibault Le Texier est doctorant en économie à l'université de Nice Sophia Antipolis. http://www.letexier.org/
Résumé
A partir du XVIe siècle, une rationalité régalienne charpente l’imaginaire gouvernemental européen. Tout en se structurant conceptuellement et pratiquement, notamment autour de l’administration du droit et de la justice par un État centralisé, cet art de gouverner régalien est travaillé par des éléments doctrinaux qui s’agrègent au XXe siècle pour former une rationalité gouvernementale nouvelle : la rationalité managériale, qui s’ordonne aux principes d’organisation, de planification, de contrôle, de comptabilité et d’efficacité. L’extension de cette nouvelle logique de gouvernement tout au long du XXe siècle participe de la désacralisation croissante de l’État. Durant les vingt dernières années, le pré carré traditionnel de la souveraineté s’est trouvé de plus en plus soumis à cette logique gestionnaire. Le glissement d’un critère décisionnel reposant sur le principe de justice à un standard articulé à l’impératif d’efficacité constitue un révélateur de ce changement de paradigme gouvernemental. Bien des explications tautologiques ont depuis entrepris de comprendre la progression de l’axiomatique managériale par son efficacité. A l’inverse j’entends ici indiquer comment et pourquoi le critère d’efficacité lui-même en est venu à supplanter les référentiels de jugement hier et avant-hier privilégiés, tels que l’ancienneté, la force, la bonté, l’égalité, la liberté, la légalité et la justice.
La rationalité régalienne
1On peut avancer sans trop se risquer que l’homme est un être grégaire, un animal social qui, sauf rares exceptions, tend à faire société. Suivant les temps, les lieux et les mœurs varient la forme et le fond des groupements qu’il compose. Et l’histoire humaine de déployer un étonnant bariolis d’institutions. La famille, la tribu, la cité, l’empire, l’Église, l’armée, la seigneurie, l’État, l’entreprise : chacun de ces groupes a imprimé son caractère aux sociétés qu’ils structuraient, leur cosmogonie et leur anthropologie propres articulées en valeurs, préceptes, règles et institutions secondaires.
2Le gouvernement est une pratique aussi vieille que contingente. De Solon à Berlusconi, gouverner a pu signifier commander une armée, administrer des biens, suivre un chemin, tirer une subsistance, guider un troupeau, commander quelqu’un, manipuler l’économie et l’opinion, garder un territoire ou encore entretenir une population. L’art de gouverner a été rapporté, entre autres pratiques, à la pratique du tisserand, à la tâche du berger, au magistère du dieu, à la responsabilité du maître de maison ou à l’autorité du père de famille.
3Durant le Moyen Âge, l’Église a puissamment structuré l’imaginaire collectif et les modes de vie des populations occupant l’Ouest du continent eurasien, disputant à la famille puis à la seigneurie et à la ville le contrôle des destinées humaines.
4Poussé sur le devant de la scène de l’histoire à la faveur des guerres de religion qui ensanglantent le XVIe siècle européen, l’État souverain de droit divin assoit progressivement sa logique gouvernementale. Du XVe au XVIe siècle, relève Michel Senellart, l’art de gouverner s’est ainsi déplacé « de la prudence habile du prince à la science, aussi grossière fût-elle encore, des conditions générales de la vie des États.1 » Le prince est englouti par la grande machine étatique. Les principes de son art de gouverner sont de moins en moins à chercher dans la Bible et font bientôt le sujet de manuels. Réceptacle des tâches de conduction progressivement arrachées à l’Église, à la famille et au seigneur – surveiller, punir, défendre, soigner, éduquer, savoir –, l’institution étatique est le catalyseur d’une nouvelle rationalité gouvernementale. Cette logique régalienne du pouvoir repose sur la concentration entre les mains d’un souverain unique d’une autorité suprême et naturellement bonne s’exprimant principalement par des lois à prétention universelle. Un tel art de gouverner consiste à maîtriser des forces : défendre son peuple contre l’envahisseur extérieur au prix si besoin d’une guerre, garantir l’ordre public en assurant l’application de la loi, veiller à sa propre prospérité en favorisant l’accroissement numérique de la population et la circulation des richesses au sein de son territoire. Il suppose donc le monopole de la violence physique comme moyen de trancher les conflits ainsi qu’une importante machinerie administrative. Les principes de légalité, de légitimité, de souveraineté et d’équilibre en constituent le socle symbolique. La justice est la valeur cardinale de cet imaginaire régalien. Michel Foucault avance même, un peu précipitamment, que « l'Occident n'a jamais eu d'autre système de représentation, de formulation et d'analyse du pouvoir que celui du droit, le système de la loi.2 »
5La forme étatique qui émerge en Europe au XIIe siècle est une création du droit. C’est un État essentiellement juge et juriste. Dans les faits, l’une des premières tâches des États européens naissant consiste à ôter des mains de l’Église les instruments de la justice. Par exemple, sous Philippe le Bel l’administration française tire ses principes directement du droit canon3. Dans les sociétés féodales, l’Église dispose d’un pouvoir justicier considérable, se substituant dans certains cas à l’autorité parentale. Ses tribunaux jugent les différends concernant les croisés, les veuves, les orphelins, les infanticides, les testaments, les héritages, les adultères, les délits d’usure ou encore les ruptures d’engagement, de contrat et d’obligation. Leur disputant ce monopole arbitral, les seigneurs féodaux ont bien souvent fait de la justice un droit inhérent à leur fief4. Débutée à la fin du Moyen Âge, la dynamique de sécularisation et de centralisation de la justice divine dure plusieurs siècles. Au milieu du XIXe siècle, Tocqueville fait remarquer que, moins d’un siècle auparavant, « chez la plupart des nations européennes, il se rencontrait des particuliers ou des corps presque indépendants qui administraient la justice, levaient et entretenaient des soldats, percevaient des impôts, et souvent même faisaient ou expliquaient la loi. » Il ajoutait que, depuis, « l’État a partout repris pour lui seul ces attributs naturels de la puissance souveraine5 ». Cette loi unique garantie par une hiérarchie unique de tribunaux excluant toute juridiction indépendante est un trait singulier de l’État moderne. Faire régner le droit et imposer la justice constituent deux de ses fonctions absolument essentielles et irréductibles ; la loi est l’instrument privilégié de son intervention sur la société.
6Très logiquement, la théorie du droit est utilisée par les penseurs médiévaux pour déterminer la légitimité des premiers États européens, qu’il s’agisse d’affirmer les prérogatives de l’État ou celles du citoyen. Le jus publicum, qui offre aux princes ses outils symboliques de légitimation et de gouvernement, constitue le pivot d’une science naissante de l’État. Hobbes a par exemple pour ambition, selon ses propres mots, de bâtir une « science » « de la justice et de la politique » (of Justice & Policy). Depuis, la pensée politique est restée dans une large mesure une réflexion sur le droit et la justice. On nous épargnera la fastidieuse illustration d’une telle évidence.
7À la fin du XVIIIe siècle, à mesure que les droits sont rapportés moins à Dieu qu’à l’homme, une légitimité politique s’affirme en lieu et place de la légitimité religieuse. Assujettissant la loi à un socle matériel, ce déplacement ratifie une conception du droit en termes d’intérêts et d’efficacité vieille d’au moins quatre siècles. Marsile de Padoue, parmi les plus éminents penseurs du haut Moyen Âge, rapporte par exemple la loi non plus à une morale supérieure ou à l’autorité théocratique mais à sa capacité d’être obéie. La loi est ainsi conçue par rapport à sa finalité et à son effectivité plutôt que par rapport à son origine ; elle est légitimée au titre de pouvoir coercitif et non en référence à la raison morale. Une telle intelligence infuse les théories de la souveraineté qui accompagnent la naissance et la structuration de l’État moderne.
8Cette interprétation de la légitimité étatique à partir du jeu des intérêts et du principe d’utilité est également défendue par Machiavel, Guichardin, les calvinistes, les rationalistes optimistes, les utilitaristes, les théoriciens de la Raison d’État, les caméralistes, les physiocrates, les jacobins, les socialistes utopistes, les positivistes et une majorité de libéraux. Selon Guichardin par exemple, « pour connaître quelle espèce de gouvernement est plus ou moins bonne, il ne faut considérer en substance rien d’autre que ses effets.6 » Pour les caméralistes, le « problème des pauvres » et l’objectif de plein-emploi répondent à l’exigence de supprimer les gabegies plutôt qu’à un impératif moral de charité. Les Lumières, dans leur enthousiasme procédural et technicien, imaginent une justice « absorbée par le droit7 », ainsi que le résument crûment Adorno et Horkeimer à un moment où la notion d’État de droit commence à épouser cet entendement instrumental de la loi. Pour Saint-Simon, l’humanité « a été destinée à passer du régime gouvernemental ou militaire au régime administratif ou industriel8 ». En ce sens, affirme-t-il à plusieurs reprises, « la politique est la science de la production9 ». Il est accompagné sur cette pente par une large majorité de socialistes et par Marx, pour lesquels l’État peut être pensé comme une entreprise corporative de production centrée sur l’exploitation rationnelle et finalisée des ressources matérielles et humaines soumises à son autorité. Si pour les caméralistes l’État a une économie, pour les socialistes il est une économie.
9Une telle conception utilitariste de la puissance publique s’est incarnée principalement dans le dominium féodal, les partis, les fraternités, les confréries, les guildes, l’Église catholique, la Genève du XIVe siècle, l’État de police, les colonies, les expériences de collectivisme distributif du XIXe siècle, l’État providence et bien entendu les grandes entreprises. De manière générale, le souverain européen ne s’est jamais complètement défait de l’héritage du dominium, du temps où le seigneur était avant tout un suzerain en charge de la gestion d’une propriété terrienne.
10Ainsi que l’a résumé Eric Weil, « le conflit entre la justice et l’efficacité se présente sous d’innombrables formes : ordre contre liberté, réalisme contre idéalisme, raison d’État contre morale, rendement social contre égalité des conditions, intérêt contre fraternité, etc.10 » Ce conflit reste surdéterminé, du XVIe siècle au début du XXe, par l’imaginaire alors dominant de la souveraineté. Durant cette période, quand bien même l’État et le droit sont interprétés en termes utilitaristes et procéduraux, quand bien même l’administration publique adopte certaines techniques commerciales, leur intelligence ne déborde pas le canevas régalien. De même à l’époque précédente, relève Michael Oakeshott, « une grande partie du gouvernement d’un royaume médiéval concernait la collecte des revenus, mais cela ne faisait pas du gouvernement une tâche économique à laquelle on pourrait appliquer les principes de la comptabilité des coûts.11 » L’arithmétique politique qui apparaît au XVIIe siècle, outre qu’elle n’a rien de véritablement scientifique, est tout entière au service de la puissance des nations ; de même la statistique, jusqu’à ce qu’elle soit utilisée aussi de manière systématique par certains des premiers sociologues à la fin du XIXe siècle. Jusqu’à cette époque, de tels instruments restent par ailleurs fort rudimentaires. Elle a beau favoriser l’axiomatique des intérêts au détriment de la logique des droits originaires, l’économie reste politique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle – soit, selon les mots d’un célèbre professeur de morale, « une branche de la science de l’homme d’État ou du législateur » restreinte au choix des moyens pour atteindre la richesse des nations et de leurs citoyens12. Le mercantilisme et le caméralisme entendent ainsi donner au souverain les moyens de contrôler rationnellement l’activité économique de ses sujets aux fins d’une augmentation de ses recettes. Et si l’on peut, à la manière de Werner Sombart, « définir l’État moderne comme une gigantesque entreprise capitaliste dont les dirigeants auraient pur but principal d’“acquérir”, c’est-à-dire de se procurer le plus d’or et d’argent possible13 », il ne faut pas perdre de vue les finalités régaliennes que servent ces richesses jusqu’au début du XXe siècle. A l’époque même de Frederick Taylor, si l’efficacité industrielle est fortement valorisée, c’est pour ses promesses d’une plus grande justice sociale. L’entreprise privée moderne croît alors sous le contrôle et les encouragements de l’État. Le marchand, le commissaire, le commis et l’ingénieur peuvent gagner en force et en légitimité tout au long du XIXe siècle, ils demeurent soumis au pouvoir physique et symbolique du souverain et accessoirement de l’officier. Bref, l’État peut bien se montrer managérial dans ses moyens, il reste jusqu’au XXe siècle régalien en finalité.
11À l’orée du XXe siècle, prenant acte de la récente mue de l’État en une vaste machine aux mains de professionnels salariés dotés de compétences, d’outils et de techniques spécifiques se chargeant des tâches de gouvernement au sein d’administrations centralisées, de nouvelles théories politiques reconfigurent la souveraineté étatique à la lumière des principes managériaux. Si elles ne désenchantent pas en totalité l’État souverain, elles écornent grièvement sa logique régalienne.
12En France, l’école du « droit social » fait reposer la légitimité de l’État sur son utilité et sa capacité à remplir ses fonctions plutôt que sur la tradition et la coutume. A ce titre, la société est organisée sur une base fonctionnelle et non sur celle de droits. Pour le constitutionaliste Léon Duguit, « la puissance publique ne peut point se légitimer par son origine, mais seulement par les services qu’elle rend conformément à la règle de droit.14 » L’État est ainsi compréhensible comme une fédération de services publics. La justice n’est plus un esprit habitant le fonctionnaire, elle est une borne qui ourle sa fonction.
13Pour Max Weber, « un gouvernement moderne déploie son activité en vertu d’une “compétence légitime”15 ». La légitimité est dite légale, selon sa célèbre distinction, en vertu « de la croyance à la validité d’une codification légale et de la “compétence” objective fondée sur l’application de règles instituées de manière rationnelle16 ». En d’autres termes, le respect du principe régalien de légalité ne suffit plus par lui-même à légitimer l’État et doit être adossé à l’effectivité de l’impératif managérial de compétence. Relevant l’importance du « développement de la politique en une “entreprise”17 » et la formalisation progressive de savoirs administratifs, le sociologue dessine les grandes caractéristiques d’un art de gouverner managérial qu’il veut valables autant pour les bureaucraties gouvernementales que pour les entreprises, les églises, les partis et les syndicats : la rationalisation des méthodes et des outils de travail, le descellement de la propriété et du pouvoir, le passage graduel de la domination directe à la direction médiate. Le succès prochain de cette axiomatique managériale lui semble inévitable. « Certes, écrit-il en mai 1918, la bureaucratie n’est pas, et de loin, la seule forme moderne d’organisation, de même que l’usine n’est pas, et de loin, la seule forme d’organisation d’entreprise industrielle. Mais l’une et l’autre sont les formes qui impriment leur marque à l’époque actuelle et à l’avenir prévisible. L’avenir appartient à la bureaucratie18 ».
14Les expérimentations bureaucratiques menées et commentées par les Français et les Allemands sont suivies avec beaucoup d’intérêt aux États-Unis. Dès la fin du XIXe siècle, des penseurs comme Frank Goodnow et le futur président Woodrow Wilson y théorisent l’État à partir de ses fonctions et contribuent à renforcer la prévalence des principes du management d’entreprise au sein de l’administration américaine, tout en conservant une certaine idée de la spécificité de la souveraineté étatique19. Pour Wilson par exemple, l’administration, quand bien même elle doit « ressembler d’avantage à une entreprise » (business), reste « l’application systématique et détaillée de la loi publique.20 »
15Les différents éléments qui s’agrègent à la fin du XIXe siècle pour former la rationalité managériale préexistent à la grande entreprise moderne, mais épars, évanescents, et pour la plupart à peine esquissés. Les managers constituent alors la gestion en savoir de manière empirique et tâtonnante en réponse aux problèmes que pose quotidiennement la hausse d’activité d’organisations boulimiques, et non en référence à une doctrine clairement articulée. Similairement, souligne le politologue Bernard Silberman, « il n’y avait pas de théorie cohérente de l’organisation administrative ou de la fonction bureaucratique au XIXe siècle21 », mais différents types de bureaucraties suivant les pays et les réactions pragmatiques de leurs dirigeants politiques face aux problèmes menaçant leur statut et leur pouvoir. Des techniques managériales, certes ; d’idéologie managériale point.
La rationalité managériale
16De même que la captation par les souverains européens des fonctions de direction des hommes, alors entre les mains des pères, des évêques et des seigneurs, enfante un nouvel art de gouverner aux XVIe et XVIIe siècles, la croissance des organes spécifiquement dédiés à l’organisation et à la gestion du travail de grandes masses humaines engendre une classe nouvelle – les managers ou « cadres » – capable d’y remplir, dans le contexte d’une activité salariée et selon des techniques normalisées, les tâches de coordination jusque là dévolues aux marchés22. Conglomérant, au travers de clubs, revues et instituts de formation, des pratiques de gouvernement des hommes jusqu’alors dispersées, les managers se dotent bientôt d’une pensée propre de leur objet. L’apparition de cadres salariés à côté du propriétaire-directeur constitue selon le sociologue Charles Wright Mills « le fait dominant de l’entreprise moderne23 ». Cet « homme de l’organisation », formant également l’épine dorsale de la nouvelle classe moyenne, y insuffle l’imaginaire et les valeurs de l’entreprise. C’est lui qui intronise la culture managériale en nouveau sens commun.
17Selon cette rationalité nouvelle, gouverner consiste moins à punir et à discipliner qu’à normaliser, agencer et contrôler ; moins à rechercher la justice d’une situation que la justesse d’un comportement ou d’un arrangement ; les normes plastiques sont préférables au marbre des lois ; le pouvoir n’est plus lié principalement à un titre, une élection, une réputation, un territoire, une force physique ou une propriété, mais bien plutôt à une capacité, des compétences, un plan et une effectivité. Cette rationalité managériale idéal-typique doit évidemment composer dans les faits avec les rationalités gouvernementales qui l’ont précédée, et l’entreprise s’accommoder des survivantes institutions familiales, ecclésiales et étatiques.
18L’efficacité constitue le cœur de la rationalité managériale, « le “bien” élémentaire de la science de l’administration, quelle soit publique ou privée24 », selon l’un de ses illustres panégyristes. Le taylorisme, également appelé la « méthode d’efficacité », vise à l’usage le plus efficace possible du matériau humain. Selon ce paradigme symbolique, la morale n’est plus un pressant critère de jugement mais une variable d’ajustement prise dans un calcul de rentabilité, non plus un héritage de la tradition à conserver mais un paramètre d’action fabricable et modifiable. Ainsi que le résume un consultant proche de Taylor, « l’efficacité ne doit pas être jugée selon des standards préconçus d’honnêteté et de moralité, mais c’est l’honnêteté et la moralité, peut-être, qui sont à reconsidérer et à réviser à l’aide des fondamentaux de l’efficacité.25 » Le droit et la morale sont évacués de la logique managériale au profit du standard. Taylor et ses affidés rompent en cela non seulement avec la rationalité régalienne, mais également avec les principes de la conduite des affaires au XIXe siècle, qui faisait prévaloir les principes d’honnêteté, de justice, de bonne qualité, de fermeté, d’audace et de persévérance.
19Cette efficacité tant valorisée par l’axiomatique managériale n’est pas réductible à la logique capitaliste du profit. Historiquement, le manager est autant le fils du comptable et du marchand que celui de l’ingénieur. Ce dernier, qui très tôt s’est mis au service de l’entreprise, hisse son critère de jugement au rang de principe majeur de son gouvernement ; l’efficacité mécanique devient un idéal de gestion. Selon Thorstein Veblen, observateur vigilant du modelage de la rationalité managériale par les premiers gestionnaires professionnels, « les habitudes de pensée engendrées par le système industriel des machines et par l’organisation mécaniquement standardisée de la vie quotidienne en vertu de ce nouvel ordre, ainsi que par les sciences de la matière, sont d’un caractère tel serait qu’il inclinerait l’homme du commun à noter tous les hommes et toutes les choses en termes de performances tangibles plutôt qu’en référence à un titre légal ou à d’anciennes coutumes.26 » Il faut cependant attendre la cybernétique, terme qui tire son sens de la même racine grecque que la notion de gouvernement, pour voir apparaître les premières « machines à gouverner27 ».
20En Europe, durant la seconde moitié du XIXe siècle, le culte de l’entrepreneur autonome et de la libre concurrence le cède progressivement à l’idéal du bureaucrate professionnel : une carrière hiérarchique stable, des promotions au mérite, le règne de l’expert sur une société efficacement organisée par un État-providence. En Angleterre par exemple, de telles idées trouvent à s’exprimer dans le débat sur l’« efficacité nationale » initié par la Société fabienne au seuil du XXe siècle28 ; elles sont reprises par différents leaders nationaux européens au cours de la Première Guerre mondiale et plébiscitées par une classe moyenne dont l’employé de bureau est devenu la figure centrale29. Dans cette perspective, pour les époux Webb, chevilles ouvrières de ladite Société, « le problème fondamental de la démocratie [est] la combinaison de l’efficacité administrative et du contrôle populaire30 ». De fait, le milieu industriel ne fut pas systématiquement point de départ de l’engouement général pour l’efficacité.
21Aux États-Unis, c’est d’abord au niveau municipal que les principes managériaux sont appliqués à l’administration publique. Dès les années 1880, certains réformateurs décrivent l'administration locale comme étant « principalement une entreprise commerciale » (business agency) qui pourrait être « plus performante et efficace » si elle était gouvernée par des personnes choisies pour leur « adaptation particulière au travail31 ». Mais c’est surtout la publicité faite au management scientifique à partir de 1910 et l’appétit de réformes de la classe moyenne qui provoquent une véritable « vogue de l’efficacité32 » (efficiency craze). Selon une historienne du taylorisme, cet engouement est tel qu’à partir des années 1920 « les concepts liés au management et à l’efficacité avaient sous une forme ou une autre envahi tous les magazines commerciaux, tous les journaux et tous les manuels de gestion domestique du pays.33 » Des sociétés pour la promotion de l’efficacité surgissent du jour au lendemain sur tout le territoire américain ; des livres, des articles, des conférences appellent de leurs vœux l’efficacité à l’école, dans l’armée, au tribunal, à la maison, dans la famille, dans les sciences et dans le service religieux34. La scientificité revendiquée des principes de gestion mis en système par Frederick Taylor semble leur promettre l’universalité. Selon Taylor lui-même, ces axiomes qui ont révolutionné l’industrie « peuvent être appliqués avec les mêmes effets à toutes les activités sociales : à la gestion des nos foyers, à la gestion de nos fermes, à la gestion du commerce de nos vendeurs modestes ou importants, à nos églises, nos institutions philanthropiques, nos universités et nos ministères.35 » Dans le sillage de cet enthousiasme et directement influencés par les théories managériales naissent la Taft Commission on Economy and Efficiency (1910-1912) et le Bureau of Efficiency (1916-1933). Selon l’un de ses historiens, le Bureau of Efficiency représentait « la parfaite application du management scientifique au sein du gouvernement fédéral36 ». L’utopie d’un gouvernement taylorisé culmine avec l’élection de Herbert Hoover, personnage décrit par un proche de Taylor comme « l’ingénierie incarnée37 », et survit à sa déchéance pour animer le New Deal rooseveltien38. L’éphémère mouvement technocratique et les théories de la révolution directoriale, selon lesquelles « le gouvernement est à présent la plus grande de toutes les entreprises39 », en constituent les incarnations caricaturales.
22Le taylorisme conquiert également la Russie. D’abord réticent, Lénine est à partir de 1914 un admirateur de Taylor et entend appliquer ses principes à la société russe tout entière. En avril 1918, il souligne par exemple l’importance d’« organiser en Russie l’étude et l’enseignement du système Taylor, son expérimentation et son adoption systématiques40 », et à la fin de l’année suggère la création d’un « Institut pour le taylorisme ». Le mouvement tayloriste russe est cependant arrêté au milieu des années 30 par les purges staliniennes de l’élite bureaucratique pour ne revivre qu’au début des années 196041.
23« La guerre, notait judicieusement le philosophe Michael Oakeshott, a habitué les sujets des gouvernements modernes à l’expérience de voir leur fortune, leur propriété, leurs occupations et leurs activités gérées par les détenteurs de l’autorité.42 » N’y faisant pas exception, les deux guerres mondiales offrent aux États européens l’occasion de mettre ou place ou de renforcer des politiques dirigistes selon les principes managériaux de planification et d’efficacité. Selon l’historien Stéphane Rials, la Première Guerre mondiale « n’a sans doute pas enfanté à proprement parler la doctrine administrative : mais elle lui a donné l’occasion de s’approfondir, elle lui a donné une audience, elle lui a donné le début d’une consécration43 ». L’économie de guerre est ainsi fortement taylorisée dès 1914 et 1915, sous l’égide de personnalités telles que Henri Fayol, Albert Thomas, Etienne Clémentel et Louis Loucheur en France, Auckland Geddes et Robert Horne en Grande Bretagne, Walter Rathenau, Friedrich Kleinwächter et Wichard von Moellendorff en Allemagne44. Albert Thomas, socialiste chargé d’organiser la production du matériel de guerre français, déclare alors exemplairement : « La France entière est une immense usine dont j’ai l’honneur d’être à la tête.45 » Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Fayol explique qu’« entre ces deux sortes d’entreprises » que sont l’État et l’industrie, « il y a des différences de complexité et de grandeur, il n’y a pas de différences de nature. Dans l’industrie et dans l’État, ce sont les mêmes hommes qui constituent le corps social. Le parallélisme se poursuit donc jusqu’au bout entre la grande entreprise industrielle et l’entreprise nationale et il est naturel que les mêmes principes et les mêmes règles générales président à la direction de ces deux sortes d’organismes.46 » L’année suivante, le président de la République française avoue pour sa part, en exergue d’un ouvrage transposant la doctrine de Fayol à l’administration de l’État : « Je ne conçois pas que l’État puisse se gérer suivant d’autres règles que celles d’une grande entreprise industrielle bien menée47 ». Loin de faire disparaître les grandes entreprises, les guerres mondiales les ont renforcées. Elles ont également offert aux managers un extraordinaire champ d’expérimentation en matière de recrutement, de planification et de standardisation.
24Cette orientation managériale de l’appareil d’État demeure en temps de paix et s’accélère dans certains cas. En France, après la Seconde Guerre mondiale, la productivité n’est plus le jargon réservé des économistes et pénètre le grand public sous les noms de croissance et de développement. En France, un courant de réforme administrative s’inspirant du taylorisme et de l’administration Hoover entreprend de moderniser l’administration selon les principes managériaux. En 1946 est créé le Comité central d’enquête sur les coûts et les rendements des services administratifs. Le Produit national brut est mesuré pour la première fois en 1947. La procédure de rationalisation des choix budgétaires (RCB), qui subordonne les décisions à un calcul coût-efficacité, est instaurée en 1968 sur le modèle du Planning Programming and Budgeting System (PPBS) américain. Durant les Trente Glorieuses, le productivisme devient un humanisme. Pour Romain Laufer et Catherine Paradeise, ces mutations d’après-guerre ont une origine évidente : « en substituant le discours de l’efficacité à celui de la légalité, l’administration emprunte la méthode et le discours de l’entreprise privée.48 » Pour l’économiste John K. Galbraith aussi, cette « acceptation de la croissance économique comme un objectif social coïncide étroitement avec l’accession au pouvoir de la grande entreprise49 ». Tant que les sociétés industrielles seront productivistes, on peut présager que l’efficacité restera leur valeur cardinale et l’entreprise leur institution centrale. Selon ce paradigme, la société tout entière peut être comprise comme une grande entreprise de production. Dans une conférence prononcée à Brême en 1949, Martin Heidegger étire par exemple le prisme analytique de l’entreprise pour coder et décoder l’activité de la collectivité : « L’agriculture est maintenant une industrie alimentaire motorisée, quant à son essence, la même chose que la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz et les camps d’extermination, la même chose que les blocus et la réduction des pays à la famine, la même chose que la fabrication de bombes à hydrogène.50 » Cette activité de production constitue non seulement le moyen mais aussi la fin des sociétés industrielles modernes ; elle en mesure la qualité et le progrès au détriment de préoccupations pour l’égalité et la justice. Ou plus exactement, elle contribue à soumettre l’égalité et la justice à des calculs d’efficacité et de rentabilité jusque là réservés aux activités économiques. On peut ainsi admettre, avec Raymond Aron, qu’« une économie efficace n’est pas nécessairement une économie juste51 », tout en imaginant que ces deux principes peuvent être mathématiquement et économiquement rapportés l’un à l’autre et équilibrés52.
La souveraineté désenchantée
25Tout au long du XXe siècle, l’activisme économique de l’État favorise sa croissance institutionnelle et, partant, sa comparaison avec les entreprises privées dont son administration prit un temps les rênes, occupa le champ et importa les principes. La bureaucratisation de l’administration et la pénétration des maximes managériales au sein même des discours politiques justifient très tôt la comparaison de l’État à une entreprise et sa critique en termes gestionnaires, sans toutefois sérieusement ébranler le socle symbolique de la rationalité régalienne. Après la Première Guerre mondiale, c’est chose faite. D’après l’historien Otto Hintze, s’il a toujours existé bien des ressemblances entre l’État et l’entreprise économique, « il nous a fallu attendre l’effondrement moral et politique qui accompagna la fin de la Grande Guerre pour que se dissipe l’aura ancestrale de l’État et pour que sa noblesse et sa dignité se voient rabaissées au point qu’une telle comparaison devienne tout simplement admissible.53 » Pris dans son aspect de machinerie technique et de pratique codifiable, le gouvernement est de plus en plus envisagé en termes de politiques publiques. Les initiateurs de la théorie des choix publics font remarquer à cet égard que « la théorie politique s’occupait de la question : qu’est-ce que l’État ? La philosophie politique l’a étendue à la question : que devrait être l’État ? La “science” politique a demandé : comment l’État est-il organisé ?54 ». Selon cette théorie, l’entreprise peut tout à fait remplacer l’État dans l’exécution de ses différentes tâches.
26 Les contradictions idéologiques qui ont pu cliver les partis prétendant à la conduite des États industrialisés se trouvent résorbées dès lors que la société obéit à une rationalité managériale bornant la politique à la gestion efficace des ressources. Le débat de fond sur le caractère plus ou moins juste ou injuste de telle politique de santé ou de telle mesure migratoire fait ainsi place au débat technique sur l’efficacité de ladite politique ou de ladite mesure. Il faudrait en ce sens se défaire de l’antinomie trompeuse au fondement de tant de typologies qui oppose organisation et liberté, régulation étatique et marché, ou encore planification et laissez faire : il s’agit bien souvent dans les deux cas d’adapter les gouvernants et les gouvernés aux nécessités proclamées de l’efficacité sociale. Selon cet entendement, une ligne sépare le domaine des droits et celui des entreprises, et le principe de justice règne sur les marges de l’espace gouverné par l’impératif d’efficacité. Expliquons-nous.
27Rassemblant ordolibéraux, théoriciens des choix publics et néolibéraux, une frange importante de la pensée libérale défend depuis les années 1930 l’idée que la souveraineté ne résulte pas de la volonté générale mais, pour le dire grossièrement, de la croissance économique. Gouverner consiste en ce sens à gérer la société de manière à produire de la croissance. Par exemple, selon le héraut du renouveau libéral au XXe siècle, « le progrès de la révolution industrielle détruit la légitimité, l’autoritarisme et les habitudes d’obéissance au pouvoir établi, et la question essentielle devient d’organiser, de représenter et de guider le pouvoir informe des masses » ; par suite, « les questions de justice ne peuvent naître que d’une mauvaise adaptation des lois, des institutions, de l’éducation, et des habitudes sociales à un mode de production donné.55 » L’idéal de justice le cèderait ainsi au principe d’ajustement. Si la justice consiste à simplement répartir des récompenses entre producteurs et consommateurs, comme c’était déjà le cas pour Saint-Simon, alors le marché semble susceptible de remplir efficacement cette tâche ; et l’État n’est plus qu’« une organisation parmi les autres56 », selon les termes de Hayek. Définie par son principal promoteur comme « l’art d’ajuster les “connexions” liant les comportements de différents individus d’une manière telle que quelque chose que nous nommons la justice puisse être accomplie57 », la cybernétique peut elle aussi prétendre étoffer l’armoirie des mécanismes de gouvernement. La démocratie de marché apparaît en ce sens comme la juxtaposition de règles formelles dont le respect n’est pas fonction d’une transcendance morale ou juridique mais d’un système automatisable de récompenses et de blâmes en forme de prix constitués sur des marchés. L’État se trouve alors confiné aux marges de ces marchés – c’est-à-dire à leur cadre d’exercice, aux activités productives non rentables ainsi qu’à la formation, à l’entretien et au recyclage de la main-d’œuvre. Dans cette perspective, selon le mot d’Alain Touraine, « la politique est le contrôle social de l’économie rationalisée58 ». Que de chemin parcouru depuis Hobbes.
28De manière similaire, pour les penseurs socialistes et les tenants de l’État social, les pouvoirs publics sont légitimes dans la mesure où ils réduisent les inégalités (notamment celles causées par le système économique), et où ils s’acquittent des tâches de formation professionnelle et de sécurité sociale. Comme pour les libéraux, la performance tant recherchée est d’abord celle des entreprises privées. À en croire Habermas, le problème de la légitimation de l’État consisterait alors « à présenter les performances de l’économie capitaliste comme étant, dans la perspective d’une comparaison des systèmes, la meilleure manière possible de satisfaire des intérêts universalisables – ou consiste du moins à supposer qu’il en est bien ainsi –, l’État s’engageant alors, dans son programme, à maintenir dans des limites acceptables les effets perturbateurs dont s’accompagne l’économie.59 » L’idéal démocratique d’équilibre et d’égalité n’est plus dès lors qu’un simple verni rhétorique lustrant l’application consciencieuse des théorèmes gestionnaires par les pouvoirs publics. Et de rester entière la tension propre aux démocraties libérales entre des institutions publiques chargées d’assurer l’égalité des citoyens et des marchés privés reposant sur le principe d’inégalité.
New Public Management et gouvernance
29En 1972, Desmond Keeling, un haut fonctionnaire anglais, décrit le remplacement progressif de l’administration, définie comme « l’examen, dans un domaine de la vie publique, de la loi, de son application et de sa révision », par le management, entendu comme « la recherche de la meilleure utilisation des ressources dans la poursuite d’objectifs changeants.60 » Il faut cependant attendre les réformes en profondeur de l’État providence menées dans les pays anglo-saxons dans les années 1980 à la faveur des problèmes budgétaires engendrés par les chocs pétroliers pour que l’application des principes managériaux franchisse un nouveau seuil. Sous le nom de New Public Management, cet élan réformiste pénètre la majorité des pays industrialisés durant la décennie suivante et se trouve promu à l’échelle planétaire par la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques. Paradoxalement, le New Public Management entend combattre les maux de la bureaucratie avec les armes du management, alors même que ces deux réalités partagent les mêmes racines symboliques. Ainsi, les théoriciens du New Public management – ou NPM, ou encore (public) managerialism – subordonnent l’amélioration des performances de l’État à la mise en concurrence des services publics entre eux et avec des organismes privés, au lancement de « partenariats » entre le secteur public et le privé, à la création d’« organisations semi-autonomes » en charge du « volet opérationnel » des politiques, à la « contractualisation » les agents de l’État, à la multiplication des « contrôles financiers et managériaux », au renforcement des « mécanismes participatifs » faisant des usagers des contrôleurs, ou encore à la promotion des compétents et des méritants61. Exemplairement, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 soumet l’action de l’État français à cette méthodologie managériale qui consiste à remplacer les politiques par des « stratégies » déclinées en « objectifs opérationnels » évalués au moyen d’« indicateurs chiffrés de performance62 ». Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de sécurité intérieure (LOPPSI 2) est à cet égard symptomatique. Il ne s’agit pas seulement d’équiper de quelques techniques de gestion à la mode les pratiques de gouvernement régaliennes ; l’activité de l’administration est envisagée explicitement comme une activité de production, la justice constituant un produit à réaliser le plus efficacement possible et dont la fabrication est évaluable grâce à des indicateurs de performance tels que les délais d’attente, les coûts d’accès ou encore la satisfaction des consommateurs. L’idée même qu’il existerait des « modèles » de gouvernement est typique de cette conception du gouvernement comme conformation à un plan rationnel et finalisé. Dans les faits, les administrations publiques montrent cependant une grande résistance à l’application de ces schémas et leur application demeure toujours partielle.
30La diffusion fulgurante du concept de gouvernance est un marqueur de cette ouverture du champ régalien à la logique managériale. Vieille de sept siècles, la notion peut être définie dans son sens moderne comme un mode d’organisation qui, à la conception régalienne du gouvernement, préfère la recherche ponctuelle, horizontale et décentralisée d’accords contractuels selon un critère d’efficacité. Un des penseurs qui a sorti la notion de l’ombre la définit comme « un exercice d’évaluation de l’efficacité de modes d’organisation.63 » Observant le retour en grâce du terme « gouvernance » à la fin des années 80, on ne peut que constater, du côté de son environnement conceptuel et par contraste avec celui de la notion de souveraineté, une transition sémantique du public au collectif, de l’ordre à la négociation, du commandement à l’incitation, de l’autorité au consensus, de la transcendance à l’immanence, de la conservation au changement, du passé des origines aux objectifs futurs, du formel à l’informel, des règles intangibles aux normes flexibles, de la centralisation à la décentralisation, de l’unité à la division, de la souveraineté à l’autonomie, du secret à la transparence, de la représentation à la participation, du suffrage au sondage, de la légitimité à la justification, de l’indépendance à l’interdépendance, de l’équilibre à la flexibilité, de la stabilité à la mobilité, de la solidarité à la concurrence, de l’égalité aux inégalités, et de la justice à l’efficacité. Bref, du référentiel régalien au référentiel managérial. Les anciens principes politiques ne disparaissent pas mais se trouvent désacralisés pour être exportés hors du champ étatique – de même que l’État n’est qu’une organisation comme les autres, « l’autorité n’est qu’une forme d’influence parmi d’autres64 », selon un éminent théoricien du management. On parle alors de souveraineté… du consommateur, de stabilité… monétaire, d’intégrité… des marchés, d’indépendance… des agences de notation ou encore du secret… bancaire. Selon la Banque mondiale, qui a joué un rôle central dans le succès récent de la notion de gouvernance, s’il fait par exemple sens d’encenser le « participatif », ce n’est point pour des raisons de démocratie ou de liberté d’expression mais parce que « la participation est une question d’efficacité65 ». Concomitamment, le droit serait vidé de toute transcendance pour être intégré à l’arsenal managérial au titre d’outillage parmi d’autre. Ainsi que le déplore Pierre Legendre, « parvenu au stade d’une instrumentalisation pure et simple, le droit se trouve écarté du champ de la pensée, pour n’être plus qu’une technologie annexe au service de l’efficiency ultramoderne, c’est-à-dire pour n’être plus, selon la formule des juristes-sociologues, que régulation sociale.66 » Et des politologues réussissent quotidiennement l’exploit, hier impensable, de parler politique sans utiliser les notions ni de public, ni de gouvernement, ni de nation, ni de territoire, ni de pouvoir, ni de souveraineté, mais au seul moyen des termes de procédure, de projet, de décision, de gestion, d’efficacité et de responsabilité.
31Qu’en est-il de cette « managérialisation » dans le champ international, domaine qui constitue généralement un observatoire de choix des changements politiques structurels ? L’utilisation du terme « gouvernance mondiale » renvoie, dans les littératures académique et institutionnelle, à l’ouverture du grand marchandage inter-étatique aux groupes d’intérêt ayant accès à l’espace supranational ainsi qu’à la reconnaissance d’un droit mou (soft law) constitué de normes volontaires non contraignantes possiblement émises par des organismes privés. En 1999, au Forum économique mondial, le Secrétaire général des Nations unies, souhaitant sortir d’une crise politique et financière par l’annexion des associations civiles et des entreprises, avouait en ce sens que « désormais la paix et la prospérité ne peuvent être atteintes sans des partenariats faisant intervenir les gouvernements, les organisations internationales, la communauté des affaires et la société civile.67 » Le G8 ainsi que l’ensemble des institutions internationales promeuvent également depuis le milieu des années 90 « une bonne gouvernance, où le secteur privé et la société civile peuvent jouer un rôle productif68 ».
32Le domaine infiniment régalien du droit tend donc à être envahi par des normes non-juridiques édictées et sanctionnées par des organisations privées. La souplesse expérimentale de la norme tendrait ainsi à remplacer le marbre transcendant des lois, suivant l’idée saint-simonienne que la discipline juridique est incompatible avec la nécessaire flexibilité de l’organisation industrielle. À mesure que des institutions privées se substituaient aux organisations publiques, le champ supranational a ainsi vu pulluler standards, chartes, codes de conduites et bonnes pratiques comme autant de modèles ayant valeur d’exemple. Par exemple, la réforme financière internationale n’est aujourd’hui plus menée par le Fonds monétaire international mais par les instances privées émettrices de normes non contraignantes que sont le Groupe d’action financière et le Forum de stabilité financière. À ces normes s’ajoutent des indicateurs permettant d’évaluer, et par suite de récompenser ou de sanctionner, les « scores de gouvernance » des différents pays de la planète, l’efficacité de leurs systèmes juridiques, éducatifs et sanitaires, la qualité de leurs infrastructures de transport, leur stock de capitaux humains, la solidité de leur secteur bancaire, ou encore leur taux d’endettement69. Ce qui n’est pas sans conséquence à l’échelle nationale. Selon la juriste Marie-France Christophe-Tchakaloff, ce sont par exemple les instances de l’Union européenne qui ont « largement contribué à démontrer que la justice n’est plus un pouvoir régalien mais une simple administration70 », au besoin privatisable. Les conditionnalités attachées aux programmes d’aide de la Banque mondiale ont pareillement contribué à inoculer à ses débiteurs l’esprit et la lettre de la « bonne gouvernance ».
33Depuis le milieu des années 1970, les institutions publiques – relativement – formelles, transparentes, imputables, légitimes et à caractère étatique telles que les Nations unies semblent désinvesties de leurs tâches régaliennes par les pays économiquement et militairement les plus puissants au profit d’alliances à géométrie variable à la manière du G7, du G20, de la Commission Trilatérale ou du Forum de Davos, les coalitions volontaires ou les instances normatives telles que l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qui sont à la fois flexibles, rapides, peu bureaucratiques, faiblement légitimes et très ouvertes aux organismes privés à but ou non lucratif. Ces organisations troqueraient ainsi en toute conscience les avantages de la légalité et de la légitimité pour ceux de la souplesse et de l’efficacité. Le président français Jacques Chirac, pour qui « le G8 n’a pas de légitimité particulière71 », arguait par exemple, à propos du vote de la résolution de l’ONU sur le transfert de souveraineté en Irak : « Ce n’était pas, naturellement, la question de savoir qui avait tort ou qui avait raison. C’est un problème d’efficacité.72 » De même, pour Romano Prodi, alors Président de la Commission européenne, « l’efficacité de l’action des institutions européennes est la principale source de leur légitimité73 ». Ce « remplacement du critère traditionnel de légitimité et d’autorité par le critère de performance74 », selon le principal théoricien des régimes internationaux, est lisible à l’échelle des sociétés industrielles dans leur ensemble. C’est aussi l’avis d’un autre penseur influent des relations internationales pour qui les gouvernants occidentaux ont « accepté des concessions de légitimité, de transparence et d’imputabilité au bénéfice d’une prise de décision efficace dans le domaine économique.75 » Bref, le droit et la légitimité ne semblent plus, à l’échelle internationale, les indispensables attributs de la puissance.
Conclusion
34Pour John Maynard Keynes, « le problème politique de l’humanité consiste à combiner trois choses : l’efficacité économique, la justice sociale et la liberté individuelle.76 » Il semblerait aujourd’hui que les deux derniers termes soient de plus en plus conçus selon le schéma intellectuel propre au premier. La rationalité managériale a aujourd’hui conquis l’ensemble des institutions des sociétés industrielles. Qu’elle ait été appliquée à l’État dès le début du siècle ne devrait pas surprendre, tant ces institutions ont évolué au contact permanent l’une de l’autre jusqu’à se partager objets, langages et personnel. Qu’elle puisse gouverner la famille et l’individu semblerait moins évident. C’est pourtant le cas depuis une cinquantaine d’années que les théoriciens du capital humain ont entrepris de « traiter les ressources humaines explicitement comme une forme de capital, comme des moyens de production eux-mêmes produits, comme le produit d’investissements77 », selon les mots du père fondateur de ce courant de pensée78. Une telle prémisse conduit à soumettre tous les aspects de la vie individuelle à un calcul d’efficacité économique. Planification, coordination, comptabilité, efficacité sont les mots d’ordre de cet homo managerialis qui est son propre actionnaire, son propre employé et son propre client. Ce qu’il produit, ce qu’il consomme et ce qu’il vend ou échange, c’est d’abord son existence. C’est être un fondamentalement fabriqué, malléable, interchangeable et jetable. Ce qui n’était qu’une théorie académique confidentielle est aujourd’hui devenu un nouveau sens commun. Il y a lieu, il me semble, de se pencher attentivement sur cette réalité.