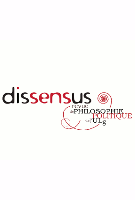- Portada
- N° 3 (février 2010)
- Varia
- De la critique du « procès sans sujet » au concept de subjectivation politique. Notes sur le foucaldisme de Jacques Rancière
Vista(s): 6801 (26 ULiège)
Descargar(s): 1003 (7 ULiège)
De la critique du « procès sans sujet » au concept de subjectivation politique. Notes sur le foucaldisme de Jacques Rancière

Tabla de contenidos
1L’intention minimale de ce texte est de mettre en lumière l’importance de la pensée de Michel Foucault pour la problématisation de la politique selon Jacques Rancière. Deux ouvrages de Rancière y seront surtout analysés : La leçon d’Althusser1, livre fondateur dans lequel, rompant brutalement avec son maître, Louis Althusser, il énonce une première fois ses thèses originales ; La mésentente2, ouvrage où ses propositions sont portées à leur plus haut point d’élaboration et de systématicité.
2Dans ce cadre, on prendra la mesure du lien de Rancière à Foucault en six étapes : 1/ rappel de la conceptualité propre à La mésentente, insistance sur la notion de « subjectivation politique » ; 2/ mise en évidence d’une aporie éventuelle de celle-ci et énumération des hypothèses mises à l’épreuve dans la suite ; 3/ explication du concept de « procès sans sujet » chez Althusser ; 4/ rappel de sa critique par Rancière ; 5/ démonstration de l’importance de Foucault pour cette critique ; 6/ reprise du concept de « subjectivation », à partir de ce qui précède et, notamment, de la dernière pensée de Foucault.
Politique et subjectivation dans La mésentente
3Au-delà même du champ philosophique francophone, La mésentente est régulièrement considéré comme un temps fort de l’histoire de la philosophie politique contemporaine. En vérité, cela ne va pas de soi. L’ouvrage s’ouvre en effet sur une critique de cette catégorie : la philosophie politique, ce n’est que le nom de l’oubli de la politique dans la philosophie3. Et c’est à dévoiler le sens authentique de la politique que Rancière, en philosophe, s’attachera.
4La question qui traverse l’ouvrage est : sous quelles conditions peut-on dire qu’il y a, ou qu’il n’y a pas, politique ? À cet égard, une notion apparaît d’emblée cruciale : celle d’égalité. La politique n’est aucunement la gestion d’un état de fait ou d’un État donné ; elle n’est pas l’organisation d’une domination par la détention du monopole de la violence légitime ; et elle ne consiste pas plus en une réflexion sur les moyens du bon gouvernement. La politique se signale d’une rupture, d’un accroc, dans cette organisation ou cette réflexion : et elle s’atteste, d’abord, par la mise en œuvre, l’effectuation, de l’égalité de chacun et de n’importe qui. L’élaboration de cette idée résulte d’une attention philosophique double, portant autant sur des questions de langage que sur des scènes historiques d’émancipation ; elle se déploie aussi bien dans l’ordre des pratiques que dans celui des discours, entre, si l’on veut, corps et paroles. Elle s’indexe, en outre, sur une ontologie, que concentre le concept de « partage du sensible ». Et cette perspective culmine dans la conceptualisation rigoureuse de « dispositifs », dits de « subjectivation politique ». Voyons cela de plus près.
5Rancière souligne à sa façon l’ambiguïté de la notion de logos : elle ne désigne pas seulement la parole que partagent tous les animaux humains ; elle est aussi ce qui rend raison du fait que la parole, dans une communauté donnée, n’est pas équitablement répartie4. C’est dans cet interstice, dans sa discussion ou sa dispute, que se loge la possibilité de la politique. Il faut voir, d’abord, que toute communauté est répartition, distribution des parts (en termes de lieux, de temps, d’activités dévolus à chacun…). Or tout commun suppose qu’une partie de la communauté s’arroge le droit de compter les parts ; et que certains, fatalement, soient sans part aucune ni moyens de prendre part au compte. Tel est « le tort constitutif de la politique5 » : c’est « par l’existence de cette part des sans part […] que la communauté existe comme communauté politique […] c’est-à-dire comme divisée par un litige qui porte sur le compte de ses parties6 ». Symétriquement, cette situation fondatrice et foncièrement inégalitaire indique, en creux, l’égalité des membres d’une communauté, qu’ils soient comptés pour partie ou décomptés du tout. Le compte qui domine, en effet, est fonction d’un logos qui toujours ordonne, donne les ordres ; or pour comprendre ce logos – en tant même qu’il partage et gouverne les conduites – il faut le posséder : ce qui signifie, déjà, que le sans part est égal à celui qui a part au commandement.
6En définitive, le tort au fondement du commun renvoie l’ordre dominant à sa contingence (son an-archie), et mieux, à son arbitraire. On comprend déjà que la diction du tort soit autre chose qu’une demande de réparation7. Elle est d’emblée affirmation de l’égalité de n’importe qui avec chacun. C’est la racine de l’ordre du commun lui-même qu’elle expose et bouleverse, puisque, après tout, cet ordre naît de la négation du principe d’égalité et se survit de dénier cette négation initiale. Révélant le mécompte primitif, la prise en compte du tort est l’imposition d’une part excédentaire sans commune mesure avec le compte des parties jusque-là dominant. Entrant en scène comme égaux, ceux qui n’étaient rien, dès lors, revendiquent d’être le tout : ils se proclament porteurs de l’universel.
7La manifestation du tort est liée à une situation de mésentente. Celle-ci « concerne moins l’argumentation que l’argumentable, la présence ou l’absence d’un objet commun entre un X et un Y. Elle concerne la présentation sensible de ce commun, la qualité même des interlocuteurs à le présenter ». On voit combien le concept de mésentente déborde le cadre – celui des jeux de parole – où il se pose de prime abord. C’est qu’il fait directement signe vers le litige qui matériellement détermine la situation des corps parlants constitutifs de la communauté. Il invite à poser la question : sur quel mécompte le commun se fonde-t-il ? C’est en un tel discours, de ce que s’y expose tort et litige, parce qu’y affleure « la situation même de ceux qui parlent », que s’inaugure la politique8. Car la diction du tort dans la mésentente touche immédiatement au plus profond, au « partage du sensible » lui-même, soit le « système d’évidences » détachant le visible de l’invisible, l’audible de l’inaudible, qui « fixe […] en même temps un commun partagé et des parts exclusives » et hiérarchise le réel9 :
La parole par laquelle il y a de la politique est celle qui mesure l’écart même de la parole et de son compte. Et l’aisthesis qui se manifeste dans cette parole, c’est la querelle même sur la constitution de l’aisthesis, sur le partage du sensible par lequel des corps se trouvent en communauté10.
8Il y a alors deux types possibles de partage : celui, consensuel, « qui met les corps à leur place et dans leur fonction selon leurs "propriétés" » ; et celui, dissensuel, qui précisément fend cette harmonie, par l’inscription de ce qui l’excède11. D’un terme classique, notamment étudié par Foucault12, Rancière nomme le premier régime « police ». Sa définition est connue : « C’est un ordre du visible et du dicible qui fait que telle activité est visible et que telle autre ne l’est pas, que telle parole est entendue comme du discours et telle autre comme du bruit13 ». La politique, à l’inverse, est ce qui « suspend » cet état de fait, ce « qui défait les partages sensibles de l’ordre policier » pour la raison qu’elle « actualise la contingence de l’égalité14 ». On le voit : l’égalité (qui n’est pas d’abord de fait, qui est une simple « présupposition » essentiellement « vide », ce qu’il faut seulement postuler et qui s’expose dans la diction du tort) est bien « au principe » de la politique, dans sa différence d’avec l’ordre policier15. On notera, au passage, la complexité du lien entre politique et police. Ce n’est que du point de vue politique que peut apparaître, comme tel, le partage policier du sensible ; c’est la politique, invitant au recomptage des parts, qui démontre qu’il y a mécompte. C’est dire que la politique est indissociable de la police, quoiqu’elle lui soit rigoureusement hétérogène : c’est toujours « au cœur de l’ordre policier » que frappe « la vérification de l’égalité16 ».
9Enfin, cette frappe, cette rupture, prend consistance dans « des dispositifs de subjectivation spécifiques17 ». De sorte qu’il revient au concept de « subjectivation politique » de résumer ce qui précède. Ce concept s’entendra donc dans un quadruple sens. Premièrement dans un sens discursif : comme intensification de cas de litiges et matérialisation du tort, elle est multiplication « d’événements de paroles18 » ; ensuite dans sa dimension égalitaire : la subjectivation politique se soutient de la logique du trait égalitaire, lequel trouve ici sa coloration proprement politique19 ; troisièmement dans un sens corporel ou matériel : cette subjectivation implique un bouleversement dans l’ordre des corps et des existences et d’abord un travail de « désidentification20 » ; enfin selon une acception proprement ontologique, puisqu’elle impose « la reconfiguration du champ de l’expérience » par l’émergence de « scènes polémiques21 ». Le concept de subjectivation politique est bien au cœur du livre :
Une subjectivation politique redécoupe le champ de l’expérience qui donnait à chacun son identité avec sa part. Elle défait et recompose les rapports entre les modes du faire, les modes de l’être et les modes du dire qui définissent l’organisation sensible de la communauté […]22
Aporie de la subjectivation politique ?
10Le concept de « subjectivation politique », élaboré au croisement d’une réflexion sur les discours et les pratiques, fondé sur une ontologie du « sensible », est le centre de gravité théorique de l’ouvrage le plus achevé de Rancière. J’en esquisserai dans la suite la généalogie par le détour de Foucault. Avant cela, il importe cependant de rendre compte d’une forte critique formulée par un philosophe partageant d’ailleurs avec Rancière un présupposé essentiel : la politique n’est ni gestion ni réflexion, mais d’abord – pour le dire dans les termes de L’idéologie allemande – un « mouvement réel qui abolit l’état actuel23 ».
11Laissons de côté les références lacaniennes et léniniennes qui forment la toile de fond de cet article de Slavoj Zizek24 pour aller à l’essentiel. Dire qu’il y a politique lorsqu’une part des sans parts, comme effectuation du trait égalitaire, s’identifie au tout de la communauté, c’est mettre la politique sous condition d’un « singulier universel25 ». Mais le problème naît de la rencontre entre le geste politique et l’ordre policier. Ce dualisme ontologique, en effet, emporterait avec lui des exigences impossibles ou contradictoires : la politique se soutient de l’existence de la police, mais elle n’existe que pour rompre son ordonnancement. Selon Zizek, la pensée de l’universel singulier est précisément ce qui permet de supporter cette tension, mais au prix de la maintenir indéfiniment. Certes, elle fait signe vers une remise en question radicale et permanente de l’ordre existant ; mais elle indique aussi que cet ébranlement ne peut jamais être total, qu’il sera toujours à nouveau absorbé par cet ordre. La mésentente serait entièrement comptable d’une telle ambiguïté. Concrètement, elle s’indique de ceci que Rancière, bien qu’il maintienne une perspective marxienne (la politique comme mouvement dissolvant un état de chose26), paraît trop hanté par ses dérives totalitaires pour l’assumer dans ses dernières conséquences (révolutionnaires). Il s’agit, in fine, d’
une logique qui inclut d’avance son propre échec, qui considère sa réussite totale comme son ultime échec, […] qui garde une attitude ambiguë vis-à-vis de […] l’Ordre de l’Être policier : il faut qu’elle s’y réfère, elle en a besoin comme du grand ennemi – [mais elle rejette] […] l’idée même d’opérer la subversion totale de cet ordre […] comme proto-totalitaire27.
12 Or – c’est le point –, à suivre Zizek, le signe de cette ambivalence est précisément la « réduction du sujet à la subjectivation28 ». Le philosophe slovène sait gré à Rancière d’avoir refusé d’éluder le moment de la subjectivité. Mais le fait de l’avoir rabattu sur des « processus de subjectivation » reconduisant l’hétérogénéité paradoxale (et aporétique) de la politique à l’égard de la police lui semble profondément problématique. Dans les développements passablement tortueux qui suivent, Zizek suggère que l’abandon de la notion de subjectivation (et du dualisme ontologique qui la soutient) au profit de celle de sujet résoudrait le malaise. Ce déplacement pointerait une politique qui serait tout autre chose qu’un jeu de provocations à l’égard de l’ordre policier compris dans les limites de ce dernier : une politique qui assumerait l’acte de le dissoudre pour le convertir en un nouvel ordre.
13Il est possible que cette critique soit seulement à comprendre comme une demande adressée à Rancière de se mettre au clair avec l’héritage historique de la philosophie de Marx. Mais il semble qu’elle ouvre aussi à un autre type de questions. Jouer le sujet contre la subjectivation, c’est aussi demander à cette dernière catégorie de quelle possible institution elle est porteuse. En d’autres termes : comment se cristallise le dispositif de subjectivation, comment le mouvement politique de « fracture » du régime policier trouve-t-il son point d’arrêt, comment la subversion s’instituerait-elle en un véritable sujet politique ? Ou encore : comment la subjectivation politique trouve-t-elle à durer, à se survivre, sur une étroite ligne de crête qui la protègerait d’une contre-effectuation policière ? Comment penser la consistance temporelle spécifique d’un tel processus de subjectivation ? Zizek ne semble pas penser que La mésentente puisse répondre à ces interrogations. Cependant, peut-être la problématisation de l’importante question du droit, ébauchée par Rancière, constituerait-elle une voie de réponse possible29 : l’ordre juridique ne peut-il aussi apparaître comme un lieu où peuvent s’inscrire et se fixer certaines avancées arrachées par le procès dissolvant de la politique ? Il est du reste patent que Rancière n’ignore pas le problème de l’institution – la notion revient très régulièrement au fil du texte. Or, sous le signe du concept de « démocratie », Rancière lie précisément la notion d’institution à celle de subjectivation, dans un geste qui, du point de vue de Zizek, ne peut que sembler paradoxal. Il demeure que La mésentente définit la démocratie comme « une manière d’être du politique », comme « le mode de subjectivation de la politique » au sens strict du terme, pour l’identifier, un peu plus loin, à « l’institution de la politique elle-même30 ». La démocratie serait chez Rancière la forme dans laquelle la subjectivation politique – au point de vue le plus local mais aussi dans une perspective davantage globale – assure la recomposition de ce qu’elle défait. Elle désigne l’institution de ces procès de subjectivation et nomme leur temporalité propre. Avant de revenir, en conclusion, sur ce point, il faut maintenant retracer la manière dont Rancière est parvenu à définir conceptuellement ce type de dispositifs politiques. Le point de départ est à chercher dans sa critique du concept althussérien de « procès sans sujet ». Que signifie ce syntagme ?
Althusser et la catégorie de « procès sans sujet »
14Dans sa Réponse à John Lewis31, Althusser se propose de rappeler au nommé John Lewis – symbole, décrit comme passablement sot, du marxisme humaniste – les principes de base du marxisme scientifique, aussi appelés « orthodoxie » marxiste-léniniste32. La Réponse est une leçon d’orthodoxie dont l’énoncé central est que, contrairement à la proposition de Lewis, ce n’est pas l’homme mais bien les masses qui font l’histoire. C’est dans ce contexte que l’histoire est définie comme « procès sans sujet ».
15Althusser accorde que la proposition « les hommes sont sujets de l’histoire » fut bien révolutionnaire, mais seulement du point de vue de la révolution bourgeoise : elle s’opposait alors à la thèse de l’idéologie féodale selon laquelle le sujet de l’histoire est Dieu. Néanmoins, avec l’accès de la classe bourgeoise à la position historique dominante, cette thèse humaniste devient réactionnaire33. C’est un autre mot d’ordre qui doit nourrir la révolution prolétarienne ; et, en tout état de cause, la science marxiste, qui fait son lit, « n’a rien à voir avec la "question anthropologique"34 ». Au vrai, selon Althusser, la thèse juste doit à la fois atteindre un haut niveau de scientificité, tout en affirmant, avec force, que ce sont bien les hommes empiriques – en tant que classe exploitée – qui sont le levier du mouvement historique. Ce qu’il faut alors, c’est tenir à la fois que les hommes sont sujets dans l’histoire, qu’ils agissent en son sein, tout en taillant en pièce l’idée qu’ils sont sujets de cette histoire35.
16
17Les hommes sont sujets dans l’histoire : cela signifie en fait qu’un individu ne devient agent historique que pour autant qu’il est assujetti. C’est dire que l’agent de l’histoire n’est ni « libre », ni « constituant ». Qu’au contraire il est constitué sur une scène idéologique (bourgeoise), elle-même surdéterminée par l’organisation des rapports de (re)production (capitalistes). Comme Althusser le note ailleurs : « Toute idéologie a pour fonction (qui la définit) de "constituer" des individus concrets en sujets36 ». Accorder que l’homme est sujet dans l’histoire revient finalement à accorder à l’homme, compris comme sujet, la portion congrue. Aussi bien, ce premier point conduit à refuser l’idée que l’homme soit sujet de l’histoire. En attirant l’attention sur la genèse socio-historique de la catégorie de sujet, on a déjà porté le regard vers la matérialité des rapports sociaux. Or c’est précisément ce que la catégorie philosophique de sujet (et ses corollaires : origine, essence, cause, finalité) ne permet pas de voir. « Penser l’histoire réelle », c’est rompre avec un point de vue, idéaliste, où l’essence de l’homme, identifiable comme intériorité unifiée, est posée comme origine, cause et fin de l’histoire37. C’est retrouver, dans la concrétude des rapports de production et de leurs transformations, le cœur du procès historique, soit l’affrontement entre classes hétérogènes :
L’histoire est bien un « procès sans Sujet ni Fin(s) », dont les circonstances données, où « les hommes » agissent en sujets sous la détermination de rapports sociaux, sont le produit de la lutte de classe. L’histoire n’a donc pas, au sens philosophique du terme, un Sujet, mais un moteur : la lutte des classes38.
18
19Suivant Althusser, se débarrasser de la notion de sujet, héritage d’une idéologie philosophique idéaliste, c’est-à-dire bourgeoise, c’est non seulement rappeler que l’homme est le produit de déterminations historiques, économiques et sociales, mais c’est aussi le moyen de faire droit à l’homme empirique et aux rapports de force (entre classes) par et dans lesquels il est constitué. C’est ce que vise l’introduction de la catégorie de « procès sans sujet » dans la description du processus historique. L’intervention d’Althusser a ainsi pour but ultime de tracer une « ligne de démarcation39 » dans la théorie elle-même, laquelle partage avec précision les énoncés qui, même s’ils se réclament de Marx, restent réactionnaires (de ce qu’ils se fondent sur une idéologie humaniste), des énoncés révolutionnaires relevant à proprement parler de l’orthodoxie marxiste-léniniste. Les seconds, comme celui d’Althusser, emploient le mot juste : l’histoire est « procès sans sujet » ; les autres, comme John Lewis, l’ignorent – il est donc justifié de leur faire la leçon.
Rancière critique d’Althusser
20Ouvrage décapant, souvent violent, brusque jusqu’en ses moments de drôlerie, La leçon d’Althusser est une gifle que Rancière adresse à son premier maître en philosophie. Son écriture fut précipitée par l’actualité : en Mai 68, Rancière dut constater que les outils qu’il héritait d’Althusser ne lui permettaient pas de saisir correctement l’événement, et la nouveauté dont il était porteur, notamment la critique des conditions de production et de transmission du savoir40.
21De son point de vue, le problème de la pensée d’Althusser est qu’elle est, d’abord et avant tout, « une théorie de l’éducation41 ». Or la vraie question marxiste ne serait pas tant celle du sujet de l’histoire que celle de la compétence des masses : les masses sont-elles capables de faire l’histoire dans le sens qui leur convient ? À ce problème, Rancière propose une réponse sans ambiguïté : « Ce sont les opprimés qui sont intelligents et c’est de leur intelligence que naissent les armes de la liberté42 ». D’emblée donc, il insiste sur la nécessaire présupposition de ce qu’il nommera plus tard le « trait égalitaire ». Ce qui est aussi rompre avec la perspective philosophique où s’inscrivait Althusser. Car la thèse égalitaire dite à l’instant n’est pas une thèse de philosophie ; et la lutte contre l’idéologie bourgeoise, au reste, n’est pas d’abord affaire philosophique. Elle implique plutôt d’effectuer, pratiquement, la présupposition de l’égalité. L’opposition à la bourgeoisie commence par le refus de son premier axiome, soit l’« idée d’une nécessaire assistance aux opprimés43 ». Tel est le cadre général où se déploie la critique ranciérienne : une sortie de la philosophie par l’actualisation de la logique égalitaire.
22Contre une proposition de John Lewis (« l’homme ne connaît que ce qu’il fait »), Althusser avançait que : « On ne connaît que ce qui est ». Cela signifie, pour le dire vite, que l’histoire n’est pas plus aisée à connaître que la nature, que cela est « peut-être même plus difficile ». La raison en est simple : loin d’être, comme le laisse entendre Lewis, spontanée, la connaissance de l’histoire se ferait toujours au travers d’un filtre idéologique imposé par la classe dominante. Les masses sont donc d’abord dans un rapport d’illusion à l’histoire44. Rancière lit cet énoncé althussérien comme une stratégie typique de la position de maîtrise. Si les hommes s’illusionnent quant à leur histoire, c’est que celle-ci doit être éclairée, expliquée, par celui qui ne s’en laisse pas compter, celui dont le savoir permet de déchirer le voile (aussitôt recousu) de l’illusion. Le maître assure ainsi sa position (notamment institutionnelle) : son savoir apparaît comme condition sine qua non de la libération du plus grand nombre. Althusser serait ainsi le représentant achevé de ce que Rancière nommera, dans Le maître ignorant, le cercle vicieux de « la logique de l’explication », où « le redoublement des raisons n’a pas de raison de s’arrêter », sinon parce que « l’explicateur est seul juge du point où l’explication est elle-même expliquée45 ». Avant Pierre Bourdieu46, Althusser est, dans l’œuvre de Rancière, le premier nom de cette logique où le médecin doit impérieusement, sous prétexte de la soigner, fortifier la maladie – c’est que sa position d’intellectuel critique en dépend :
C’est là que la solidarité [de la maladie (l’illusion) et du médecin (Althusser)] allait se nouer : dans l’éducation que l’althussérisme proposait comme préalable à toute transformation ; dans le lien de cette éducation avec sa double éducation d’universitaire et de militant du parti […]47
23 D’où une conséquence pratique des plus fâcheuses. Le fait de rabattre la question politique sur le doublet science (marxiste)/idéologie (bourgeoise) revient en fait à oblitérer la question des jeux de pouvoir, c’est-à-dire des modalités, diverses, dont s’exerce le pouvoir, dont il est éventuellement tourné, détourné, ou se fraye d’autres chemins, y compris en des lieux incongrus. Considérer cela aurait par exemple pu permettre d’interroger les effets de pouvoir dont le discours d’Althusser lui-même était le lieu et l’enjeu. Mais, plus généralement, le « masquage » de cette question va de pair avec un certain malaise à l’égard de la pratique, et spécialement de la praxis révolutionnaire48. Comment la lutte des classes – pour reprendre un mot althussérien – trouverait-elle son lieu d’élection ailleurs que dans la théorie ? C’est qu’elle implique, à un certain point d’intensité, la refondation des conditions de production et de transmission du savoir – et on ne voit guère pourquoi un maître confortablement installé désirerait cela. Pour le dire d’une boutade : un énoncé du type « les ouvriers n’ont pas besoin de notre science mais de notre révolte », c’est avant tout la « menace d’une grave crise de l’emploi sur le marché de la philosophie49 ».
24 Des thèses philosophiques formulées à partir d’une position de maîtrise ont donc pour corollaire un manque de réflexivité critique, l’élision de la question des effets de pouvoir et celle des bouleversements pratiques. C’est pourquoi, à suivre Rancière, Althusser doit se cantonner dans une « police des concepts50 ». Ne pas prendre en compte la question des effets pratiques des discours (celui de John Lewis, de Sartre, ou de tel groupe ouvrier) condamne à un délire théoriciste ne les jugeant qu’en référence à une ligne théorique dessinée a priori. Ce qui importe, c’est la seule conformité à une certaine ligne de démarcation, entre idéologie du sujet et science marxiste. En jugeant les « effets politiques imaginaires d’énoncés sans contexte51 », on s’interdit de considérer leur justesse pratique selon la lutte spécifique où ils sont engagés. Mais au moins aura-t-on justifié, et conforté, sa propre position, ainsi que les conditions de sa reproduction.
25 C’est dans ce contexte que s’insère la critique de l’anti-humanisme d’Althusser et de la catégorie de « processus sans sujet ». Rancière indique qu’il y a au fond deux manières d’entendre ce problème. Soit l’homme dont il est ici question n’est qu’un concept philosophique. Mais alors, il renvoie simplement à « une vieille affaire de famille : la liquidation de l’"héritage kantien"52 ». Or celle-ci est résolue depuis longtemps, et tout le monde s’accorde, au dire de Rancière, à proclamer sa disparition. L’unique question reste alors de savoir : « À quelle sauce mangerons-nous "le sujet" ?53 ». On voit donc mal pourquoi Althusser s’acharnerait autant sur un cadavre qui, pour comble, ne bouge plus guère. C’est donc qu’il y a autre chose. Le problème, en fait, c’est la place de l’humanisme au sein des luttes politiques réelles, son usage dans l’idéologie juridique bourgeoise, ou dans les contestations ouvrières (lorsque celles-ci réclament, par exemple, que l’économie soit mise au service de l’« homme »). C’est ici que l’on retrouve, chemin faisant, l’althussérisme comme théorie de l’éducation. L’idée est toujours de conforter le pouvoir de la science (marxiste) en libérant au besoin les prolétaires eux-mêmes de leurs propres mots d’ordre, lesquels seraient en fait solidaires, sans qu’ils ne s’en aperçoivent, de l’idéologie qu’ils pensent combattre. Au total, la critique de la catégorie de sujet, la pensée de l’histoire qui s’induit de son élision, tout cela apparaît comme la pièce maîtresse du dispositif conceptuel par lequel Althusser reconduit son propre pouvoir symbolique :
La « critique du sujet », la théorie du « procès sans sujet », c’est le tour qui permet au dogmatisme de parler à nouveau au nom de l’universel prolétarien, sans avoir à se poser la question de savoir d’où il parle et à qui54.
26 De toute manière, Rancière montre aisément qu’Althusser lui-même ne tient pas jusqu’au bout son projet de liquidation du sujet : les notions de « classe », ou de « mouvement ouvrier » ne sont-elles pas autant de façons de retrouver, dans le procès anonyme de l’histoire, des sujet unifiés55 ? Ce serait là le prix à payer si l’on souhaite distinguer a priori la théorie scientifiquement juste de ses faux-frères idéologiques. Mais, pour Rancière, ceci indique finalement que le problème n’est pas tant de se débarrasser du sujet (problème qui n’intéresse que les philosophes) que de se défaire de l’idée d’une nature humaine (levier de toutes les dominations), afin d’atteindre les luttes des hommes empiriques, mais cette fois pensés, contre toute théorie de l’éducation, comme se situant en rapport de compréhension directe avec l’histoire. Ce qui ne sera possible que par le biais d’« une politique des énoncés théoriques bien différentes d’Althusser56 », mais en revanche fort proche de Foucault.
Rancière lecteur de Foucault
27On ne tentera pas de juger du bien fondé d’une critique qui a aussi toutes les apparences d’un « meurtre du père ». Il faudra plutôt montrer deux choses : comment la conceptualité de La mésentente est déjà, pour une part, enveloppée dans La leçon d’Althusser ; comment la présence insistante de Foucault dans le livre donne à Rancière de quoi s’opposer à la perspective althussérienne, d’un côté, et, de l’autre, qu’elle le conduira à poser en termes de « subjectivation » son propos original.
28On pourrait s’étonner d’une référence positive à Foucault au sein d’un livre qui pour une part fustige, du point de vue politique, certaines dérives de l’anti-humanisme philosophique. Il est sans doute possible que le Foucault le plus « structuraliste », celui de Les mots et les choses, n’intéresse qu’indirectement Rancière. J’en veux pour preuve le bilan de la théorie philosophique d’avant Mai 68 – et spécialement de « l’idéologie "structuraliste" » – proposée dans la seconde partie de La leçon d’Althusser. Les thèmes alors en vogue – « Mort de l’homme, subordination du sujet à la loi du signifiant, mise en scène du sujet par les rapports de production » – vaudraient au fond surtout à titre de symptômes. Le problème est moins l’hypothétique rapport de Foucault, Lacan ou Althusser au thème de la structure, que la manière dont leur œuvre fut reçue au sein « d’une certaine "élite" universitaire ». Au point de croisement de ces divers travaux, ce que diagnostique Rancière, c’est d’abord l’émergence d’un rapport nouveau du savoir au pouvoir. La réception de ces œuvres témoigne surtout d’un « craquement » interne aux règles habituelles du jeu académique, soit « l’apparition de la politique sous une nouvelle forme, dans la question du savoir, de son pouvoir », et que précipitera Mai 6857. Rancière achève ce développement de façon ambivalente, laissant pendante, notamment, la question de savoir si l’effort de Foucault, par exemple, est à comprendre comme la réaction d’une élite menacée, ou si seule la lecture dont elle fut l’objet dans le champ universitaire témoigne de la crainte des maîtres et des mandarins : « Ce "structuralisme" où d’aucuns virent une philosophie de l’ordre immuable était bien plutôt la recherche d’un pouvoir nouveau des intellectuels sur la réalité58 ».
29Il est cependant notoire que Foucault, davantage qu’Althusser, échappe à cette critique. En effet, il est possible de repérer, au sein même de la conceptualité de La leçon, différentes interventions, toutes positives, de propositions foucaldiennes. J’en décris d’abord deux, les plus évidentes.
301/ La thèse d’Althusser selon laquelle l’idéologie bourgeoise, lorsqu’elle soutient que l’homme est sujet de l’histoire, trouve en Kant son « philosophe le plus "pur"59 », est battue en brèche par Rancière à partir d’un argument qui recoupe les thèses historiques de Les mots et les choses. Rancière avance que si Kant décrit effectivement les signes du « progrès de l’esprit humain » dans l’histoire, il ne dit pas pour autant que l’homme fait l’histoire. C’est que le concept d’homme qu’il met en jeu ne se rapporte pas au thème de l’histoire mais bien plutôt à la question anthropologique elle-même, sur laquelle Kant rabattait, dans sa Logique, les trois questions critiques. Pour le dire vite, la thèse althussérienne est dénuée de fondement de ce qu’elle projette sur l’interrogation kantienne une conception du sujet qui, à cette heure, n’avait pas cours ; plus profondément, elle repose sur « un concept d’histoire qui n’existe pas encore60 ». À cet égard, Rancière est en accord avec la position charnière que Les mots et les choses assigne à Kant au sein des ruptures épistémiques jalonnant l’histoire du savoir occidental. Selon Foucault, si Kant, par sa critique de la représentation classique, marque bien « le seuil de notre modernité », ce n’est pourtant que dans une « seconde phase », autour de 1800, que l’Histoire devient « l’incontournable de notre pensée » et que l’homme à proprement parler, « comme objet difficile et sujet souverain », apparaît61. Si Kant est bien celui qui va permettre de le penser, le sujet de l’histoire qu’Althusser croit repérer chez lui ne s’y trouve en fait aucunement.
312/ D’autre part, selon Rancière, le concept de l’homme impliqué dans la question anthropologique reste lié à l’interrogation sur « la nature de l’homme62 ». Sur ce point précis, il s’écarte quelque peu de la pensée de Foucault. C’est que la question anthropologique kantienne, suivant Les mots et les choses, parce qu’elle colore le transcendantal d’empirique, est déjà le signe d’une « réflexion de niveau mixte » caractéristique de la pensée moderne63. A l’inverse, pour Rancière, elle renvoie au thème de la « nature humaine » – soit celui-là même qui définissait, selon Foucault, la pensée classique. Cependant, l’essentiel, pour Rancière, est de montrer que l’homme ainsi compris n’est pas « le sujet conquérant de l’humanisme64 ». Il est l’homme du panoptique, tel que Bentham en a donné les principes. Et on reconnaît aisément, dans la description d’un « homme que l’on forme, assiste, surveille et mesure65 », les thèses essentielles de Surveiller et punir, qui paraîtra l’année suivante : le panoptique est bien « la figure architecturale » d’une « anatomie » du pouvoir où l’individu, par des techniques de surveillance, « est soigneusement fabriqué66 ». Rancière ne fait du reste pas mystère de sa source d’inspiration : dans ce qui précède, écrit-il, « on reconnaîtra l’enseignement de Michel Foucault au Collège de France67. »
32Mais la pensée de Foucault joue dans La leçon un rôle plus fondamental. Rancière oppose en fait deux choses à Althusser : une logique de l’égalité (contre une théorie de l’éducation) ; une façon d’étudier les discours (ceux de Marx y compris) qui ne serait pas fonction d’une « ligne de démarcation » entre orthodoxie et déviation posée par avance dans la théorie. Or, sur ce dernier point, il est patent que Rancière trace un sillon analogue à celui que Foucault, à partir de L’archéologie du savoir, commençait de creuser. Pour l’un comme pour l’autre, le problème est de trouver comment articuler justement pratique et discours. Et, jusque dans les termes choisis par Rancière, la solution proposée par La leçon d’Althusser paraît rejoindre, avec beaucoup de précision, ce que La volonté de savoir appellera « la règle de la polyvalence tactique des discours68 ». La question, en tout cas, est bien identique : comment le discours communique-t-il avec la pratique ? Et on sait que cette question est précisément à la source du grand livre théorique de Foucault, en 1969 : la notion de « pratique discursive » ne devait-elle pas le conduire à introduire toujours davantage, dans la matérialité du discours, les effets de pouvoir dont celui-ci est l’objet aussi bien que le sujet69 ? Il s’agit donc maintenant de montrer que Rancière, dans une conceptualité qui est celle-là même de Foucault, poursuit un dessein parallèle à l’analytique du pouvoir foucaldienne : rendre l’analyse historique du discours poreuse à la politique.
33Il importe de dépasser l’embarras qui est celui d’Althusser lorsqu’il constate que Marx lui-même n’est pas fidèle à la « coupure épistémologique » qui donne son impulsion à ses œuvres de maturité (quand, par exemple, il continue d’utiliser la notion d’aliénation au sein du Capital). Ces concepts problématiques, il faut se demander « quelle en est la fonction discursive » ; et il faut en conclure qu’il n’y a « pas une logique du Capital mais des logiques, des stratégies discursives différentes répondant à des problèmes différents70 ». Or qui ne sait qu’une analyse des formations discursives menées en termes de « fonctions » et de « stratégies » était précisément le cœur de L’archéologie du savoir ? Mais il y a plus. Ce que manque Althusser, c’est au fond la leçon de Surveiller et punir : « La formation des hommes nécessaires à la reproduction des rapports bourgeois se fait […] par les effets pratiques et discursifs de tout un système de discipline71 ». Si Althusser rate cela, c’est essentiellement parce que sa conception du discours est erronée ; c’est parce que « les mots ne sont pas pour lui des éléments de pratiques discursives articulées sur d’autres pratiques sociales mais des représentations des conditions existantes72 ».
34Tout le projet de Rancière – typiquement foucaldien – est donc bien de joindre l’analyse des discours (« pratiques discursives ») à celle de l’essaimage de la technologie disciplinaire (« système de discipline ») : la proximité ne peut être plus marquée. Aussi bien, lorsqu’il propose de penser « le pouvoir des mots » en étudiant les modalités sous lesquelles un même terme peut provoquer des effets de pouvoir diamétralement opposés (réactionnaires ou révolutionnaires), quand il indique que « tout se tranche non pas entre les mots […] mais dans les mots, dans leurs retournements et leurs torsions73 », on ne peut que penser à la perspective historique et stratégique que Foucault préconisait pour l’analyse des discours. Tout bien considéré, Rancière fait-il autre chose que prendre au sérieux l’avertissement de Foucault dans La volonté de savoir ? C’est qu’
il faut admettre un jeu complexe et instable où le discours peut être à la fois instrument et effet de pouvoir, mais aussi obstacle, butée, point de résistance et départ pour une stratégie opposée74.
35 On sait bien que, d’un point de vue théorique, l’inoculation de la pratique dans le discours, encore passablement difficile dans L’archéologie du savoir, se fit chez Foucault progressivement. Sans doute n’est-elle pleinement acquise que dans les grands ouvrages des années soixante-dix. Mais tout se passe comme si Rancière, en 1973, tirait déjà bénéfice des avancées récentes de la pensée de Foucault : l’importance de celle-ci, tant pour le point de départ polémique de La leçon d’Althusser (la critique de la reconstruction althussérienne des catégories de l’humanisme classique) que dans sa méthode et sa visée (une analyse menée en termes de « pratiques discursives » appliquée à un « système de discipline ») la signale comme un point d’appui incontournable lorsqu’il s’est agi, pour Rancière, de s’émanciper de son maître. Ainsi Foucault lui offrirait-il la clé d’une critique positive des positions d’Althusser ; à tout le moins dirons-nous que leur convergence proprement conceptuelle est maintenant solidement établie. On ne s’étonnera dès lors pas que Rancière, à l’issue de la rédaction de cet ouvrage, décida, selon un geste foucaldien, de se plonger de longues années dans les « archives un peu poussiéreuses75 » de l’auto-émancipation de la classe ouvrière. D’où résulta, en 1981, La nuit des prolétaires.
36
La subjectivation politique, entre Rancière et Foucault ?
37Dans La leçon d’Althusser, on l’a vu, Rancière dispose déjà en partie de la matrice conceptuelle de La mésentente. Une théorie de l’égalité y est jointe à un intérêt double, porté aux jeux de discours, comme à leurs effets pratiques. Si le premier thème est une création originale de Rancière, j’ai montré que le second emprunte pour sa part beaucoup à Foucault. Manque encore, pourtant, le fondement de l’ouvrage de 1995 (l’ontologie du « sensible ») et son point de culmination (la notion de « subjectivation »). Il est intéressant de constater que sur ces deux points également la proximité de Rancière à Foucault est avérée.
38J’esquisserai simplement le premier point. Un partage du sensible, finalement, est l’ensemble systématique des conditions sous lesquelles sont donnés et sont partagés, dans une formation historique spécifique, les ordres de l’être, du dire et du faire. Ce qui, en un moment et en un lieu donnés, est (in)visible, (in)dicible, (in)faisable, ressortit à certaines conditions qui règlent les modalités d’apparition du commun. Pour le dire brutalement, un partage du sensible est en ce sens une figure de l’a priori historique. Il est difficile de ne pas penser, à ce propos, aux différentes manières dont Foucault reprend continuellement la question kantienne de l’a priori, mais dans le sens de son historicisation maximale (voyez, par exemple, les notions d’épistémè, ou bien, à l’autre extrême de son parcours, celle de « pensée »76 ) : à chaque fois, la condition du déploiement d’une certaine séquence historique apparaît elle-même intégralement historique. Or un partage du sensible doit s’entendre dans une double détermination : politique, naturellement, mais aussi esthétique. De quelle esthétique s’agit-il ? À nouveau, Rancière est tout à fait clair à ce sujet : « Si l’on tient à l’analogie, on peut l’entendre en un sens kantien – éventuellement revisité par Foucault – comme le système des formes a priori déterminant ce qui se donne à ressentir77 ».
39D’autre part, il est remarquable que Rancière, à l’instar de Foucault, loin d’abandonner la catégorie de sujet, la réinvestisse, mais dans un sens profondément nouveau : un sens qui n’est pas redevable à la conception classique (ou essentialiste), et qui ne se contente pas pour autant de sa critique anti-humaniste. Encore une fois, il semble que sur ce point son œuvre prolonge certaines intuitions de Foucault. On sait que celui-ci, après avoir détruit dans ses fondements la notion classique de sujet (dans son archéologie et ses recherches sur la littérature), la réintroduira, mais d’abord dans un sens négatif (premièrement comme simple dérivée de la fonction énonciative, ensuite via le concept d’assujettissement, central dans sa généalogie du pouvoir), pour in fine esquisser le sens positif qui pourrait lui échoir (avec l’étude des pratiques éthiques de subjectivation). Surtout, chez nos deux auteurs, le problème est toujours identique : il s’agit de placer au centre de la réflexion un certain concept du sujet valant soit comme interruption d’un ordre policier, soit comme déplacement d’un dispositif de pouvoir-savoir, mais renvoyant toujours, au final (et pour le dire en termes foucaldiens), à une pratique de la résistance, voire à une expérience de la liberté.
40On se gardera néanmoins de conclure, à partir d’une identité terminologique, à une parfaite identité de contenu. La pensée de la subjectivation ranciérienne diffère profondément de son élaboration par Foucault. D’un mot, l’effort de Rancière ressortit à des motivations immédiatement politiques, tandis que le travail de Foucault doit se comprendre dans un cadre plus large, dont le centre est la question éthique, ici définie comme sphère du rapport de soi à soi (ce qui ne retranche rien de ses virtualités proprement politiques). L’indice de ceci est que la subjectivation, chez Rancière, est tout entière suspendue au thème de l’égalité (« le tort est […] le mode de subjectivation dans lequel la vérification de l’égalité prend figure politique78 »), tandis qu’elle est liée, par Foucault, au problème de la vérité79. Exemplairement, dans L’herméneutique du sujet, l’ascèse philosophique, l’ascèse propre aux pratiques de soi de l’Antiquité hellénistique et romaine, est décrite comme une « subjectivation du discours vrai » : elle est ce qui par exercice permet d’acquérir les discours vrais, c’est-à-dire d’en devenir le sujet. Il s’agit alors de
se rejoindre soi-même comme fin et objet d’une technique de vie, d’un art de vivre. Il s’agit de se rejoindre soi-même avec, comme moment essentiel, non pas l’objectivation de soi dans un discours vrai [comme c’était le cas dans l’ascèse chrétienne], mais la subjectivation d’un discours vrai dans […] un exercice de soi par soi80.
41Ce qui précède démontre combien la pensée de Foucault organise en profondeur la conceptualité de Rancière, de La leçon d’Althusser jusqu’à La mésentente. On voit en outre que c’est bien sous le signe de Foucault que la critique du « procès sans sujet » se poursuit et s’achève dans une conceptualisation de la subjectivation d’ailleurs pensée – selon un signifiant majeur du travail de Foucault – en terme de « dispositif ». Du coup, si la mise en lumière de cette proximité indéniable permet aussi de montrer que, malgré tout, Rancière et Foucault forgent des concepts de « subjectivation » qui ne se recoupent pas exactement, la question serait maintenant de savoir s’ils peuvent, pourtant, se compléter.
42En partant du problème auquel conduisait Zizek – celui de l’effectivité et, partant, de la durabilité, voire de l’institution éventuelle des procès de subjectivation politique –, la question pourrait se poser comme suit. Trouverait-on de quoi affronter ce redoutable problème en nouant d’un même fil les concepts de subjectivation forgés respectivement par Rancière et par Foucault ? La question de l’institution et de la consistance temporelle des procès politiques de subjectivation peut-elle être pensée au point de croisement des notions d’égalité (Rancière) et de vérité (Foucault) ? Plutôt que de l’éluder, un tel concept de la subjectivation pourrait-il assumer la question de la reconstitution durable et organisée de ce que défait le mouvement même de subjectivation politique ?
43Sur le simple mode de la suggestion, je signalerai qu’il existe effectivement une pensée philosophique du politique qui lie, à partir du concept de subjectivation, égalité et vérité : il s’agit du système d’Alain Badiou. Une précaution, néanmoins, avant d’en dire un mot. Il faut souligner que Zizek, dans l’article analysé précédemment, fait à Badiou des critiques analogues à celles qu’il adresse à Rancière : le problème essentiel, selon lui, c’est non seulement l’élision du « sujet » au profit de la « subjectivation », mais aussi, et plus encore, la distinction ontologique entre deux ordres du réel sur laquelle elle s’indexe (politique/police ou, dans ce cas, événement/être). Il s’agirait donc d’interroger également dans cette perspective la pensée badiousienne.
44 Le fait est que l’existence des vérités est pour Badiou « l’évidence empirique initiale » ; l’essence de la vérité cependant ne s’y réduit pas, et l’effort de l’auteur est d’abord pour en dévoiler la condition proprement transcendantale. Reste que quatre procédures (domaines ou « conditions ») possibles de vérité sont selon lui à distinguer, et l’une d’entre elles est réputée « politique ». Une vérité, ici, est toujours un processus qui, se détachant sur fond d’une multiplicité ontologique, apparaissant sur un mode événementiel, fend l’ordre de l’être qui le porte81. Sera dit « sujet » le corps (concept qui n’est pas seulement à entendre dans un sens « bio-subjectif » : il peut s’agir d’un parti, d’une déclaration …) qui sur cette scission se greffe pour la localiser. La greffe s’effectue selon une certaine logique, plus ou moins réactionnaire ou révolutionnaire, selon qu’elle tend à forclore ou à intensifier l’événement fondateur : s’il y a un sujet fidèle, il y a aussi un sujet réactif et un sujet obscur. Ce qui localise et tient point par point une vérité, c’est alors précisément ce que Badiou nomme « subjectivation » : elle est ce qui témoigne activement et permet l’identification dans ses conséquences d’une vérité, par exemple politique82. Enfin, selon son lexique, une vérité politique a toujours pour noyau une quadruple détermination entre les pôles de laquelle circule le sujet : volonté, confiance, autorité, égalité. Aussi une subjectivation politique, incarnation fidèle de l’événement d’une vérité, devra-t-elle toujours affronter la confiance de sa volonté à une dialectique de l’égalité et de l’autorité83. S’étonnera-t-on dès lors que Badiou, de ce qu’il construit son concept de subjectivation politique en nouant le problème de la vérité à celui de l’égalité, affronte pour sa part le problème que Rancière, peut-être, évitait : celui de la spécification empirique précise desdits procès de subjectivation, et celui de leur temporalité, c’est-à-dire de leur organisation84. C’est dans ce cadre que s’inscrit la méditation – poursuivie récemment dans L’hypothèse communiste – de l’« échec » caractéristique des événements politiques récents (de la Commune de Paris à Mai 68 en passant par la Révolution Culturelle)85. Ce serait donc sa manière de poser la question de la subjectivation (entre Rancière et Foucault, dira-t-on en forçant le trait), qui amène Badiou à retrouver une question portée notamment par Deleuze et Guattari : celle de la capacité de former, lors d’« une mutation sociale », « des agencement collectifs correspondant à la nouvelle subjectivité » liée à cette événementialité86. C’est elle, en tout cas, qui introduit Badiou à une réflexion – en cours – sur un mode d’organisation de la processualité politique qui cesserait de se subjectiver dans la forme du « parti ».
45Ce bref détour par Badiou ne permet pas de conclure si une pensée consistante de la subjectivation politique se doit nécessairement d’articuler les concepts de vérité et d’égalité. Il faudrait encore, ailleurs, prendre la mesure du fait que la dimension proprement transcendantale de la pensée badiousienne (du politique) ne se colore, à la différence de ce que l’on a pu constater chez Rancière comme chez Foucault, d’aucun historicisme87 ; ce qui affecte forcément de particularités, chez chacun de ces auteurs, le sens des notions – sujet, égalité, vérité – qui néanmoins, à chaque fois, apparaissent nécessaires à la détermination de notre problème.
46Car il faut reconnaître que ces catégories demeurent, comme l’exigence de poser et de penser une instance subjective lorsqu’il s’agit de décrire l’événement de la politique dans la durée de son procès. Une dernière question s’imposerait alors au carrefour de ces diverses tentatives philosophiques, quant au nom qu’il convient d’attribuer à cette notion de la politique. Chez Rancière, l’institution de la subjectivation politique s’intitulait simplement « démocratie ». Or, même selon le sens, irréductible à son usage dominant, que ce dernier lui donne, Badiou préconise d’abandonner cette notion à ses yeux trop comprise avec le « matérialisme démocratique » caractéristique du capitalisme parlementaire88. On le voit : bien qu’encore incertain, ce que le concept de subjectivation politique dégagé ci-dessus permet déjà d’affirmer, c’est que les catégories héritées de la « philosophie politique » classique – ainsi la topologie des différents régimes politiques, modes de gouvernement et constitutions –, ne peuvent être plus longtemps reçues sans examen. Ordonnée à l’exigence d’égalité, à l’épreuve d’une vérité, tout semble ainsi indiquer que l’élaboration rigoureuse d’une « subjectivation politique » impose de reconsidérer, dans la théorie autant que dans les faits, la notion de « démocratie » elle-même – le mot autant que la chose, au moins telle que nous en faisons quotidiennement l’expérience89. Sans inutilement chercher à dramatiser le propos, ou à effaroucher nombre de nos contemporains, il semblerait que cette évaluation nouvelle – à être menée, pour le dire d’une formule, sous les doubles auspices de la communauté des égaux (Rancière) et du courage de la vérité (Foucault) –, ne pourra qu’échapper à la conceptualité traditionnelle de la « philosophie politique ». C’est dire qu’elle sera l’affaire, indissociablement, de la philosophie critique et de la politique proprement dite – soit, au sens radical de L’idéologie allemande, d’une politique communiste : « Le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l’état actuel. »
Notes
Para citar este artículo
Acerca de: Thomas Bolmain
Thomas Bolmain est aspirant F.R.S.-FNRS attaché à l’Unité de Recherches en philosophie politique et philosophie critique des normes de l’université de Liège. Il rédige actuellement une thèse de doctorat intitulée Les kantismes de Foucault. Une expérience critique de la pensée.