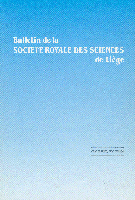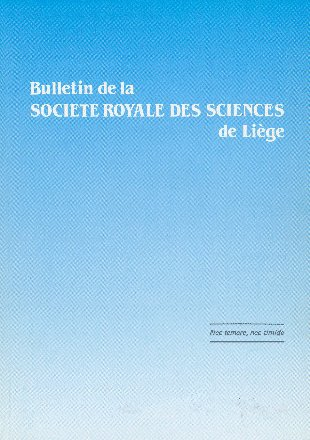- Accueil
- Volume 94 - Année 2025
- No 2 - Colloque Annuel 2025: L'art au service de l...
- L’archéométrie au service de l’histoire de l’architecture. Quelques cas du haut Moyen Âge
Visualisation(s): 152 (10 ULiège)
Téléchargement(s): 53 (3 ULiège)
L’archéométrie au service de l’histoire de l’architecture. Quelques cas du haut Moyen Âge

Document(s) associé(s)
Version PDF originaleRésumé
Cette étude explore l’apport de l’archéométrie à l’analyse de l’architecture du haut Moyen Âge, dont les vestiges demeurent souvent fragmentaires. Trois sites emblématiques ont été examinés. À Chèvremont (Belgique), les prospections GPR ont révélé des structures inédites et permis de réévaluer l’organisation d’un complexe architectural. À Amay (Belgique), de nouvelles datations radiocarbone révisent la chronologie des édifices religieux, mettant en évidence une première église dès la fin du Ve siècle. À Germigny-des-Prés (France), les analyses PXRF et LA-ICP-MS des mosaïques carolingiennes montrent la diversité des recettes de verre employées et l’existence probable de plusieurs ateliers, tandis que les cubes dorés et argentés révèlent une production spécifique au chantier. L’ensemble de ces résultats souligne l’importance de l’archéométrie pour restituer l’apparence, la chronologie et le fonctionnement des architectures carolingiennes, révélant une période plus riche que ne le laissent supposer les vestiges conservés.
Abstract
This study highlights the contribution of archaeometry to the analysis of Early Medieval architecture, whose remains are often fragmentary. Three emblematic sites were investigated. At Chèvremont (Belgium), GPR surveys revealed previously unknown structures and enabled a reassessment of the layout of a fortified complex mentioned as early as 779. At Amay (Belgium), new radiocarbon dates significantly revise the chronology of the religious buildings, indicating the existence of a first church as early as the late 5th century. At Germigny-des-Prés (France), PXRF and LA-ICP-MS analyses of Carolingian mosaics demonstrate the diversity of glass recipes used and the probable involvement of multiple workshops, while the homogeneous composition of gilded and silvered tesserae suggests production specifically dedicated to the site. Together, these results underline the value of archaeometric approaches for reconstructing the appearance, chronology, and functioning of Carolingian architecture, revealing a period that was more sophisticated and visually rich than previously assumed.
Table des matières
Manuscrit reçu le 17 novembre 2025 et accepté le 19 novembre 2025
Article publié selon les termes et conditions de la licence Creative Commons CC BY 4.0.
Communication invitée présentée au colloque annuel de la Société Royale des Sciences de Liège sur « L’art au service de la science, la science au service de l’art », Université de Liège (Belgique), 28 novembre 2025.
1. Introduction
1À la fin de l’Antiquité, suite à la chute de l’Empire romain d’Occident, le centre politique de l’Europe se déplaça du sud vers le nord et le pouvoir passa aux mains des rois francs. Après une période mérovingienne au cours de laquelle l’architecture monumentale semble s’effacer, la fin de cette époque est marquée par une christianisation croissante ainsi que par une intensification des fondations d’églises et d’abbayes, largement dotées par l’aristocratie (Caillet, 2005). Cet aspect de la culture matérielle revêt une importance particulière, dans la mesure où les Carolingiens et leur entourage durent consolider une position récemment acquise (Le Jan, 2010). Si l’ascension sociale et politique d’individus pouvait être favorisée par leur charisme, l’ostentation de la richesse demeurait essentielle pour projeter une image de réussite politique (Wickham, 2005; McCormick, 2008). Parmi ces manifestations de prestige, la construction d’édifices richement décorés occupait une place centrale.
2Au nord des Alpes, les familles aristocratiques disposaient donc de ressources suffisantes pour ériger ou restaurer des lieux de culte et bâtiments résidentiels (McCormick 2007). Pourtant, pour cette période qualifiée de « Renaissance carolingienne », les résidences aristocratiques demeurent extrêmement rares—à l’exception de quelques cas remarquables situés au cœur des terres franques, tels Paderborn (Gai, 2001) ou Aix-la-Chapelle (Pohle, 2015)—et restent largement méconnues (Caillet, 2005; Lebecq, 2000). La plupart des églises ne sont pas conservées et l’architecture monumentale n’est appréhendée que par des fouilles partielles, souvent anciennes. Il convient dès lors de mobiliser les méthodes scientifiques les plus performantes afin d’exploiter au mieux ces témoignages fragmentaires.
3Cette contribution s’appuie sur trois études de cas. Le premier site a été exploré par prospection géophysique, à l’aide du radar sol (GPR, Ground Penetrating Radar). Le second a fait l’objet de datations radiocarbone. Dans le troisième cas, des analyses de matériaux ont permis de restituer le décor originel et d’en apprécier la richesse. L’archéométrie offre ainsi la possibilité de revisiter non seulement l’histoire de ces sites, mais également celle de l’architecture du haut Moyen Âge.
2. La colline de Chèvremont (Province de Liège, Belgique)
4Actuellement en cours de fouille et occupée par une basilique et un couvent du xixe siècle, la colline de Chèvremont est mentionnée pour la première fois dans un diplôme de Charlemagne daté de 779, confirmant les donations faites par Pépin II à l’abbaye Sainte-Marie. Le site, alors nommé Novo Castello, devait être fortifié. Des sources ultérieures attestent l’existence d’une abbaye, et la présence d’un habitat aristocratique est suggérée. La place forte fut démantelée en 987 par les armées de Notger, évêque de Liège, et de l’impératrice Théophano (Josse, 1988).
5Les vestiges archéologiques mis au jour lors de diverses campagnes de fouilles, entre 1852 et les années 1960, comprennent une enceinte monumentale ceinturant le sommet de la colline ainsi qu’un vaste complexe bâti occupant l’extrémité occidentale du plateau. Associées à plusieurs sépultures, ces structures ont été interprétées comme les vestiges d’une abbaye dotée d’un cloître et d’une église en bord de plateau (Hoffsummer-Bosson, 1988).
6Les prospections GPR ont permis d’identifier, au nord de la basilique, deux longues anomalies formant un angle droit dans une zone où aucune structure n’était connue. Elles ont également permis de restituer une partie des vestiges mis au jour dans les années 1960. Si les plans concordent en grande partie, plusieurs murs situés hors des anciennes tranchées de fouille étaient restés inédits. Le GPR a affiné la compréhension de l’organisation de certains secteurs et conduit à réviser la fonction de plusieurs bâtiments : notamment celle du vaste édifice interprété comme une église, qui apparaît en réalité subdivisé en trois espaces ; de même, le cloître présumé pourrait correspondre à un espace compartimenté.
3. La collégiale d’Amay (Province de Liège, Belgique)
7Les fouilles menées depuis 1962 sur le site de l’actuelle collégiale d’Amay ont révélé, outre le célèbre sarcophage de Chrodoara, plusieurs édifices religieux succédant à un établissement antique. Les fouilleurs (Thirion, 2006) identifiaient ces vestiges à une première église de plan basilical, probablement celle où Chrodoara aurait été inhumée et mentionnée dans le testament d’Adalgisel Grimo en 634. Une seconde église, réutilisant partiellement les murs de la première, aurait été érigée à l’occasion de l’élévation des reliques de Chrodoara/Ode dans la première moitié du viiie siècle. Une troisième église, datée du xie siècle, légèrement désaxée, se présentait comme une nef unique à chœur carré et chevet plat, dotée d’une tour occidentale. L’édifice roman du xiie siècle subsiste encore partiellement dans la collégiale actuelle, profondément remaniée entre le xve et le xixe siècle (Lethé, 2000).
8De nouvelles datations radiocarbone effectuées sur des charbons piégés dans les mortiers permettent aujourd’hui de réviser cette chronologie (Delye et al., 2023). La première église pourrait dater de la fin du ve ou du début du vie siècle, à une époque où ce type d’édifice est rare et serait donc antérieure à Chrodoara. Des remaniements au cours de la seconde moitié du vie siècle pourraient correspondre aux interventions de Chrodoara venue s’installer à Amay sans doute vers 589 et qui enrichit le sanctuaire (Dierkens, 2010). Un second édifice pourrait remplacer le premier dans la première moitié du viiie siècle, peut-être en lien avec l’élévation des reliques vers 730 et la réalisation d’un nouveau couvercle décoré pour le sarcophage–reliquaire. La troisième église demeure mal datée.
4. Germigny-des-Prés (Loiret, France)
9Le site de Germigny-des-Prés est étroitement lié à l’aristocratie carolingienne et à Théodulphe. Originaire d’Espagne et issu d’une famille aisée, Théodulphe quitte son pays sous la pression des invasions maures et rejoint la cour franque, où ses qualités intellectuelles sont rapidement reconnues. Entre 791 et 793, il compose, à la demande de Charlemagne, l’Opus Caroli regis contra synodum. En récompense, le roi le nomme abbé de Fleury et évêque d’Orléans, sans doute en 797 ou 798. À Germigny-des-Prés, la villa appartenant à l’abbaye de Fleury fut transformée par Théodulphe en résidence de campagne, dotée d’un oratoire richement décoré. L’église actuelle conserve une partie de l’édifice carolingien, ainsi que les seules mosaïques carolingiennes conservées in situ au nord des Alpes (Sapin, 2019).
10Des analyses PXRF ont été réalisées directement sur les mosaïques de l’abside orientale, complétées par des analyses LA-ICP-MS sur des cubes découverts en fouille. Les observations in situ ont permis de distinguer les éléments restaurés au xixe siècle : la restauration concerne principalement l’arrière-plan, tandis que la majorité des personnages est d’origine. Ainsi, une grande partie des cubes de verre remonte encore à l’époque carolingienne.
11La fabrication du verre coloré impliquant des savoir-faire spécialisés et des ateliers centralisés, la présence d’au moins deux recettes distinctes pour chaque couleur suggère l’utilisation de matériaux provenant de sources ou d’ateliers différents. Le recyclage de cubes anciens pourrait également expliquer cette variabilité. En revanche, les cubes dorés et argentés, très homogènes, présentent des techniques de fabrication spécifiques, indiquant une production dédiée au chantier de Germigny-des-Prés. Ces observations confirment les moyens considérables mobilisés par les commanditaires pour cette œuvre exceptionnelle.
5. Conclusion
12Ces trois études de cas illustrent l’apport des méthodes issues de la physique et de la géophysique à la connaissance d’une architecture ancienne souvent conservée de manière lacunaire. Qu’elles soient appliquées aux fondations, aux élévations ou aux décors, ces techniques « font parler » les murs et permettent de mieux comprendre tant l’organisation des bâtiments que leur apparence originelle. Elles révèlent une architecture plus précoce, mais aussi plus grandiose, plus colorée et plus riche que ce que l’on imaginait. Elles contribuent ainsi à renouveler profondément notre perception d’une période encore trop souvent décrite comme un « âge sombre », alors que le déficit de sources et de méthodes adaptées constitue en réalité l’un des principaux obstacles à son appréhension.
Remerciements
13Les analyses réalisées en amont de cette contribution ont été financées par des projets de recherches obtenus à l’ULiège et au Fonds de la Recherche Scientifique–FNRS.
Informations supplémentaires
Contributions des auteurs
14L. Van Wersch a mené les différents projets en lien avec l’architecture carolingienne. Elle en a assuré la gestion et une partie du financement. Elle a participé à l’ensemble des analyses et à leur interprétation. Elle est également rédactrice de l’article. E. Delye mène les recherches sur le site d’Amay. Il a également participé aux prospections sur le site de Chèvremont. D. Henrard a participé aux prospections sur le site de Chèvremont dont il co-dirige la fouille. C. Camerlynck a réalisé les prospections GPR à Chèvremont. F.-P. Hocquet a réalisé les analyses in situ à Germigny-des-Prés. D. Strivay a assuré le financement du projet concernant les analyses à Germigny-des-Prés. B. Gratuze a réalisé les analyse LA-ICP-MS et participé à la rédaction des rapports et articles sur le sujet.
Conflits d’intérêt
15Les auteurs déclarent l’absence de tout conflit d’intérêt.
Bibliographie
Caillet, J.-P. (2005) L’art carolingien. Tout l’art. Flammarion, Paris (FR).
Delye, E., Witvrouw, J., et Van Wersch, L. (2023) Amay/Amay : datations par 14C des structures bâties mises au jour sous l’actuelle collégiale Saint-Georges-et-Sainte-Ode. Propositions pour une nouvelle interprétation des édifices religieux. Chronique de l’Archéologie Wallonne, t. 31, p. 141–145. Institut du Patrimoine wallon (IPW). https://ediwall.wallonie.be/chronique-de-l-archeologie-wallonne-31-2023-actualite-archeologique-2022-2023-133199.
Dierkens, A. (2010) Chrodoara est-elle d’origine aquitaine ? Note sur le dossier hagiographique de sainte Ode d’Amay. Dans Saints d’Aquitaine : missionnaires et pèlerins du haut Moyen Âge, édité par Bozoky, E., p. 173–188. Presses universitaires de Rennes, Rennes (FR). https://doi.org/10.4000/books.pur.131853.
Gai, S. (2001) Die karolingische Pfalzanlage. Von der Dokumentation zur Rekonstruktion. Dans Splendor palatii. Neue Forschungen zu Paderborn und anderen Pfalzen der Karolingerzeit, édité par Fenske, L., Jarnut, J., et Wemhoff, M., Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, t. 5, p. 71–100. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (DE).
Hoffsummer-Bosson, A. (1988) Chèvremont : L’apport des sources archéologiques. Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 100, 71–87. https://ialg.be/publication/tome-c-annee-1988/. Chèvremont, un millénaire, un tricentenaire, 987–1688, 1988 : Actes du colloque tenu à Chèvremont le 22 avril 1988.
Josse, M. (1988) Les sources historiques. Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 100, 13–20. https://ialg.be/publication/tome-c-annee-1988/. Chèvremont, un millénaire, un tricentenaire, 987–1688, 1988 : Actes du colloque tenu à Chèvremont le 22 avril 1988.
Le Jan, R. (2010) Prendre, accumuler, détruire les richesses dans les sociétés du haut Moyen Âge. Dans Les élites et la richesse au Haut Moyen Âge, édité par Devroey, J.-P., Feller, L., et Le Jan, R., Haut Moyen Âge, t. 10, p. 365–382. Brepols Publishers, Turnhout (BE). https://doi.org/10.1484/M.HAMA-EB.3.4675.
Lebecq, S. (2000) The role of monasteries in the systems of production and exchange of the frankish world between the seventh and ninth centuries. Dans The Long Eight Century: Production, Distribution and Demand, édité par Hansen, I. L. et Wickham, C., The transformation of the Roman world, t. 11, p. 121–148. Brill, Leiden (NL). https://doi.org/10.1163/9789004473454_008.
Lethé, J.-N. (2000) L’église Saint-Georges et Sainte-Ode d’Amay. Essai de lecture archéologique avant restauration. Rapp. tech., Université catholique de Louvain, Centre d’Histoire et d’Architecture.
McCormick, M. (2008) Discovering the early medieval economy. Dans The Long Morning of Medieval Europe. New Directions in Early Medieval Studies, édité par Davis, J. R. et McCormick, M., p. 13–18. Ashgate, Aldershot.
Pohle, F. (2015) Die Erforschung der karolingischen Pfalz Aachen: Zweihundert Jahre archäologische und bauhistorische Untersuchungen, Rheinische Ausgrabungen, t. 70. von Zabern, Darmstadt (DE).
Sapin, C. (2019) Germigny-des-Prés, un nouveau regard. Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA, Hors-série no 11. https://doi.org/10.4000/cem.16003.
Thirion, E. (2006) Le site archéologique de la collégiale Saint-Georges d’Amay. Dans Le sarcophage de sancta Chrodoara. 20 ans après sa découverte exceptionnelle, édité par Dierkens, A., Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye–Condroz, t. 25, p. 19–29. Cercle archéologique Hesbaye–Condroz, Amay (BE).
Wickham, C. (2005) Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400–800. Oxford University Press, Oxford (UK). https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199264490.001.0001.
Pour citer cet article
A propos de : Line Van Wersch
Line.VanWersch@uliege.be