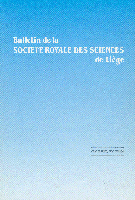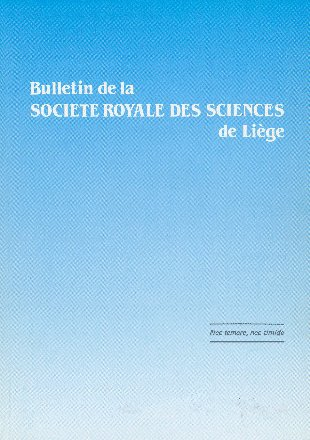- Accueil
- Volume 94 - Année 2025
- No 2 - Colloque Annuel 2025: L'art au service de l...
- Sciences culinaires : quand la gastronomie se met au service de la science
Visualisation(s): 153 (9 ULiège)
Téléchargement(s): 60 (0 ULiège)
Sciences culinaires : quand la gastronomie se met au service de la science
Quand les sciences gastronomiques permettent d’étudier la santé, la société, la cognition, la durabilité et l’innovation

Document(s) associé(s)
Version PDF originaleTable des matières
Manuscrit reçu le 17 novembre 2025 et accepté le 18 novembre 2025
Article publié selon les termes et conditions de la licence Creative Commons CC BY 4.0.
Communication invitée présentée au colloque annuel de la Société Royale des Sciences de Liège sur « L’art au service de la science, la science au service de l’art », Université de Liège (Belgique), 28 novembre 2025.
1. Introduction
1La gastronomie est traditionnellement perçue comme un art, un patrimoine culturel et une pratique sociale. Toutefois, dans les dernières décennies, elle est devenue un terrain d’étude privilégié pour de nombreuses disciplines scientifiques. Bien au-delà du mouvement de « cuisine moléculaire », la gastronomie est aujourd’hui mobilisée comme un outil méthodologique, un objet d’étude transversal, et un laboratoire expérimental permettant d’examiner des phénomènes complexes : santé, cognition, durabilité, comportements sociaux, innovations technologiques, et systèmes alimentaires.
2Ce résumé étendu présente les principaux axes de la conférence en montrant comment la gastronomie contribue activement à la production de connaissances scientifiques contemporaines. À travers des cas concrets et des exemples locaux et internationaux, il devient manifeste que la cuisine n’est plus seulement nourrie par la science : elle la nourrit en retour.
2. Gastronomie et santé : un outil pour comprendre le vivant
2.1. Les aliments fermentés traditionnels comme support du microbiote
3L’explosion récente des recherches sur le microbiote intestinal a placé les aliments fermentés au centre de l’attention scientifique. Le kimchi, par exemple, n’est pas uniquement un symbole de la culture culinaire coréenne : il est devenu un modèle d’étude biologique. Plusieurs travaux ont montré que la consommation régulière de kimchi, de boissons fermentées ou encore de yaourt fermenté augmente la diversité microbienne dans l’intestin, un indicateur associé à une meilleure santé métabolique.
4Une étude menée à Stanford en 2021 a démontré que l’introduction d’aliments fermentés dans l’alimentation quotidienne augmentait la diversité microbienne plus efficacement qu’un régime riche en fibres. La gastronomie traditionnelle coréenne, japonaise ou belge (pain au levain, fromages affinés, kombucha) devient ainsi un réservoir naturel pour l’étude des relations entre micro-organismes et santé humaine.
2.2. Gastronomie et nutrition de précision
5La médecine moderne demeure largement centrée sur une approche curative, dans laquelle la nutrition du patient, qu’il soit en cours de traitement ou en phase post-thérapeutique, reste encore insuffisamment intégrée. Pourtant, une alimentation adaptée, individualisée et évolutive constitue un déterminant majeur du soutien physiologique, notamment pour accompagner l’organisme dans sa réponse immunitaire, la gestion des effets secondaires et la récupération métabolique. Faute de ressources ou de référentiels consolidés, les praticiens se trouvent souvent démunis face à des patients dont les habitudes alimentaires se modifient sous l’effet des traitements, ou qui maintiennent des pratiques nutritionnelles susceptibles d’aggraver leur condition.
6Dans ce contexte, des travaux de recherche émergent autour du développement d’outils et de méthodologies permettant de diagnostiquer les altérations de la perception sensorielle induites par les chimiothérapies—notamment les perturbations du goût, de l’odorat et des textures perçues. Ces dispositifs visent à orienter la création de menus personnalisés, adaptés aux profils sensoriels évolutifs des patients. Ils s’appuient sur des approches culinaires innovantes telles que le Foodpairing, la combinaison aromatique, ou encore l’ingénierie des textures, afin de réconcilier satisfaction gustative, apport nutritionnel et tolérance thérapeutique.
3. Gastronomie et cognition : le repas comme fenêtre sur le cerveau et les comportements
3.1. Études de créativité culinaire
7La création culinaire offre un terrain exemplaire pour l’étude des processus cognitifs. À l’instar des musiciens ou des architectes, les chefs mobilisent des réseaux neuronaux complexes. Une équipe du CNRS a conduit des sessions d’IRM fonctionnelle avec des chefs étoilés composant un plat imaginaire. Les résultats montrent que leur activité cérébrale combine zones de la mémoire sensorielle, du raisonnement abstrait et des émotions, rapprochant la créativité culinaire de la composition musicale.
3.2. Psychologie des choix alimentaires
8Les plats gastronomiques permettent aussi d’examiner les mécanismes attentionnels et décisionnels et notamment, le rôle des couleurs et des textures, l’impact du contexte de dégustation ou encore les attentes influencées par le storytelling ou le dressage.
9Le laboratoire d’expériences sensorielles de l’Université d’Oxford a démontré que la perception de l’amertume dans un café change selon la couleur de la tasse, révélant la forte interaction entre signaux visuels et perception gustative.
3.3. L’étude du comportement de consommation pour la détection de maladie ou l’étude de l’acceptabilité de nouveaux produits.
10La cinétique alimentaire—c’est-à-dire l’ensemble des comportements observables lors de la prise de repas—constitue un indicateur précieux de l’état de santé d’un individu, mais également de son appréciation du menu proposé. Des paramètres tels que le nombre et la taille des bouchées, la séquence de consommation, la force exercée sur l’assiette, la nature des gestes, ou encore la proportion d’aliments effectivement ingérée fournissent des données fines permettant d’analyser la relation entre le consommateur et son repas. Ces variables, souvent imperceptibles à l’observation humaine directe, offrent un accès unique aux dimensions physiologiques, sensorielles et psycho-comportementales de l’acte alimentaire.
11Dans cette perspective, le Laboratoire en Sciences Gastronomiques de l’Université de Liège a conçu un plateau repas connecté capable de mesurer, en temps réel, ces multiples paramètres cinétiques. Cet outil technologique permet de capter et d’analyser les données tout au long du repas, ouvrant la voie à des applications innovantes. En maison de repos, il peut contribuer à la détection précoce de phénomènes de dénutrition ou de modifications des capacités motrices. Dans un cadre de recherche, il permet également d’étudier les facteurs d’acceptation de nouveaux produits alimentaires, en offrant une lecture objective et quantitative des comportements de consommation.
4. Gastronomie et écologie : la cuisine comme modèle d’économie circulaire
4.1. Systèmes alimentaires et durabilité
12La gastronomie contemporaine joue un rôle central dans la transition écologique. Les restaurants engagés deviennent des « micro-laboratoires » pour éprouver des modèles durables tels que la réduction du gaspillage, la valorisation des déchets organiques, le recours à un approvisionnement local ou encore l’analyse du cycle de vie des ingrédients.
13Le Nolla situé à Helsinki est l’un des premiers restaurants européens à fonctionner entièrement sans déchet : toutes les chutes alimentaires sont transformées (bouillons, fermentations, pickles), le compost produit sur place, les menus sont conçus selon la disponibilité réelle, non selon une carte fixe. En outre, ce restaurant est aujourd’hui observé par des chercheurs en sciences environnementales qui étudient comment transposer ces pratiques à plus grande échelle.
5. Gastronomie et innovation technologique : la cuisine comme plateforme d’expérimentation
5.1. Impression 3D et nouvelles matrices alimentaires
14À l’instar de l’impression 3D appliquée aux biomatériaux, l’impression 3D alimentaire mobilise l’étude de propriétés physicochimiques telles que la viscosité, l’élasticité ou la stabilité thermomécanique des matrices alimentaires. Cette approche permet non seulement d’explorer de nouvelles fonctionnalités pour les aliments, mais également d’ouvrir la voie à des applications inédites dans les domaines de la création culinaire, de la nutrition ou de la santé.
15Le Laboratoire en Sciences Gastronomiques de l’Université de Liège a notamment développé une technologie d’impression 3D de chocolat, offrant aux chocolatiers un outil de créativité avancé tout en permettant l’étude systématique de l’impact des formes imprimées sur les propriétés sensorielles du produit, telles que la perception aromatique et la fracturation en bouche.
16Parallèlement, une imprimante 3D adaptée aux matrices protéinées est en cours d’optimisation pour la nutrition des personnes âgées présentant des troubles de la déglutition. Cette technologie permet de concevoir des aliments à haute valeur nutritionnelle dont les textures sont spécifiquement modulées afin d’améliorer la sécurité et le confort de la prise alimentaire, tout en préservant l’attractivité visuelle et gustative des repas.
17Enfin, l’entreprise Nourished (UK) imprime des compléments alimentaires personnalisés sous forme de bonbons multicouches. Leur technologie inspire aujourd’hui des recherches dans le domaine pharmaceutique.
5.2. Optimisation et développement de procédés de cuisson respectueux et durables
18L’étude des procédés de cuisson à travers une approche culinaire offre la possibilité de développer des aliments présentant des qualités nutritionnelles et organoleptiques optimisées, améliorant ainsi leur acceptabilité par les consommateurs. Cette démarche permet également d’identifier et de concevoir des modes de cuisson plus efficients sur le plan énergétique, contribuant à la transition vers une industrie agroalimentaire plus durable ainsi qu’à la mise au point d’équipements domestiques moins énergivores.
19Dans cette perspective, le suivi précis des paramètres de cuisson, leur modélisation ou encore l’analyse acoustique des sons produits lors des transformations thermiques constituent autant d’outils pour approfondir la compréhension de ces procédés traditionnels. Par ailleurs, l’exploration de technologies émergentes, telles que la cuisson ohmique en batch, ouvre de nouvelles opportunités : ce mode de chauffage permet d’obtenir des cuissons homogènes en un temps extrêmement réduit, favorisant le maintien des qualités nutritionnelles des produits tout en diminuant considérablement la consommation énergétique—jusqu’à un facteur cinquante par rapport aux méthodes conventionnelles.
6. Gastronomie et vulgarisation : un médium puissant pour diffuser la science
20La cuisine constitue un langage universel, capable de rendre accessibles des concepts complexes.
6.1. Rôle des chefs
21Des chefs contemporains collaborent avec des laboratoires pour diffuser la connaissance auprès des consommateurs : Heston Blumenthal avec Cambridge, Ferran Adrià avec Harvard, ou encore des influenceurs scientifiques utilisant la cuisine comme point d’entrée pédagogique.
7. Conclusion
22Ce panorama montre que la gastronomie n’est pas seulement un champ culturel et esthétique, mais un véritable instrument scientifique. Elle permet :
-
d’étudier les relations complexes entre alimentation, santé et des écosytèmes complexes ;
-
d’explorer les mécanismes cognitifs et comportementaux ;
-
de tester des modèles écologiques reproductibles ;
-
d’expérimenter de nouvelles technologies ;
-
de vulgariser des concepts scientifiques de manière accessible et sensorielle.
23En se mettant au service de la science, la gastronomie devient un espace où le vivant, la technique, la culture et l’imaginaire se rencontrent. À travers elle, il devient possible de penser l’alimentation de demain, mais aussi de mieux comprendre l’humain dans toute sa complexité.
Informations supplémentaires
Conflits d’intérêt
24Les auteurs déclarent l’absence de conflits d’intérêt.
Pour citer cet article
A propos de : Dorothée Goffin
dorothee.goffin@uliege.be