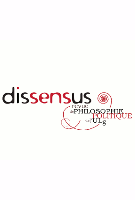- Accueil
- N° 4 (avril 2011)
- Dossier : Efficacité : normes et savoirs
- De la déraisonnable efficacité des modèles
Visualisation(s): 2224 (143 ULiège)
Téléchargement(s): 476 (12 ULiège)
De la déraisonnable efficacité des modèles

Table des matières
Introduction. Scientifiques occidentaux et stratèges chinois
1A l’occasion d’une conférence prononcée à l’Université de Liège en octobre 2009, François Jullien a posé cette question, que l’on trouve déjà dans les textes de Joseph Needham, le spécialiste de l’histoire des sciences chinoises : Pourquoi, alors que, jusqu’aux 15ème- 16ème siècles, la Chine était en avance sur l’Europe, l’Europe a-t-elle ensuite décollé et, très vite distancé, la Chine? Selon Fr. Jullien, le succès des Occidentaux est lié à l’utilisation par Galilée du modèle mathématique et à l’idée que Dieu a écrit le monde en langage géométrique. « Idée folle, nous a dit Jullien, personne n’a pu expliquer pourquoi ça marche, mais ça marche, et ça a fait le succès de l’Europe ». Galilée a inventé la physique mathématique et cette invention a marqué le début d’une extraordinaire aventure, celle de la science moderne, fondée sur l’application au réel des modèles idéaux des mathématiques.
2Idée folle, écrit ailleurs Jullien, parce que, même aujourd’hui, personne ne comprend « la déraisonnable efficacité des mathématiques »1. Les Chinois eux aussi, avaient une mathématique, mais ils n’ont jamais pensé que cette mathématique pouvait être un langage et servir à rendre compte des phénomènes naturels, ils n’ont jamais pensé que Dieu avait créé, écrit le monde en équations et que, en apprenant le langage du monde, nous pourrions devenir « maîtres et possesseurs de la nature ». La réponse proposée par Jullien rejoint celle qu’avait donnée Joseph Needham : l’Occident a dépassé la Chine, parce qu’il a développé une physique mathématique puissante et efficace. Et ce projet extraordinairement ambitieux est lié à la croyance en un Dieu législateur et rationnel, dont les décrets peuvent être compris par les êtres rationnels que nous sommes. Depuis Galilée, comprendre et agir sur le monde, pour l’Occident, ce serait donc, essentiellement, lui appliquer un modèle mathématique parfait, et quasi-divin.
3Cette manière typiquement occidentale de voir les choses, selon laquelle il y a un plan idéal, un modèle, qui est premier et qu’il s’agit de faire passer dans la réalité n’est, selon Jullien, pas limitée aux sciences modernes. On trouve cela dès l’Antiquité. Les Grecs ont, depuis l’époque classique, pensé l’efficacité à partir du modèle, de l’eidos : pour être efficace, on construit un modèle que l’on s’efforce ensuite de faire entrer dans la réalité. Chez Platon, bien sûr (pour agir, il faut commencer par connaître et connaître, c’est connaître l’eidos), mais aussi chez Aristote (l’artisan humain s’efforce de faire passer une forme dans une matière qui résiste). Cette manière de penser n’est donc pas une invention du 17ème siècle. Elle n’est pas, non plus, précise encore Jullien, liée au seul développement de la science : c’est aussi comme cela que les occidentaux pensent la morale ou la guerre. Le grand général est celui qui parvient à imposer son plan malgré les circonstances, et il sera d’autant plus admirable que les circonstances en question lui étaient contraires. Le général est d’autant plus héroïque que sa victoire est plus risquée.
4Le détour par la Chine a permis à Fr. Jullien d’apercevoir que cette manière de penser n’est pas nécessaire, qu’elle n’est pas la seule possible et que, peut-être, elle n’est pas non plus, toujours, la plus efficace. Sa thèse, nous le savons, c’est que ce qui a si bien marché dans le domaine de la connaissance de la nature, le rapport entre le modèle et son application, n’a pas marché de la même manière au niveau de la praxis. Ce qui marche si bien en sciences ne marche pas toujours ailleurs. En matière de stratégie militaire, par exemple. A ce propos, Jullien évoque notamment Clausewitz, qui affirme que l’on a échoué à penser la guerre, mais qui continue pourtant lui-même à tenter de la penser selon les mêmes termes, en comparant la guerre parfaite, idéale et la guerre réelle où rien ne se fait vraiment comme on l’avait prévu. Clausewitz fait même de ce caractère imprévisible une définition de la guerre : l’essence de la guerre, c’est qu’elle dévie toujours par rapport à ce qu’on avait projeté. Il n’est jamais possible d’appliquer tel quel aucun plan de bataille
5François Jullien nous apprend que les stratèges chinois, eux, voient les choses de manière complètement différente : plutôt que de chercher à imposer leur plan à la réalité, ils vont exploiter le « potentiel de situation », ils vont entreprendre de transformer la situation, le rapport des forces en présence, l’état physique et psychologique de l’ennemi et celui de leurs propres troupes, etc. pour que, progressivement, le potentiel de situation leur soit favorable ; ils n’engageront le combat que lorsqu’ils jugeront que la situation elle-même leur donnera la victoire. Ils ne commenceront à se battre que quand ils auront déjà gagné. En sorte, poursuit Jullien, que le bon général, en Chine, n’est pas héroïque mais, au contraire, discret : une victoire est d’autant plus admirable qu’elle est plus facile. « Peu d’efforts, beaucoup d’effets ». Il faut aménager des conditions en amont, faire mûrir les conditions favorables, pour que l’effet découle tout seul. Il faut, dit Jullien « créer la pente » (car le mot « potentiel » est à prendre dans le sens qu’il a lorsque l’on dit, en physique, que tel système possède une grande énergie « potentielle », comme c’est le cas pour une masse d’eau au sommet d’une pente). Les troupes qui l’emportent, ce sont celles qui ont vaincu avant la bataille. Et Jullien conclut que, du grand général, il n’y a rien à louer, ni sagacité, ni courage. Ceux qu’on loue ont pris des risques et, en cela, ce sont de piètres généraux. Pour les Chinois, la guerre doit être sans risque, elle ne dévie jamais.
6Je voudrais ici reconsidérer la science moderne à la lumière des thèses de Jullien que je viens de rappeler. Pour le dire très vite, je voudrais suggérer que le mode de fonctionnement de la science moderne, de notre science, est bien plus proche de celle du stratège chinois décrit par Jullien que nous pourrions le penser. Je voudrais tester la fécondité de l’hypothèse suivante : « ce qui réussit dans les sciences, comme dans la praxis, ce n’est pas l’application d’un modèle idéal à la réalité, mais une lente transformation du potentiel de situation ». Je vais tenter de montrer pourquoi il me semble qu’il y a quelque pertinence à appliquer les développements de Jullien sur les stratégies de transformation d’une situation au champ de la science dont Jullien lui-même estime qu’il relève très largement d’une autre approche.
Déraisonnable efficacité des mathématiques en physique ?
7Revenons, pour commencer, au geste galiléen. On retrouve, dans la manière dont Jullien parle de la révolution scientifique, l’écho des thèses d’Alexandre Koyré. Pour celui-ci, on s’en souvient, ce qui définit la révolution scientifique, ce n’est pas d’abord la découverte de la méthode expérimentale – Galilée a, selon lui, peu expérimenté, beaucoup moins, en tout cas qu’il ne l’affirme – mais l’invention de la physique mathématique. Galilée est le premier à identifier l'explication et l'essence mathématique. Il est le premier à passer outre à l'interdiction d'Aristote d’appliquer la mathématique à la physique, le premier à entreprendre d’expliquer la réalité par référence à un monde d'idéalités. Contre l’empirisme aristotélicien, Galilée renoue avec la conviction platonicienne que seule la contemplation des formes idéales peut mener à une véritable connaissance : si nous voulons connaître ce monde sensible, il faut en passer par les modèles intelligibles dont les réalités sensibles sont des copies. C’est ainsi que Galilée pose par exemple au fondement de la physique un « principe d’inertie » qui décrit un cas idéal, a priori impossible à observer, puisqu’il y est question d’un corps qui perpétuerait indéfiniment son mouvement2. La suite a été très (trop ?) souvent racontée : le monde moderne héritera du geste de Galilée. Pour le meilleur : nous aurons l’espoir d’être maîtres et possesseurs de la nature, et même si nous n’y arrivons pas tout à fait, nous serons néanmoins souvent efficaces. Mais aussi pour le pire : le monde tout entier sera mécanisé, réduit à un objet de calcul, et il ne s’agira plus de vivre en harmonie avec une nature, désormais conçue comme une grande machine sans âme, mais de l’exploiter au risque de la détruire.
8 Je voudrais prendre le risque d’interroger cette interprétation. Avant d’exploiter les développements de François Jullien sur la stratégie chinoise, je vous propose d’envisager rapidement les quelques questions suivantes : L’application des objets idéaux des mathématiques à la réalité physique est-elle finalement si efficace que cela ? Qu’est-ce qui nous émerveille, au juste dans « la déraisonnable efficacité des mathématiques » ? En quoi l’idée que le monde est écrit en langage mathématique est-elle « une idée folle, mais qui marche extraordinairement bien et qui a fait de nous les maîtres et possesseurs de la nature » ?
9 Commençons par le premier point. La science dont parle, comme beaucoup d’autres, François Jullien, celle qui cherche à faire passer un modèle mathématique dans le monde réel, celle qui nous dit que c’est le cas idéal qui est fondamental, que c’est lui qui permet de comprendre le cas réel, – c’est par exemple le pendule conservatif, idéal, qui permet de comprendre le pendule réel, nécessairement amorti.–, cette science qui nous dit que les objets parfaits des mathématiques (les triangle, les cercles, etc.) s’incarnent dans le réel, cette science est-elle finalement si efficace que cela ? Oui, sans doute, dans certains cas. La description du système solaire, par exemple : les planètes décrivent, à une très bonne approximation près, des ellipses, qui sont des courbes mathématiques simples. Pas aussi simple que les cercles, sans doute, et l’on se souviendra que Galilée ne s’est jamais rallié à l’hypothèse keplérienne, mais enfin, on peut néanmoins être impressionné par cette incarnation de la mathématique dans le monde physique. En balistique, également, au moins par temps calme, les boulets de canon suivent, pour l’essentiel, la trajectoire parabolique que prédit la mécanique. Mais ce genre de cas exemplaire, n’est-ce pas l’arbre (ou les quelques arbres) qui cache(nt) la forêt, et une forêt de nature complètement différente, dans laquelle la belle simplicité des objets mathématiques, comme leur noble immuabilité, deviendrait bien difficile à discerner. Qu’est-ce qui nous émerveille dans « la déraisonnable efficacité des mathématiques en physique » ? Est-ce seulement, comme on le dit parfois, et comme ce que j’ai dit jusqu’ici pourrait le laisser penser, que les objets mathématiques, les raisonnements mathématiques (nécessaires, parfaits, éternels, etc.) s’appliquent avec succès au monde physique (imparfait, soumis au devenir et à la corruption, etc.) ? Je ne le pense pas. Ce qui émerveille Wigner, à qui l’on doit cette expression,3 et d’autres physiciens théoriciens, comme Einstein, qui affirmait « ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible », ce n’est pas que le monde physique puisse être décrit avec des modèles mathématiques. C’est qu’il puisse être décrit avec des modèles mathématiques simples. Ainsi, ce qui est remarquable, ce n’est pas qu’il soit possible de décrire mathématiquement l’orbite des planètes, mais qu’il soit possible de la décrire avec une courbe mathématique très simple. Si les planètes suivaient des trajectoires très compliquées, il serait tout aussi possible de les décrire mathématiquement, mais nous ne verrions probablement là aucun motif d’émerveillement. Ce qui est surprenant, c’est que les physiciens aient pu développer des théories dont le contenu empirique était manifestement pertinent à partir de la conviction que ce qui est réalisé dans le monde physique doit être mathématiquement « simple », « naturel » ou « beau ». S’il y a une énigme à expliquer, ce n’est pas tant l’utilité des modèles mathématiques en physique que la simplicité des modèles (de certains modèles) utiles.
10Signalons encore que les travaux de chercheurs cognitivistes encouragent aussi à minorer l’étonnement devant le fait que les mathématiques permettent de parler du monde4. Plutôt que de considérer avec une certaine tradition platonicienne que les objets mathématiques sont depuis toujours dans le ciel des idées, ces travaux suggèrent que ce qui est au fondement des mathématiques, ce sont nos interactions avec le monde. L’évolution nous aurait ainsi doués d’un « sens du nombre », d’une « acuité numérique » qui nous permet d’appréhender certains aspects du monde, tout comme nous avons un sens de la vision ou une « acuité visuelle » qui nous permet aussi de percevoir notre monde. Si l’on accepte que les théories mathématiques se sont peu à peu constituées à partir de multiples expériences qui font (notamment) intervenir ce « sens du nombre », il n’y a plus de raison de crier au miracle lorsque l’on constate que les mathématiques s’appliquent au monde. Il n’y aurait, selon ses auteurs, pas plus de raison de s’extasier devant l’efficacité des mathématiques que de s’émerveiller de l’efficacité du langage : comme les langues naturelles, les mathématiques sont efficaces tout en étant relativement incomplètes. Dans le premier cas, nous éprouvons cette incomplétude lorsque nous trouvons un mot, ou une expression dans telle ou telle langue que nous ne parvenons pas à traduire correctement dans une autre langue, ce qui montre bien qu’il y a des situations ou des sentiments que telle langue ne parvient pas à saisir correctement. De la même manière, les mathématiques colleraient au monde, sans parvenir à en fournir une description complète5. Les mathématiques, affirment les auteurs, se sont constituées avec les progrès de l’intelligibilité du monde. Si elles ont toujours été un élément essentiel des théories de la connaissance c’est parce qu’elles s’ancrent dans les processus fondamentaux de nos interactions avec le monde. Et si elles sont, dans une certaine mesure, privilégiées par rapport à d’autres formes d’intelligibilité, par rapport à d’autres langages, ce n’est pas parce qu’elles sont le langage de la nature ou la langue par laquelle Dieu nous parle à travers la nature, mais parce qu’elles constituent cette partie de la construction de la connaissance qui est maximalement stable et invariante6. Les concepts mathématiques ne viendraient donc pas d’ailleurs. Il ne faudrait pas y voir des absolus indépendants des pratiques humaines. Nous les élaborerions en nous « frottant » au monde. Et c’est pourquoi, une fois encore, il n’y aurait pas de miracle : « c’est le processus de constitution, et sa friction avec le monde qui assure à la mathématique son objectivité et sa (très raisonnable) efficacité »7.
11Malgré les solides objections que l’on peut ainsi opposer au thème de la « déraisonnable efficacité des mathématiques », j’avoue que j’ai quelques réticences à abandonner définitivement cette formule. Je ne parviens pas à me convaincre que cet étonnement qu’éprouvent Wigner et d’autres physiciens, mais aussi, je pense tout étudiant qui découvre pour la première fois les équations de la relativité (par exemple), que cet étonnement soit absolument sans objet. A vrai dire, je pense qu’il n’est pas tout à fait impossible de sauver cette formule – et, avec elle, la conception disons, pour faire bref, « platonicienne » de la connaissance (conception selon laquelle il faut partir des formes parfaites pour comprendre le monde) – , mais que ce sauvetage est nécessairement très local. Le champ d’application de la conception « platonicienne » serait limité à une partie de la physique, tandis que la plus grande partie de la science, comme je l’ai suggéré précédemment, relèverait plutôt d’une stratégie « à la chinoise ». De plus, s’il y a moyen de sauver cette formule, c’est, sans doute dans la mesure où, comme je l’ai indiqué précédemment, elle ne signifie pas, comme on le croit parfois, qu’il est « étonnant », « admirable » ou « déraisonnable » que nous puissions décrire mathématiquement le monde physique, mais plutôt qu’il est étonnant, admirable, etc. que le monde physique (un certain monde physique, faudrait-il préciser) se laisse décrire par des mathématiques simples. Ce qui est étonnant, c’est qu’un raisonnement du type «je vais partir de la description mathématique la plus simple que je puisse envisager puis me demander à quel phénomène physique cela correspond » puisse être efficace. Ce qui est étonnant, c’est que nous puissions anticiper l’existence d’objets physiques que nous n’avons jamais observés à partir des propriétés d’un modèle mathématique8. Il y a tout de même quelque chose d’intriguant dans ces exemples, quelque chose qui tient peut-être à ce sentiment qu’il y a davantage dans les modèles mathématiques que ce que nous avons conscience d’y mettre, ou encore à ce sentiment d’une proximité, d’une complicité entre physique et mathématique dont l’analogie suggérée par Longo et Viarouge avec le cas des langues naturelles ne permet pas de rendre complètement compte (à quoi correspondrait, dans ce cadre, cette puissance prédictive des mathématiques?).
12Il faut cependant reconnaître que les exemples de ce type, qui illustrent une efficacité du modèle mathématique assez conforme à ce que l’on pourrait attendre si l’on croit à la conception « platonicienne » de la connaissance sont bien difficiles à trouver hors de la physique théorique. Et cette physique fondée sur cette idée d’une représentation mathématique simple, qui promettrait maîtrise et prédictibilité n’est pas toute la science. Elle n’est même pas toute la physique.
Conception platonicienne du savoir dans le laboratoire, stratégie chinoise au-delà
13Si la conception platonicienne possède une certaine validité, cette validité est, probablement, très locale. Elle est locale au sens figuré, localisée dans une certaine partie de la physique, je viens de le dire. Mais elle est aussi locale au sens propre, localisée, le plus souvent, dans les laboratoires. Comme l’ont bien montré ceux qui s’attachent à décrire l’histoire des objets scientifiques, le cas « idéal », celui que l’on peut décrire par un modèle mathématique simple a souvent bien du mal à sortir du laboratoire. Ce qui a été établi dans le milieu protégé du laboratoire, ce qui a été obtenu dans les conditions très strictes qui prévalent dans ce milieu fermé ne résiste pas toujours aux conditions extérieures9. Pour prendre les choses à rebours, on pourrait dire que les belles lois mathématiques que l’on dit « universelles » doivent leur existence à la mise en place de conditions extrêmement particulières. C’est ce qu’explique remarquablement Christian Licoppe10 : les lois « simples et universelles » n’ont pu devenir visibles qu’avec l’avènement du « régime de l’exactitude », à la fin du 17ème siècle, lorsque la science moderne s’est enfermée dans le laboratoire.
14Mais, évidemment, on ne peut en rester là. Si l’on veut que la science ne se réduise pas à ce qui pourrait apparaître comme un jeu gratuit ne concernant que quelques initiés, il faut bien qu’à un moment ou l’autre on sorte du laboratoire. Et c’est à ce moment que le beau modèle mathématique, le plan idéal, va manifester ses limites : ça ne se passe pas toujours exactement comme on l’avait prévu. Dans le laboratoire, les corps qu’observe Galilée tombent avec une accélération constante ; hors du laboratoire, le vent, la résistance de l’air, et les mille petits « empêchements » qu’on ne peut plus « défalquer » brouillent ce beau modèle. Dans le laboratoire, les CFC, inertes, sont tout à fait inoffensifs, mais une fois lâchés à l’extérieur, ils s’élèvent jusqu’à la haute atmosphère où les UV les transforment en molécules qui détruisent la couche d’ozone. On se souviendra aussi de la « révolution verte », de ces variétés de céréales à haut rendement mises au point par des agronomes qui ont pu penser qu’ils allaient ainsi résoudre le problème de la faim dans le monde, et dont il a bien fallu constater qu’une fois sorties du laboratoire et distribuées (ou vendues) dans le tiers-monde, les semences en question pouvaient perturber gravement toute l’organisation socio-économique d’une région. Ces paramètres « socio-économiques », qui n’interviennent pas lors de la mise au point des plantes dans le petit monde du laboratoire exigent évidemment d’être pris en compte quand on veut sortir « dans le grand monde ». Aujourd’hui, la production des OGM pose des questions qui rappellent celles qu’a soulevées la révolution verte dans les années 70. Sortir du laboratoire, c’est nécessairement devoir prendre en compte une série de déterminations qui rendent parfois problématique l’applicabilité des résultats obtenus en laboratoire.
15Bien sûr, on peut continuer à penser tout ceci en termes platoniciens, comme une illustration des difficultés que l’idéal rencontre quand il cherche à s’incarner dans le réel, mais enfin, dans les situations réelles, on voit de moins en moins l’idéal et de plus en plus les difficultés. Au point qu’il est sans doute temps de partir à la recherche d’une description plus réaliste de la science. Celle que je vous propose d’envisager a été développée par Bruno Latour. Elle est d’autant plus intéressante pour notre propos qu’il me semble que la manière dont Latour décrit les pratiques des chercheurs évoque la manière dont, selon Jullien, le général chinois fait la guerre.
16Pour Latour, même dans les sciences dures, la conception selon laquelle il y aurait un héros qui découvre puis impose un modèle relève de la mythologie construite par ce qu’il désigne comme l’histoire des sciences traditionnelle, et contre laquelle il développe sa description de « la science telle qu’elle se fait ». L’histoire des sciences serait, d’abord, une histoire des controverses, une histoire des pratiques et pas une histoire des idées. Latour est tout à fait opposé à « l’histoire internaliste », selon laquelle les idées seraient premières, et se diffuseraient spontanément s’il n’y avait pas des « résistances » (comme le plan du général selon Jullien, qui devrait pouvoir se réaliser, s’il ne rencontrait pas des circonstances contraires). L’histoire internaliste a tendance à considérer qu’il y a des génies qui ont « des idées », et que tout le reste est simple développement, simple conséquence des principes originaux. Latour refuse quant à lui de commencer son exploration de la science par les « idées » et de considérer que si un fait ou une idée n’entraîne pas l’adhésion, c’est parce que certains groupes résistent. Il stigmatise ce qu’il nomme « le modèle diffusionniste » qui, après avoir inventé « le découvreur génial qui a des idées », invente ce monstre symétrique : un milieu, une société qui n’accepte ces idées qu’avec difficulté, en général par conservatisme ou obscurantisme (comme les médecins de ville qui ne trouvaient pas enthousiasmants les vaccins de Pasteur et auxquels on reprochera d’avoir freiné la diffusion des idées de Pasteur).
17Latour conteste cette conception selon laquelle, par inertie, les idées une fois lancée par les grands hommes devraient faire leur chemin toutes seules. Pour lui, les idées voyagent grâce au social et pas malgré lui, elles voyagent parce qu’elles ont su rallier une série de gens à leur cause.
18Latour va donc tout à fait à l’encontre de la conception d’un modèle « pur » qui aurait à lutter contre des obstacles (ici sociaux) pour se réaliser dans le monde. Il n’y a pas de modèle pur, ni d’idée pure. Les modèles et les idées sont toujours déjà sociaux. Haro, donc, sur cet idéal de pureté : « histoire des idées, histoire interne des sciences, épistémologie sont les noms donnés à cette discipline – qui devrait être interdite aux moins de 18 ans tant sont scandaleuses les mœurs de ces races pures»11. On n’a jamais, chez Latour, de modèle, d’idée qui serait d’abord donnée ou découverte et qu’il faudrait ensuite appliquer au risque de l’altérer, au risque de la dénaturer. Ce que l’on a, au contraire, c’est un long travail de maturation, de transformation, d’exploitation du potentiel de situation (on reconnaît les termes de Jullien). La science est faite de controverses. Et celui qui l’emporte, c’est celui qui a su exploiter au mieux toutes les ressources disponibles. On ne part jamais d’un plan tout fait, d’un modèle que l’on appliquerait ensuite. Le modèle se constitue à partir d’un ensemble complexe de pratiques et de négociations. Et l’efficacité d’une science lui vient de la transformation du milieu (social et naturel) que ses partisans ont réussi à réaliser. Latour l’a montré à partir de nombreux épisodes de l’histoire des sciences. Celui auquel il a consacré l’étude la plus approfondie est sans doute le cas Pasteur. Dans Les microbes, guerre et paix12, Latour explique ainsi que, si Pasteur est parvenu, en quelques années, à convaincre tout le monde de l’existence des microbes et du rôle que ceux-ci jouaient dans le déclenchement des maladies, et si cette victoire a pris des airs de triomphe, ce n'est pas parce que la nature lui a donné raison et lui a donc permis d’imposer son idée géniale malgré les résistances des uns et des autres. Si Pasteur l’a emporté, c’est parce qu’il est parvenu à exploiter au mieux les forces disponibles pour transformer à la fois la nature et la société en sorte que l’une et l’autre fassent une place à ses microbes. Latour explique que l'obsession de la France, à la fin du XIXème siècle, c’était la régénération de l'homme. La France venait de perdre l’Alsace et la Lorraine dans la guerre contre la Prusse, les militaires réclamaient des régiments solides pour prendre leur revanche. D’autre part, les patrons se plaignaient de la mauvaise santé de leurs ouvriers : tous ces pauvres affaiblis ne pouvaient plus produire efficacement. Il fallait assainir. Les Pastoriens, nous dit Latour, vont puiser à cette source pour faire avancer leurs affaires (ils manifestent là un opportunisme qui peut, je pense, évoquer celui des Chinois de Jullien). Ils vont réussir à se constituer tout un réseau d'alliés très divers qui vont peser dans la controverse (les militaires qui veulent des régiments virils, les industriels qui veulent des ouvriers efficaces, les éleveurs qui veulent des troupeaux en bonne santé, les mères qui veulent de beaux enfants etc.). Le Pasteur que décrit Latour utilise de manière très habile les forces sociales existantes, mais il n’en reste pas là. Il va aussi transformer la société. Il n'invente pas seulement une science, il invente aussi une société qui rend cette science possible. Il « crée la pente » pour ses microbes. Il est parvenu à faire une place pour ses microbes dans la nature (il a montré qu’ils existaient dans ces tubes à essai) mais aussi dans la société (il va encourager les campagnes de vaccinations et une série de mesure d’hygiène). Si Pasteur parvient à imposer ses microbes, c’est, précisément parce qu’il a remarquablement exploité le potentiel de situation. Il a travaillé la situation en sorte que sa victoire devienne finalement facile. Il est parvenu à instaurer un rapport de forces qui lui soit favorable, à mettre de son côté une multitude d’alliés fiables. Et l’on ne s’étonnera pas de la présence de termes militaire dans cette description : la construction de la science, cela relève (aussi) de la stratégie. C’est le potentiel de situation, tel que Pasteur l’a transformé, qui a, comme dirait Jullien, accouché de la victoire. Et c’est à tort que l’on pourrait interpréter cela comme une victoire héroïque de Pasteur ou de ses idées :
Une foule peut déplacer une montagne, un homme seul ne le peut pas. Si l'on dit donc d'un homme qu'il a déplacé une montagne, c'est qu'on lui a attribué (ou qu'il s'est approprié) le travail de la foule qu'il disait commander mais qu'il suivait aussi bien. Il en est de même du rapport entre les hygiénistes et les pastoriens. Un immense mouvement social parcourt le corps social afin de reconstruire le Léviathan de sorte qu'il puisse abriter les nouvelles masses urbaines. Les hygiénistes utilisent ce mouvement pour attaquer la maladie de tous les côtés, ou dans leur langage, agir sur le « terrain pathogène ». Les pastoriens, quelques dizaines d'hommes au début, ne l'oublions pas, vont à leur tour chevaucher et traduire le mouvement hygiéniste. En France, le résultat de cette traduction fut telle qu'on a assimilé le mouvement hygiéniste aux pastoriens. On a en plus assimilé les pastoriens à l'homme Pasteur, et finalement, selon une habitude bien française, on a réduit l'homme Pasteur aux idées de Pasteur, et enfin ses idées à leurs fondements théoriques. On a donc bien obtenu, en fin de compte, ce monde renversé (…). Un homme soulève une montagne par son seul génie.13
19Selon Latour, on le voit, c’est toute la réalité, y compris la réalité sociale qu’il faut transformer pour l’emporter. Ce qui l’amène à cette formule – parfois mal comprise – selon laquelle une affirmation scientifique est d’autant plus solide qu’elle est plus sociale.
Ajouter le mot social au mot scientifique n’est ni un péché ni un crime, ni une chute, c’est une élévation. Une science se porte d’autant mieux, elle est d’autant plus solide, rigoureuses, objective, véridique, qu’elle se lie davantage, qu’elle s’attache plus intimement au reste du collectif.14
Plus une littérature est technique et spécialisée, plus elle devient « sociale ». Si une affirmation technique est difficile à réfuter, ce n’est pas parce qu’elle est pure de toute dimension sociale, mais au contraire parce qu’elle est toujours l’affirmation de « nombreux hommes bien équipés ». 15
20Un article scientifique est ainsi très « social » parce qu’il s’appuie sur une multitude de références à d’autres articles de scientifiques reconnus, parce qu’il s’appuie sur des protocoles d’expériences précis, sur des mesures faites dans des conditions soigneusement spécifiées, etc. L’efficacité ne vient pas de ce qu’on s’arrache au social, de ce que l’on parvient à imposer un modèle pur ou idéal, mais de ce que l’on tisse un maximum de liens avec un maximum d’alliés. Ce qui donne à une thèse sa solidité, son objectivité, son efficacité, c’est le nombre de liens qui l’attache au reste du monde, c’est le nombre d’énoncés, d’instruments, de références, etc. qu’il faudrait modifier s’il fallait abandonner cette hypothèse.
21Ce que décrit Latour, ce n’est pas du tout, on le voit, l’application plus ou moins forcée d’un plan ou d’une idée géniale au monde naturel et à la société, c’est la transformation de la nature et de la société en vue de les rendre propices à ses idées. La nature et la société ne préexistent pas aux controverses. Elles ne seront stabilisées qu’au terme de celles-ci. La transcendance (de la nature comme de la société), que l’on a tendance à considérer comme un donné est en fait le résultat d’un travail de transformation, de stabilisation16. C’est, pour le dire avec les termes de Jullien, le résultat d’un travail d’exploitation du potentiel de situation.
22Si l’on en croit Latour, la nature et la société, auxquelles il s’agirait, selon la conception « platonicienne », d’imposer un modèle idéal, ne préexistent donc pas à la controverse. Mais ce n’est pas tout : l’universalité des lois, qui est un élément essentiel dans la conception « platonicienne » ne préexiste pas davantage aux controverses. La conception classique de l’« universalité de la science et de la technologie » suppose que, « une fois les théories découvertes, elles peuvent se répandre ‘partout’ sans coût supplémentaire »17. Le fait que la science puisse s’appliquer hors des laboratoires est d’ailleurs souvent présenté comme « la meilleure preuve de son efficacité et du pouvoir quasi surnaturel des chercheurs »18. Cette conception largement acceptée est aussi, selon Latour, très largement erronée : les faits et les théories scientifiques ne sortent jamais des réseaux19 technoscientifiques, et si nous avons parfois le sentiment qu’ils le font, c’est parce que les réseaux ont été prolongés pour les étendre davantage. On ne sort pas du laboratoire, on transforme le monde extérieur en laboratoire :
plus fragiles encore que les termites, les faits et les machines peuvent voyager dans de longues galeries, mais ne peuvent survivre ne serait-ce qu’une minute dans cette fameuse et mythique « extériorité » tant prisée par les philosophes des sciences.20
23Le Pasteur que décrit Latour est ainsi parvenu à répandre ses théories parce qu’il est parvenu à transformer les fermes et les cabinets médicaux en laboratoire. A Pouilly-le-Fort, il transforme une ferme en laboratoire pour effectuer une épreuve « grandeur nature » et démontrer publiquement l’efficacité de son vaccin contre la maladie du charbon.21 Et si la physiologie et la pathologie nous donnent aujourd’hui l’impression d’être « sorties des labos », d’être « efficaces partout dans le monde », c’est parce que les cabinets médicaux ont été équipés d’une série d’instruments (thermomètre, tensiomètre, etc.) qui en font quelque chose comme l’annexe d’un laboratoire.
24A contrario, lorsque les scientifiques ne parviennent pas à prolonger le réseau, leurs faits et théories sont tout simplement mis à mort par l’extériorité ou renvoyés à l’intérieur du réseau. Latour évoque à ce propos un projet de village solaire en Crête, parfait sur la maquette, mais qui s’est heurté à un « extérieur » – les habitants de l’endroit qui n’ont pas accepté d’abandonner leurs maisons pour ce village tout neuf dont ils soupçonnaient qu’il camouflait l’implantation d’une base militaire américaine – qui lui a donné le coup de grâce (ou, si l’on veut, qui l’a forcé à retourner à l’intérieur du réseau, dans les tiroirs des bureaux athéniens)22. Même un excellent plan ne peut s’appliquer que s’il y a eu transformation préalable de la situation (Jullien) ou prolongement du réseau (Latour).
25Les faits scientifiques sont, nous dit Latour « comme les trains, l’électricité, ou les légumes surgelés : ils peuvent circuler partout tant que la chaîne à l’intérieur de laquelle ils se déplacent n’est pas interrompue »23. On a tendance à ne pas s’en rendre compte, parce que l’on considère que l’ « universalité » des lois physiques ou biologiques permet de les appliquer partout. En pratique, c’est très différent : la loi d’Ohm a beau être universelle, on ne peut la vérifier que si l’on dispose d’instrument de mesure, et les lois de Boyle, tout aussi universelles, se sont propagées à mesure que les pompes à air, d’abord encombrantes, coûteuses et peu fiables sont devenues un équipement de routine de tout laboratoire24. Il conviendrait donc de « voir dans nos lois et dans nos constantes, dans nos démonstrations et dans nos théorèmes, des objets stabilisés qui circulent certes très loin, mais à l’intérieur de réseaux métrologiques bien agencés dont ils sont incapables de sortir.25 »
Retour aux mathématiques
26Je viens de citer un extrait dans lequel il est question de théorèmes et de démonstrations. Cela m’amène tout naturellement à vous dire un mot du statut des mathématiques tel qu’il est décrit dans La science en action. Les mathématiques, les équations, font partie des réseaux et contribuent, au même titre que d’autres inscriptions (les compte rendus des géographes, les plans, les schémas, par ex.), à faire circuler les faits, à rassembler en un même lieu une série d’éléments pour pouvoir les traiter ensemble. Selon Latour, le modèle mathématique n’est jamais premier (comme un plan idéal qu’il faudrait ensuite appliquer), il est tiré des pratiques qu’il résume et fait circuler. L’exemple qu’il utilise pour illustrer ceci et celui du nombre de Reynolds. Je reprends rapidement son développement. Reynolds étudiait la turbulence. Toute une série d’observations permettaient déjà de savoir que « plus l’écoulement est rapide, plus il y a de turbulence », « plus l’obstacle est gros, plus il y a de turbulence », « plus un fluide est dense, plus il y a de turbulence » et « plus un fluide est visqueux, moins il y a de turbulence ». Une équation permet de résumer tout cela : en notant T la turbulence, V la vitesse, L la longueur de l’obstacle, D la densité et ν [nu] la viscosité, on peut écrire que T est liée à VLD/ν. Reynolds introduit ensuite R, le nombre qui porte son nom : R=VLD/ν. L’introduction de ce nombre « crée un nouvel espace-temps » écrit Latour, parce que « des situations aussi éloignées en apparence qu’un torrent rapide se heurtant à des rochers, une grande rivière calme arrêtée par une digue, une plume qui tombe dans l’air ou un corps qui nage dans la mélasse peuvent produire des turbulences similaires si elles ont le même « Reynolds ». De plus, ce nombre permet aussi de réduire l’échelle d’une situation : tant que le modèle réduit conserve le même R, on peut travailler sur le modèle, même s’il a une échelle complètement différente. La puissance des équations leur vient de cette capacité de rapprocher des phénomènes divers. Mais, quelle que soit cette puissance, une équation ne diffère pas par nature des autres outils qui permettent de réunir les éléments, de les organiser, de les représenter. Ces équations ne peuvent pas être détachées du processus de construction du réseau dont elles constituent une petite partie : R permet certes aux chercheurs de passer d’un modèle réduit à un autre, de voyager rapidement d’une situation de turbulence à une autre, etc. Mais ça ne marche que s’il y a des centaines d’ingénieurs qui travaillent là-dessus, et ils ne le font que s’ils ont pu décrocher des contrats de constructions de digues, d’avion, etc. Bref, c’est seulement après que les réseaux ont été mis en place que l’invention de R peut produire une différence.
27Latour souligne aussi que les formes (mathématiques) ne peuvent pas s’appliquer aux turbulences, aux gens ou aux microbes, que si on leur a déjà appliqué une série de mesures. Il faut transformer l’extérieur pour qu’il devienne comparable avec le monde de papier (ou d’ordinateurs) des centres de calcul. Les modèles mathématiques ne sortent pas des réseaux. Il n’y a en fait, pour Latour, aucune raison de s’étonner que « les formes abstraites s’appliquent à la réalité empirique », tout simplement, elles ne s’y appliquent pas : ce à quoi elles s’appliquent, c’est à quelque chose qui a déjà été transformé (en mesures, en nombre, etc.) pour pouvoir être traité par les équations. Une fois encore, pour Latour, le point de départ qui doit permettre de comprendre le reste, ce ne sont pas les idées « abstraites » mais les alliés potentiels, les rapports de forces, et les réseaux qu’ils permettent de construire.
28Résumons. La description de Latour est aux antipodes de la conception de certaines épistémologues et historiens des sciences (et qui est aussi celle qu’évoque Jullien) selon laquelle il faut partir d’un plan idéal, en général mathématisé, qui s’applique miraculeusement (déraisonnablement) à la nature et qui devrait se diffuser spontanément dans la société s’il n’y avait des « résistances ». Pour Latour, il ne faut pas partir du plan idéal, mais de la construction des réseaux, c’est-à-dire d’un long travail de transformation du monde naturel et du monde social qui permet finalement aux faits et aux thèses scientifiques de faire leur chemin et de s’étendre partout. La nature, la société, la vérité et l’universalité ne préexistent pas à cette construction des réseaux, elles en sont le produit. Et il en va de même de ce que l’on présente volontiers comme une « découverte scientifique majeure » ou comme une « expérience cruciale ». En fait, ces « événements » que l’histoire des sciences met souvent en scène avec beaucoup d’emphase sont, pour reprendre une fois encore les termes de Jullien, « l’affleurement sonore de transformations silencieuses ». L’événement que l’histoire des sciences célèbre, c’est, ce n’est que, dirait Jullien, « le moment où la maturation devient visible ».
De l’utilisation politique de la conception platonicienne du savoir
29Que faire, alors de cette conception « platonicienne » du savoir ? Pouvons-nous considérer, sans autre forme de procès, qu’il s’agit d’une vieillerie de l’épistémologie et de l’histoire des sciences traditionnelles et l’oublier définitivement ? Pas si simple, si l’on en croit Latour, parce que si l’efficacité du modèle platonicien est épistémologiquement très faible (ce n’est pas ainsi que fonctionnent les sciences) elle est politiquement redoutable, comme le montre le début de Politique de la nature26, sur lequel je voudrais m’attarder quelques instants.
30Pour le dire très vite, selon Politiques de la nature, la référence à la transcendance (à l’eidos, au modèle idéal), aurait pour fonction, depuis Platon, de faire taire le peuple. En cela, le modèle platonicien a démontré son efficacité. Efficacité qu’il doit, bien sûr, à ceci qu’il dissimule sa fonction politique bien réelle sous une fonction épistémologique – nous pourrons connaître le monde – qui est, elle, illusoire. Au début de son livre, Latour relit le mythe de la caverne dans cette perspective. Ce mythe pose, nous dit-il, une rupture entre le monde humain (l’enfer social, l’intérieur de la caverne) et le monde des vérités « non faites de main d’homme ». Le mythe introduit ensuite le personnage du philosophe (devenu depuis le savant) qui parvient à s’arracher à l’enfer social, à contempler les vérités « non faites de main d’hommes » et qui, ainsi équipé, revient dans la caverne pour y mettre de l’ordre aux moyen de ces vérités indiscutables capables de faire taire le bavardage des ignares. Ce mythe aurait pour fonction de rendre impossible la démocratie. Je paraphrase rapidement le propos de Latour. Le mythe de la caverne institue deux chambres, deux assemblées : la première rassemble des humains parlants voués à l’ignorance et à l’illusion, la seconde se compose d’objets réels, qui définissent ce qui existe vraiment, mais qui sont muets. Puis il accorde un pouvoir exorbitant aux quelques experts qui peuvent faire la navette entre les deux assemblées : ces experts possèdent à la fois le pouvoir de parler (ils sont humains) et celui de dire vrai (ils échappent au monde social grâce à l’ascèse de la connaissance), de plus, ils ont le pouvoir de faire taire les ignorants. Ils ont, dit Latour, la plus fabuleuse capacité politique jamais inventée : « faire parler le monde muet, dire le vrai sans être discuté, mettre fin aux débats interminables par une forme indiscutable d’autorité, qui tiendrait aux choses mêmes. » Latour conclut que le processus illustré par ce mythe est en fait un processus de politisation des sciences, c’est à dire une entreprise de détournement des sciences pour éliminer tout débat politique27. La conception illustrée par la caverne est incompatible avec la démocratie parce que, au nom de la science, elle fait nécessairement avorter tout débat démocratique. La science, pour ceux qui croient à ce mythe, c’est bien « la politique poursuivie par d’autres moyens », par des moyens qui n’ont de force que parce qu’ils sont présentés comme transcendants, parce qu’ils descendent du ciel des idées.
31Contre ce modèle, Latour s’efforce de concevoir « une démocratie qui ne vive pas sous la menace constante d’un secours venu de la Science ». C’est cela qu’il s’emploie à décrire dans Politiques de la nature. Et cette démocratie à construire gagnerait, nous dit-il, à imiter la science. Non pas, bien sûr, cette science mythique qui apporte le salut par la raison, mais les pratiques scientifiques réelles, la science en tant qu’elle ne cesse d’expérimenter, de tâtonner, de tester des assemblages risqués, etc. Il faut, selon Latour, que le collectif, tout le collectif, et pas seulement les savants, apprenne à expérimenter, à mettre à l’épreuve des assemblages possibles (Que devient le Mercantour sans loup ? Les bergers sans brebis ? Que deviennent les poissons si l’eau de la Drôme est utilisée pour irriguer les champs de maïs ? Que deviennent les agriculteurs sans système d’irrigation, etc.). Ceux qui pratiquent ce genre d’expérimentations savent qu’ils vivent dans un « monde incertain ». Ils sont dès lors, peut-être, mieux à l’abri de ces moments d’incrédulité ou de panique qui accompagnent le passage violent « du savoir absolu aux catastrophes imprévues » qui caractérise la science moderne, comme lorsque les scientifiques ont bien dû admettre, après des années de plaintes et de procès que, contre toute attente, l’amiante, matériau « magique », parfait, inerte, rentable, etc. pouvait provoquer des cancers. Le cas de l’amiante est peut-être, affirme Latour, un des derniers exemples à avoir été traité sur le mode qu’il qualifie de « moderne » (sur le mode de l’ « action maîtrisée », mode d’appréhension du monde qu’il faut, selon lui, dépasser) : parce que nous pensons connaître parfaitement les propriétés de l’objet nous ne pouvons qu’être surpris (démuni, désemparé) devant des conséquences inattendues. Comme le stratège occidental décrit par Jullien, qui constate que « la guerre dévie », qu’elle ne suit pas son plan. Plutôt que de poursuivre l’objectif, que nous savons à présent chimérique, d’une maîtrise totale, nous devrions apprendre à composer avec l’incertitude, comme le stratège chinois qui sait que le terrain se modifie sans cesse.
Notes
Pour citer cet article
A propos de : Laurence Bouquiaux
Laurence Bouquiaux enseigne la philosophie des sciences et l’histoire de la philosophie moderne à l’Université de Liège. Ses recherches portent essentiellement sur les relations entre science et philosophie à l’âge classique.