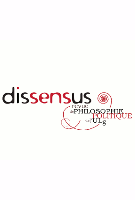- Accueil
- N° 6 (juillet 2016)
- Dossier: Frédéric Lordon et la politique. Enjeux p...
- Sur Capitalisme, désir et servitude. Lettre à Frédéric Lordon
Visualisation(s): 2573 (29 ULiège)
Téléchargement(s): 29 (0 ULiège)
Sur Capitalisme, désir et servitude. Lettre à Frédéric Lordon

Document(s) associé(s)
Version PDF originale1Liège, le 6 janvier 2014
2Cher Frédéric Lordon,
3Pour prolonger la double séance de travail qui s’est tenue en mars dernier autour de vos écrits, j’ai choisi d’adopter une forme épistolaire. Cette forme voudrait faire écho à l’esprit des Lumières qui imprègne joyeusement vos livres ; elle devrait aussi permettre de mêler, à la présentation de quelques temps forts de votre pensée, l’ébauche d’une discussion critique qui se voudrait autre chose qu’une façon ridicule de vous faire la leçon. Je sais, pour avoir lu Deleuze et l’avoir éprouvé mainte fois, que la plupart du temps rien n’est moins intéressant que les critiques et échanges d’arguments en philosophie. Parce qu’elles ne s’enracinent pas dans le même sol théorique ou le même terrain conceptuel, les critiques tombent le plus souvent à côté, ne produisent rien, ne nous avancent pas d’un iota. Votre terrain conceptuel, qui consiste à lire Spinoza avec Marx, mais aussi – surtout ? – avec Bourdieu, n’est pas tout à fait le mien. Je partage votre admiration pour Spinoza et Marx, mais n’ai jamais été disciple de Bourdieu. J’ai même plutôt navigué ces dernières années du côté de Bruno Latour et de l’ANT. Si je me permets pourtant de discuter çà et là vos travaux depuis cet angle (disons celui de la théorie de l’acteur-réseau et de l’épistémologie constructiviste), c’est qu’il m’est apparu que vos livres croisaient souvent cette position théorique, et qu’une confrontation explicite avec elle les rendrait peut-être encore plus forts.
4 Les quelques réflexions qui suivent s’enracinent dans Capitalisme, désir et servitude1. Parmi les multiples usages que vous avez faits de la pensée spinoziste, celui-ci est sans doute un des plus convaincants. Deux points au moins font le prix de cette reprise de Spinoza. D’abord, l’enrichissement notable de votre compréhension du concept de conatus. Là où ce concept était, dans L’intérêt souverain, pensé uniquement à partir d’un mouvement d’appropriation et d’affirmation égocentrée (ce que vous appeliez le « conatus pronateur »), Capitalisme, désir et servitude introduit dans le conatus quelque chose comme une dimension de passivité, qui ouvre des horizons entièrement nouveaux – j’y reviendrai. Le deuxième point décisif du livre, c’est la façon dont s’y cherche et s’y dessine une nouvelle pensée de la domination, de l’exploitation et de l’aliénation, qui tente de rendre raison du monde capitaliste tout en indiquant un champ problématique qui l’excède. Le point à partir duquel le spinozisme s’articule à l’analyse du capitalisme tout en l’excédant, c’est le concept d’entreprise. Dès le début du livre2, vous rapprochez la notion spinoziste de conatus (l’effort pour persévérer dans l’être, le désir en tant qu’il constitue l’essence même de l’homme) du verbe conor qui signifie : entreprendre, commencer. Coupler Spinoza à Marx permet de comprendre les phénomènes d’enrôlement, de mobilisation et de capture qui caractérisent le mode de production capitaliste, et aussi de reprendre à nouveaux frais la vieille question de la « servitude volontaire » : comment se fait-il que les masses concourent ou consentent à leur exploitation ? Ou encore : comment se fait-il qu’une multitude de désirs singuliers s’alignent sous le désir d’entreprendre d’un seul ou de quelques-uns ? C’est pour comprendre ces phénomènes qu’il faut coupler l’anthropologie des passions à l’analyse des modes de production, doubler l’économie politique par l’économie des affects – bref ajouter Spinoza à Marx.
5Capitalisme, désir et servitude distingue différents régimes de production du désir des salariés enrôlés, différentes « épithumogénies » : un premier moment, celui du capitalisme primitif, où c’est avant tout le désir de ne pas mourir de faim, de simplement conserver son existence, qui met les salariés en mouvement ; un deuxième moment, celui du fordisme, où l’existence d’une joie en quelque sorte extrinsèque à la sphère du travail et de la production (la joie de l’acquisition et de la consommation des biens) « fait marcher » les salariés ; un troisième moment, néo-libéral, où c’est une joie intrinsèque à l’activité productive qui « fait courir » une certaine frange des salariés (ceux qui trouvent joie et épanouissement dans le travail lui-même). On ajoutera que ce dernier moment, néo-libéral, se donne pour visée ou pour telos de généraliser à l’ensemble des salariés le type d’affect qui se développe dans cette frange particulière que constituent les « créatifs », les « travailleurs-artistes ».
6À ces trois moments, il conviendrait d’en ajouter un quatrième, hypothétique : le moment de la crise, du soulèvement, de la révolte ou de la révolution – à la faveur duquel la multitude des désirs qui avaient été enrôlés par le désir d’un seul (ou d’un petit nombre) secouent le joug, et rejettent la capture dont ils faisaient l’objet. C’est en envisageant ce moment hypothétique qu’on peut également apercevoir en quoi la compréhension du conatus comme pouvoir d’entreprendre dépasse le sens restreint (capitaliste) du concept d’entreprise : toute vie en commun, même non capitaliste, supposera en effet toujours que certaines personnes tentent d’en enrôler d’autres pour mener à bien telles ou telles de leurs entreprises. Vous donnez l’exemple du théâtre, d’un dramaturge qui voudrait représenter une œuvre géniale (par exemple Richard III3) et qui aurait pour ce faire besoin d’enrôler sous son désir les désirs d’une série d’autres individus : des costumiers, des éclairagistes, des comédiens, etc. Façon pour vous de montrer que la question de l’enrôlement au service d’un désir-maître déborde en droit l’analyse des sociétés où règne le mode de production capitaliste, et pose des problèmes politiques qui survivraient à la disparition de ce mode de production4. Cette perspective, qu’ouvre l’usage élargi du concept d’entreprise et la décision de l’inscrire au fondement même de l’anthropologie spinoziste, présente ceci d’intéressant qu’elle renvoie, ou qu’elle fait en quelque sorte rebondir, une question critique et politique née du refus de l’état présent du monde (capitaliste) vers tous les modes de vie qui s’esquissent dans ses marges avec pour vocation de s’y soustraire ou de le transformer. On pourrait donc dire que la question de l’enrôlement, de la capture ou de la mobilisation des désirs est une question qui se pose encore après le capitalisme, et qu’elle est aussi une question qui se pose déjà en son sein, pour tous ceux qui essaient d’inventer autre chose.
7Ce qui m’intéresse dans la recherche déployée tout au long de Capitalisme, désir et servitude, c’est qu’on vous sent travaillé par une tension ou une contradiction, qui porte sur la possibilité de continuer à penser les concepts de domination, d’exploitation et d’aliénation. Cette contradiction touche en vous le marxien et le bourdieusien, mais c’est le spinoziste qui doit en quelque sorte trouver les moyens de la dépasser, parce que c’est aussi le spinozisme qui l’a fait naître. Je m’explique. Deux postulats théoriques rendent problématique le maintien des concepts de domination, d’exploitation et d’aliénation. Le premier touche à la question du consentement, et au choix plus général d’adopter une anthropologie spinoziste pour penser non seulement la sphère de la circulation et de l’échange (comme dans L’intérêt souverain) mais aussi celle de la production et du salariat. Le second postulat est celui, proprement économique, du refus des théories substantialistes de la valeur, que vous héritez d’André Orléan, mais que vous retraduisez immédiatement dans les termes de l’anthropologie spinoziste (nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons). Je me propose d’exposer d’abord en quoi ces deux postulats sont porteurs de tension ou de contradiction, et font du maintien des concepts d’aliénation, de domination et d’exploitation, un problème. J’envisagerai ensuite brièvement la façon dont vous résolvez ce problème, et je présenterai dans les interstices quelques remarques critiques.
8La question du consentement, d’abord. Si l’on reprend votre typologie des régimes de production du désir des salariés enrôlés (les trois « épithumè »), on s’aperçoit que dès le deuxième moment (celui du fordisme), une difficulté apparaît : comment parler d’aliénation à partir du moment où l’on se trouve en présence d’un salarié joyeux, qui consent à sa domination ou à son exploitation, qui y trouve apparemment son compte, qui marche et même court vers elle ? Plus largement, comment maintenir l’idée ou le projet émancipateur d’une critique de l’aliénation, à partir du moment où l’on adopte une anthropologie qui détruit la notion même de subjectivité libre et autonome, une anthropologie qui fait de l’hétéronomie passionnelle non la situation factuelle de quelques malheureux, mais le trait constitutif de l’humaine condition ? Quel sens peut-on donner, à partir de ce choix théorique, au geste critique de dévoilement des idéologies et des diverses formes d’aliénation ? En quoi, par exemple, peut-on dire qu’une femme voilée serait plus aliénée que le sociologue ou le philosophe qui la décrit (et lui fait la leçon) ? C’est là une question qui revient plusieurs fois dans votre livre. Elle est motivée par un réquisit ou une exigence spinoziste fondamentale, celle de l’immanence – laquelle entre en tension, voire en contradiction, avec la transcendance ou le surplomb qu’on associe généralement à la position de la critique entendue comme dévoilement. À vous lire, j’ai eu l’impression que cette question n’était pas rhétorique, que vous ne la posiez pas uniquement pour mieux la dépasser ensuite (l’objet du livre est évidemment de dépasser l’aporie), mais qu’elle restait en quelque sorte pendante. Il m’a même semblé que votre texte courait quelquefois le risque de manquer à cette exigence d’immanence. Je voudrais, à titre de première parenthèse « critique », avancer quelques réflexions sur ce point, avant d’aborder le deuxième postulat qui rend problématique l’usage des concepts de domination, d’exploitation et d’aliénation.
9Manquer à l’exigence d’immanence semble un risque consubstantiel aux tentatives philosophiques de décrire, en se fondant davantage sur la littérature néo-managériale que sur un travail préalable d’enquête, le versant subjectif ou affectif du capitalisme néo-libéral. Ces tentatives, qui partent d’intuitions théoriques d’origine foucaldienne5, en viennent souvent à basculer dans une forme de description totalisante – et peut-être unilatéralement sombre et déprimante – de ce que serait l’expérience subjective des dominés en régime néo-libéral. Il me semble (mais c’est là une question relevant d’une économie des affects qui s’intéresserait aux modes d’écriture et aux effets du discours philosophique) que ce genre de description philosophique à vocation critique peut même parfois devenir contreproductive, en ce que la description totalisante désarme le lecteur plutôt que de lui donner des prises sur les situations – des prises que pourrait lui offrir une description empirique pluraliste, guidée par un véritable travail d’enquête couplé à une réflexion approfondie sur les effets performatifs des dispositifs destinés à rendre compte du réel ou du possible6. Il ne s’agit évidemment pas de repeindre en rose une réalité sombre et brutale, mais plutôt de prendre garde à ne pas niveler, dans les comptes rendus qu’on en donne, la multiplicité des plans d’expérience ou des occasions de déploiement de puissance, bref de veiller à ne pas invisibiliser ou tuer dans l’œuf la multiplicité des points par où – comme l’affirmaient naguère Deleuze et Guattari – un champ social ne cesse de fuir7.
10À cet égard, l’une des thèses les plus centrales de votre travail mériterait sans doute une discussion approfondie : la thèse selon laquelle les structures sociales et économiques objectives s’expriment comme configuration de désirs et d’affects8. On peut entendre cet énoncé de manières diverses, et la version la plus réductionniste (dont je ne dis pas qu’elle est nécessairement vôtre) n’est peut-être pas la plus fidèle au réquisit ou à l’exigence d’immanence. On accordera facilement que les structures objectives génèrent des affects, et qu’elles trouvent ainsi quelque chose comme une traduction et une efficace propres dans l’économie des passions. Mais cette économie des passions se réduit-elle à n’être qu’une pure et simple expression des structures objectives ? Rien n’est moins sûr (songeons à la critique althussérienne de la causalité expressive), et si c’était véritablement le cas il semble que le projet de doubler Marx par Spinoza n’aurait plus grand intérêt. C’est précisément parce qu’il se passe quelque chose de plus, ou simplement quelque chose d’autre, au niveau de l’économie des passions, et que ce quelque chose d’autre est pourtant directement branché sur l’économie des choses, ou se déploie sur le même plan d’immanence, que la lecture croisée de Spinoza et Marx présente un intérêt à la fois théorique et politique. On peut tout à fait concéder que le projet plus ou moins conscient animant un certain « esprit du néo-libéralisme » (esprit qu’on dégagera via une analyse philosophique de la littérature managériale) est d’enrôler les puissances désirantes de façon si complète que plus rien d’autre ne subsiste, dans le domaine de la vie pulsionnelle, que l’expression ou le reflet des structures objectives du monde néo-libéral. Mais l’intérêt d’une description spinozo-marxiste de l’économie libidinale ou de la vie passionnelle collective n’est-il pas justement de mettre en évidence et de partager (en s’appuyant aussi sur des enquêtes empiriques) tous les mouvements qui échappent à cette capture néo-libérale, ou qui la mettent localement en échec ?
11Le second postulat qui rend problématique l’usage des concepts de domination, d’exploitation et d’aliénation est celui du refus des théories substantialistes de la valeur. Ce refus, que vous héritez des travaux d’André Orléan, vous amène d’abord à prendre vos distances avec la théorie marxienne de la valeur définie comme temps de travail socialement nécessaire à la production d’une marchandise donnée (temps de travail qu’on peut, à un moment donné du temps socio-historique, déterminer objectivement) et, partant, avec le concept marxien de plus-value ou de survaleur. C’est en effet ce concept, compris comme différence entre la valeur objectivement produite par le travail (envisagé comme actualisation de la force de travail dans des conditions fixées par le patron capitaliste) et la valeur objective de la force de travail (valeur qui s’exprime dans le salaire, en tant qu’il est censé permettre la reproduction, dans des conditions sociales et historiques déterminées, de cette même force de travail), qui fonde l’idée même d’exploitation capitaliste. On sait que pour Marx la particularité de cette exploitation est de ne pas éclater au grand jour, mais d’être en quelque sorte camouflée par la forme-salaire – lequel apparaît comme la rétribution du travail effectivement presté (de sorte que le rapport salarial peut se présenter comme un échange d’équivalents), plutôt que comme le prix de location d’une force de travail ensuite employée à produire (au bénéfice du seul capitaliste) bien plus de valeur qu’elle n’en a effectivement coûté. Tout cet édifice théorique (valeur, survaleur, et théorie du salaire) ne tient pourtant que si l’on considère qu’il est possible de déterminer objectivement, à un moment donné du temps socio-historique, la valeur des choses (et des hommes). Si l’on pose au contraire, comme le font pour des raisons très diverses une série de théoriciens qui défendent une théorie non substantialiste de la valeur9, qu’il est impossible de déterminer a priori la valeur d’une marchandise, c’est le concept marxien de plus-value, et avec lui celui d’exploitation, qui devient caduque et doit être remis sur le métier10.
12C’est en vertu de cette double exigence de prendre au sérieux le consentement des dominés (et les éventuels bénéfices affectifs qu’ils trouvent à être enrôlés) et de refuser les théories substantialistes de la valeur, que vous vous trouvez à mes yeux embarrassé dans l’utilisation des concepts de domination, d’exploitation et d’aliénation. Mais votre fidélité à Marx et à Bourdieu, et le refus de l’état présent du monde, ne vous permettent pas d’y renoncer pour autant. Dans trois sections de Capitalisme, désir et servitude, vous proposez un mode de résolution de cette tension, qu’on peut qualifier de « spinoziste ». Il s’agit des sections respectivement consacrées à redéfinir les concepts de domination, d’exploitation et d’aliénation : « La domination repensée à l’usage du consentement11 », « L’exploitation passionnelle12 », « La défixation (critique de la [dés-] aliénation)13 ».
13J’envisage en bloc la direction dans laquelle vous retravaillez les concepts de domination et d’aliénation, parce que la même stratégie est à l’œuvre dans les deux cas. Tout le problème est de trouver une norme immanente qui permette de penser l’aliénation et la domination (ainsi que son corollaire, la soumission) en prenant acte du fait universellement établi de l’hétéronomie passionnelle, et en n’adoptant pas cette position de surplomb qui manquerait à l’exigence d’immanence, et réduirait l’usage du concept d’aliénation à une vaine façon de désigner « la vie passionnelle des autres14 ». La solution à cette recherche d’une norme immanente, vous la trouvez dans la réinterprétation du conatus proposée par Pascal Sévérac15. Sa lecture consiste à mettre en évidence l’élément de passivité qui gît au sein même de la puissance : toute puissance d’agir est autant puissance d’être affecté que puissance d’affecter, car dans cet être-affecté même se révèle quelque chose comme l’« utile propre » de l’homme16, et s’accomplit la prise de possession de nouvelles dimensions de son être, la découverte et l’apprentissage progressif de « ce que peut un corps ». Ceci étant posé, vous réinterprétez l’aliénation à partir de l’idée de fixation à un domaine restreint d’objets de désir ou à un champ étriqué d’affectabilité17, tout en pensant l’être-dominé comme être-enfermé dans un domaine restreint de jouissance, et la situation de domination comme la configuration qui « confère à certains l’aptitude à se réserver des possibilités (de jouissance) et à en écarter les autres »18. En ce sens, la lutte contre la domination et l’aliénation est lutte pour une possibilité de partage ou de mise en commun des dimensions plurielles de l’expérience. Elle fait signe vers quelque chose comme une exigence « communiste ».
14Reste à aborder la reprise du concept d’exploitation sur fond de refus des théories substantialistes de la valeur. Ce refus, vous le reformulez immédiatement en termes spinozistes (nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons). Vous soutenez que la valeur (morale, économique ou esthétique) n’a pas d’existence substantielle préétablie dans les choses, mais n’est rien d’autre que le fruit des investissements de désir par lesquels s’accomplit le processus de valorisation19. En d’autres termes, vous combattez le substantialisme en rabattant tout le processus de valorisation sur le versant « subjectif » ou « affectif », bref du côté de la dynamique désirante.
15Cette voie n’est pourtant pas la seule possible ; on pourrait de façon au moins aussi fructueuse opposer au substantialisme de la valeur une conception relationnelle et constructiviste du processus de valorisation : il ne s’agirait alors ni de dire que la valeur gît de toute éternité dans les choses mêmes, ni d’affirmer que toute valeur s’enracine dans des investissements libidinaux plaqués sur des objets au fond contingents20, mais de penser que la valeur ne se constitue que dans des épreuves ou des expériences, à la faveur desquelles des qualités objectives s’attestent et prennent consistance, en même temps que se constituent les capacités subjectives à les saisir ou à les apprécier. Vont dans ce sens une série de travaux21 qui pourraient se rattacher à une autre formule spinoziste : « Nul ne sait ce peut un corps »22. Nul ne le sait a priori, avant d’avoir fait l’épreuve ou l’expérience à la faveur de laquelle s’atteste la puissance ou la qualité du corps éprouvé, et à la faveur de laquelle se façonne également la faculté de discernement du corps éprouvant. On pourrait d’ailleurs se demander si cette autre façon de refuser le substantialisme de la valeur ne s’accorde pas davantage à la conception du conatus comme pouvoir d’être affecté (autant que d’affecter), que vous introduisez suite à la lecture de Séverac.
16Ayant intégralement rabattu la valorisation sur la dynamique pulsionnelle, vous avancez l’idée qu’il est tout à fait possible de donner un sens au concept d’exploitation sans passer par le substantialisme de la valeur, puis vous soutenez l’hypothèse selon laquelle cette théorie substantialiste, et toute la construction théorique ou « scientifique » qui l’accompagne (plus-value, surtravail, etc.) n’avait peut-être pour Marx qu’une visée stratégique : un rôle de légitimation ou de justification d’une demande de justice qui, en vérité, se réduirait à l’affirmation égocentrée d’un conatus pronateur (en l’occurrence celui de la classe ouvrière dont Marx se fait le porte-parole). Selon cette hypothèse, qui découle directement de votre théorie de la valorisation, la valeur de vérité elle-même se réduirait à n’être en dernière instance que l’euphémisation d’une position fondamentalement arbitraire et violente, celle du conatus pronateur. Vous pensez donc – dans la continuité des thèses de L’intérêt souverain – l’instauration du discours de vérité comme une mise en forme visant à juguler la violence originaire de la vie sociale.
17 Il serait sans doute, ici aussi, possible de réintroduire une dimension relationnelle et constructiviste à l’origine du processus de valorisation. On peut en effet penser l’identité des rapports de force et des rapports de raison (ou de vérité) sans vider pour autant les choses ou les mots de toute consistance, et sans non plus faire de cette consistance une donnée a priori, mais en la concevant au contraire comme propriété stabilisée et instituée au terme d’une série d’épreuves. C’est là la position théorique conquise par l’épistémologie constructiviste dans sa version post-bloorienne (« principe de symétrie généralisée23 »), telle qu’elle s’expose, sous l’égide de Spinoza (il n’y a que des rapports de force, mais nul ne sait, avant d’en avoir fait l’épreuve, ce qu’est et ce que peut une force), dans la deuxième partie du livre de B. Latour sur Pasteur24.
18Le moment final de l’argumentation consiste à poser qu’il n’est pas besoin de théorie objective de la valeur pour contester le bien-fondé de la répartition actuelle des valeurs : cette contestation s’accomplira simplement sur le mode d’une revendication antagoniste, fondée sur nulle autre autorité que l’affirmation par un groupe de son désir et de sa puissance propre. C’est pourquoi vous affirmez ensuite que, dans la théorie marxienne de la plus-value, le moment (politique) de la capture ou de l’appropriation privative est plus important que le moment (économique) du différentiel de valeur (valeur produite – valeur de la force de travail). Vous proposez dès lors de ressaisir l’idée d’exploitation à partir de celle de capture, et par là de la généraliser cette idée d’exploitation à des situations qui excèdent le domaine de l’économie en régime capitaliste. Ce qui vous conduit finalement à dégager la figure d’un patronat général25, dont le concept désignera tous les modes possibles de capture de puissances d’agir au service d’un désir-maître et des bénéfices (matériels, mais aussi symboliques ou affectifs) que son entreprise peut engendrer : désir-maître du patron de laboratoire, du mandarin universitaire, du metteur en scène ou du cinéaste, etc. Ce concept de patronat général marque à la fois la réussite de la tentative de redéfinition du concept d’exploitation, et la conquête du point où les instruments d’analyse du monde capitaliste peuvent désormais aussi servir à penser ce qui excède le capitalisme, ou ce qui tente de fonctionner dans ses marges. Nous avons vu précédemment que la lutte contre la domination et l’aliénation était lutte pour une possibilité de partage ou de mise en commun des dimensions plurielles de l’expérience. Si la lecture croisée de Spinoza et Marx, au fil conducteur des concepts d’entreprise, de capture et de patronat général, nous avertit qu’une hypothétique sortie du capitalisme ne suffira pas à garantir cette possibilité26, elle indique pourtant les ressorts passionnels sur lesquels il convient de travailler dès maintenant, si l’on veut tenter de satisfaire à quelque chose comme une exigence « communiste ».
19Je vous remercie d’avance de l’attention que vous porterez à ces quelques remarques.
20Très cordialement,
21Julien Pieron
Notes
1 F. Lordon, Capitalisme, désir et servitude, Paris, La Fabrique, 2010.
2 Ibid., p. 17-18.
3 Ibid., p. 166.
4 Ibid., p. 184-185.
5 Je songe notamment au livre de M. Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté. Essai sur la condition néolibérale (Paris, Amsterdam, 2011) ou aux analyses de Pierre Dardot et Christian Laval dans La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale (Paris, La Découverte/Poche, 2010).
6 C’est en effet une question fondamentale d’épistémologie des sciences sociales que celle de savoir si l’enquête constate le réel ou prend soin du possible.
7 Voir G. Deleuze et F. Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972.
8 F. Lordon, Capitalisme, désir et servitude, p. 73.
9 Soit qu’ils soutiennent la thèse d’un fondement subjectif ou intersubjectif de la valorisation, soit qu’ils soulignent l’existence plus ou moins récente d’un capitalisme cognitif ou d’un travail immatériel rendant impossible la détermination de quelque chose comme un « temps de travail socialement nécessaire » à la production d’une marchandise donnée, et déplacent en conséquence le nerf de la dynamique capitaliste depuis l’extorsion de la plus-value vers la constitution de rentes de monopole.
10 D’un point de vue politique, le refus des théories substantialistes de la valeur est assez ambivalent : s’il peut déboucher sur l’exigence d’un travail de reconstruction du marxisme (par exemple chez Gorz), il peut également servir à nier la réalité historique de l’exploitation. On trouve ainsi, dans la Psychologie économique de Gabriel Tarde, une série d’arguments qui, en anticipant les théories du travail immatériel, tentent d’établir que les ouvriers, bénéficiant des progrès offerts à l’humanité par de généreux patrons-entrepreneurs, « exploitent » tout autant leurs patrons que ceux-ci exploitent leurs salariés. À la différence de l’étude de Lazzarato (Puissances de l’invention, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2002), l’ouvrage que Bruno Latour et Vincent Antonin Lépinay ont consacré à la Psychologie économique de Tarde (L’économie, science des intérêts passionnés, Paris, La Découverte, 2008 – ouvrage lui aussi porté par le refus des théories substantialistes de la valeur) fait parfois plus que flirter avec cette interprétation « révisionniste » du capitalisme cognitif et le culte du patron-entrepreneur.
11 F. Lordon, Capitalisme, désir et servitude, p. 139-143.
12 Ibid., p. 148-158.
13 Ibid., p. 182-185.
14 Ibid., p. 139.
15 Voir P. Sévérac, Le devenir actif chez Spinoza, Paris, Honoré Champion, 2005.
16 F. Lordon, Capitalisme, désir et servitude, p. 142.
17 Ibid., p. 184-185.
18 Ibid., p. 142.
19 Ibid., p. 149.
20 C’est dans cette direction que tendent les exemples que vous présentez, en partant notamment de l’expérience artistique (cf. par ex. ibid., p. 91-92) : je juge telle œuvre belle parce que je la désire, et je la désire parce que d’autres la désirent ou que des institutions légitimes la désignent comme désirable : tout est ici rapatrié sur le versant de la socialité passionnelle, et l’on a l’impression que l’objet sur lequel ces appréciations se cristallisent n’a aucune épaisseur propre, qu’il ne possède quasiment rien qui justifie cette attribution de valeur.
21 Je pense à des travaux de sociologie pragmatique consacrés aux questions du goût et de l’expertise, par exemple ceux d’Antoine Hennion (La passion musicale, Paris, Métailié, 1993) ou de Christian Bessy et Francis Chateauraynaud (Experts et Faussaires, Paris, Métailié, 1995).
22 Cf. Spinoza, Éthique, III, II, scolie : « Personne […] n’a jusqu’ici déterminé ce que peut le corps » (Œuvres complètes, Pléiade, p. 416), « on ne sait pas ce que peut le corps » (ibid., p. 417), et le commentaire célèbre de Deleuze : « Lorsque Spinoza dit : Nous ne savons même pas ce que peut un corps, cette formule est presque un cri de guerre. » (Spinoza et le problème de l’expression, Paris, Minuit, 1968, p. 234).
23 Ce principe requiert non seulement que les mêmes modalités d’explication s’appliquent aux vainqueurs et aux vaincus de l’histoire des sciences, mais interdit également d’utiliser « la société » ou « le social » pour expliquer la nature et sa connaissance par la science : il exige de penser une co-constitution ou une co-construction continuée de la nature et de la société. La réécriture française [1988] du premier chapitre de Laboratory Life [1979] déclare : « La notion de symétrie implique donc pour nous quelque chose de plus que pour Bloor : non seulement il faut traiter dans les mêmes termes les vainqueurs et les vaincus de l’histoire des sciences, mais il faut traiter également et dans les mêmes termes la nature et la société. On ne peut croire dur comme fer à la première afin de mieux expliquer la seconde, croire bravement aux classes sociales afin de douter mieux de la physique… […] Le travail de terrain que nous présentons ici est donc deux fois symétrique : il s’applique au vrai comme au faux, il s’efforce de retravailler et la construction de la nature et celle de la société » (B. Latour et S. Woolgar, La vie de laboratoire, Paris, La Découverte/Poche, 1996, p. 21-22).
24 Ce livre sur Pasteur (Les Microbes : guerre et paix, Paris, Métailié, 1984) constitue l’une des plus remarquables études d’un cas d’école de capture de puissances humaines et non humaines au service d’un désir-maître. Il entre par là directement en résonance avec les questions abordées dans Capitalisme, désir et servitude.
25 Ibid., p. 156.
26 Ibid., p. 194.