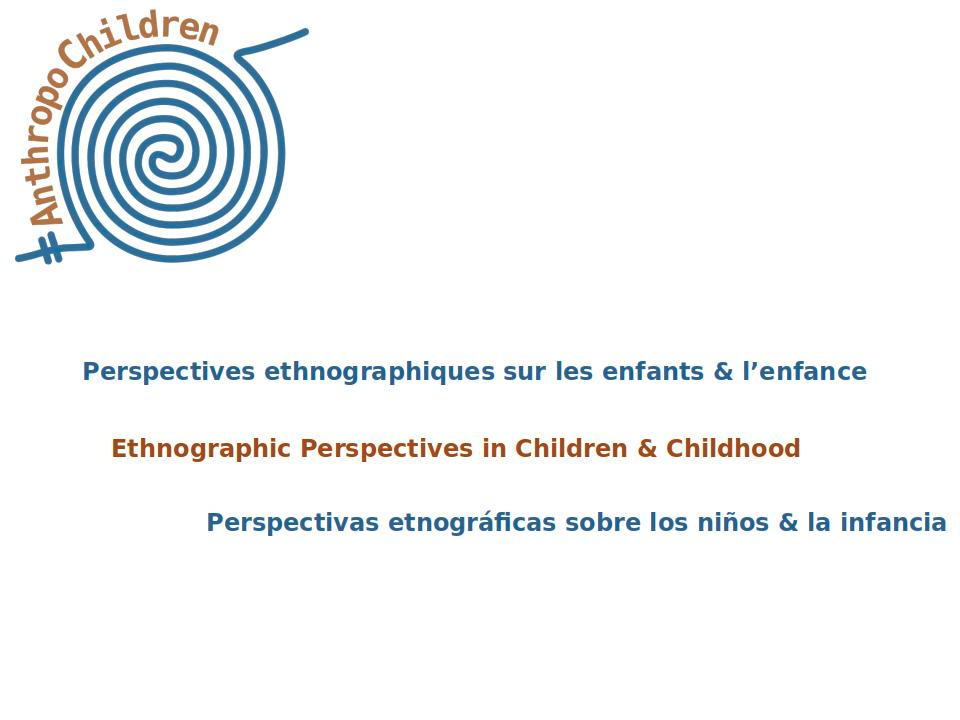- Portada
- N° 13 (2025) / Issue 13 (2025)
- Introduction
Vista(s): 227 (2 ULiège)
Descargar(s): 0 (0 ULiège)
Introduction
Les rituels de l’enfance sous leurs multiples formes

Tabla de contenidos
1Les modalités de participation des enfants aux pratiques rituelles, qu’elles soient religieuses ou laïques, constituent un objet de recherche longtemps négligé, mais ayant pourtant donné lieu à d’importantes découvertes et élaborations théoriques – que ce soit de la part des fondateurs de la discipline ou de chercheurs contemporains qui s’inscrivent souvent dans le domaine de l’anthropologie de l’enfance1. Au sein de ce champ de recherches, les rites propres au temps de l’enfance ont été certes déjà largement documentés, mais ils ont été explorés à nouveaux frais lors de la troisième et de la quatrième édition de l’atelier « Enfants et rites. Des sujets, des acteurs ou des objets ? » organisées à l’université de Liège en 2021 et en 20222. Le présent numéro thématique regroupe des articles rédigés à partir de communications présentées lors de ces rencontres. L’ambition première qui sous-tend l’organisation de cet atelier, depuis ses débuts en 2017, est de promouvoir un champ de recherche étudiant les pratiques rituelles en croisant des approches et théories relevant de l’anthropologie de l’enfance et des enfants et de l’anthropologie générale. Les modes de participation des enfants aux rituels y sont abordés à partir d’un questionnement à visée exploratoire : les enfants sont-ils les sujets, les acteurs ou les objets des rites auxquels ils prennent part ?
2Les cinq articles rassemblés ici abordent tous ce que l’on peut désigner comme des rituels de l’enfance ou des activités quotidiennes ritualisées propres à l’enfance, et tentent d’interroger la part d’agentivité des enfants (James & Prout 1996 ; Oswell 2013) dans ces pratiques socialisatrices. Ils traitent d’actes, d’attitudes ou de paroles d’enfants et d’adultes qui témoignent d’une capacité d’influence des enfants ou des mondes enfantins sur le déroulement des pratiques socio-culturelles considérées – et sur les logiques sociales et symboliques qui les sous-tendent – au sein de structures sociales définies. Nous avons donc décider d’intituler ce dossier Les enfants dans les rites de l’enfance. Entre socialisation et agentivité. Ce que l’on désigne ici comme agentivité ou agency concerne non seulement la capacité d’action des enfants, mais aussi les conséquences de ces actions au sein du groupe social dont ils font partie. Elle est à chaque fois envisagée à travers sa conception emic (Lancy 2012), ce qui impose de s’intéresser plus largement au statut des enfants et aux représentations élaborées à leur sujet dans chaque société considérée.
3Ainsi les formes d’agentivité enfantine mises en évidence par les contributrices sont-elles très différentes les unes des autres en raison de la diversité des contextes considérés. Anne Fournier montre que pour comprendre la façon dont est envisagée la capacité d’agir des bébés sémé du Burkina Faso (leur caractère et leurs comportements), il convient de travailler sur les représentations associées aux composantes spirituelles de la personne susceptibles d’influencer leurs attitudes – en l’occurrence un génie animal. Palmira La Riva González et Walter Aparicio Riveros soulignent également cet aspect en exposant la conception relationnelle de la personne humaine de la communauté andine de Ccachin, au Pérou, qui est liée à la façon dont les garçons, à partir de l’âge de dix ans, prennent part à la vie politico-cérémonielle en intégrant le premier échelon des charges décisionnelles appelées varayuq. Participer au domaine du politique et accompagner leurs aînés précocement fait pleinement partie du long processus par lequel chacun devient une personne humaine. Cependant, de nos jours, seuls ceux qui en manifestent clairement la volonté sont investis de cette charge, car l’influence des modes de vie urbains avec lesquels certains enfants sont en contact peut diminuer la motivation des enfants. Mitra Asfari montre quant à elle que chez les enfants ġorbat d’Iran – population minoritaire – le rite quotidien de la mendicité, encadré étroitement par des parentes adultes, est l’occasion pour les enfants de manifester une aptitude à l’initiative et à l’opposition vis-à-vis de leur entourage adulte, tout en intégrant un sentiment d’appartenance communautaire qui contraste avec la société iranienne majoritaire, apparaissant comme « autre ». Étudier la mendicité à partir d’une réflexion sur l’agentivité enfantine lui permet de rompre avec les analyses fonctionnalistes de la mendicité. Dans un tout autre contexte, Lisa Renard interroge la façon dont les enfants peuvent recevoir des élaborations artistiques présentant une forme de ritualisation. À partir d’une ethnographie d’ateliers d’éveil artistique et culturel mis en œuvre au sein de crèches ou chez des assistantes maternelles en Alsace, elle montre comment les jeunes enfants deviennent « agents primaires » ou « secondaires » des performances artistiques auxquelles ils assistent et participent. Enfin, Viola Teisenhoffer montre que parmi les groupes néopaïens de Hongrie au sein desquels elle a enquêté, l’agentivité enfantine est en quelque sorte indirecte et structurelle (indépendante d’une intention enfantine), puisque les enfants sont peu présents dans les pratiques observées, mais les références à l’univers de l’enfance y sont constantes.
4Nous reviendrons plus précisément sur chacune de ces contributions en montrant comment elles s’inscrivent dans des thématiques propres à l’étude des rituels de l’enfance tout en les documentant de manière originale.
Les rituels de l’enfance au fil des âges
5Les rituels de l’enfance qui ont le plus souvent été étudiés par les anthropologues consistent en des pratiques instituées, correspondant à des rites de passage, qu’ils soient en lien ou non avec un cadre religieux, et sur lesquels on pourrait penser a priori que les enfants ont peu de prise, puisqu’ils y apparaissent d’abord comme « faisant l’objet » du rituel. C’est le cas notamment des rites de naissance, rites d’anniversaire, rites de citoyenneté, rites initiatiques ou de passage à l’âge adulte. Ces catégories de pratiques rituelles ont été largement étudiées, et il a parfois été montré que même si les enfants apparaissent comme « subissant » le rituel, ils en sont aussi les sujets ou les acteurs, dans le sens où ils peuvent contribuer à le faire perdurer ou influencer son déroulement.
6Ainsi, dans la petite enfance, les bébés peuvent apparaître d’abord comme les réceptacles de gestes rituels. Il s’agit par exemple d’orner ou de façonner le corps d’un nouveau-né par des soins quotidiens (massages, emmaillotages) ou des rites ponctuels qui doivent favoriser sa croissance et sa protection, l’humaniser et le socialiser, ce qui implique aussi de lui attribuer un nom (Bonnet & Pourchez 2021[2007] ; Razy 2008). Mais le déroulement de ces pratiques peut dépendre de signes perçus comme un consentement ou comme une demande provenant de l’enfant lui-même (Gottlieb 2004). Dans certaines sociétés, les nouveau-nés, voire les fœtus, sont en effet vus comme dotés de désirs et d’intentions. C’est le cas dans les différentes configurations de retour d’ancêtres ou de réincarnation diffuse (Rabain 1979 ; Razy 2007), dans lesquelles un nouveau-né est considéré comme déjà pourvu de mémoire et d’expériences en lien avec une ou des vies passées (Lallemand 1979 ; Bonnet 1994 ; Saladin d’Anglure 1998 ; Walentowitz 2005 ; Mills 2006 ; Kermani 2013). Le comportement du nourrisson peut aussi dépendre d’entités non-humaines qui l’animent et constituent éventuellement une composante spirituelle durable : un génie (Cartry 1973) ou un double animal (Katz 2007). Un bébé pourra ainsi refuser de sortir du ventre de sa mère, exiger un don, contraindre les adultes, par ses pleurs, à organiser un rite qui permettra de mieux connaître ses souhaits ou ceux des entités qui le gouvernent.
7Dans la continuité de ces travaux, Anne Fournier nous propose dans ce numéro un exemple de configuration sociale où certains comportements des bébés sèmè (Burkina Faso), dans la période qui précède l’accès au langage et à la marche, posent question, car ils sont mis en rapport avec l’influence exercée par un génie-animal correspondant à une entité tutélaire invisible. Ces attitudes de l’enfant, parfois très discrètes, sont interprétées en termes de mimétisme animal et d’imprégnation du caractère. Mais il est peu aisé de déterminer si ces différentes attitudes sont induites par le génie ou décidées par l’enfant lui-même, et la réponse proposée, non univoque, s’appuie sur l’étude des représentations liées à la conception des personnes. Elle explicite le comportement de l’enfant à la fois comme un mode de communication du génie-animal qui cherche à manifester sa présence et à recevoir un don promis par l’âme de l’enfant avant de naître, et comme résultant d’un choix primordial de l’âme de l’enfant, dans le monde prénatal, d’être associé à tel ou tel animal. Ce sont donc l’âme de l’enfant et le génie-animal qui, entrant en interaction, programment et réclament successivement la mise en œuvre de rituels devant satisfaire la part animale de l’individu. Un détour par l’analyse du climax de l’initiation masculine au Donoblé, correspondant à la possession initiatique par un génie-animal vécue par certains hommes, donne à comprendre de manière originale des liens de continuité entre comportement du jeune enfant et aboutissement initiatique. La mise en regard entre gestes enfantins et possession révèle que chacun et chacune contient en soi une composante animale qui oriente une part de son agentivité, dans l’enfance comme à l’âge adulte, en contexte rituel mais aussi au quotidien.
8Les rites de passage qui scandent les différentes étapes de la croissance physique et morale d’une personne, et le franchissement de la puberté, sont probablement ceux auxquels on pense en premier au sujet des rites de l’enfance. Parmi eux figurent les initiations dites « tribales » (Zempléni 1991) ou « inclusives » (Hamberger 2021). Elles procèdent de manière instituée à une transformation de l’enfant en une nouvelle personne, cheminant vers le statut d’adulte, par le biais de rituels répondant au modèle mis en évidence par Van Gennep (1991 [1909]) et retravaillé par Turner (1990), du passage successif par trois étapes : une période de séparation, une période de marge ou de liminarité, et enfin une phase d’agrégation. Dans ces contextes très formalisés, certains travaux témoignent de la capacité des enfants à affirmer leur volonté ou leurs opinions. Ils peuvent ainsi bousculer un cadre initiatique qui leur est fermé. La fréquentation des marges du rite (plus ou moins clandestine) leur permet de se familiariser avec des critères esthétiques déterminants dans la maîtrise future de danses (Binkley 2006). Cela peut aussi favoriser la création de chants qui sont ensuite réemployés par les adultes (Cameron & Jordán 2006). Les règles d’accès aux initiations sont parfois modifiées temporairement, par exemple lorsqu’un garçon manifeste courageusement sa volonté d’être initié plus tôt que prévu (Cameron & Jordán 2006). En outre, lorsque des enfants sont des acteurs importants de l’initiation de jeunes gens plus âgés qu’eux, la prise en compte de leurs souhaits peut faire partie des « épreuves » menant au statut d’adulte (Daugey 2019).Dans un autre registre, une pratique telle que le rituel de la petite souris, qui scande une phase de renouveau physique interne à l’enfance, peut être interrompue par la sentence du ridicule émise par les enfants les plus grands (Delalande 2007). Enfin, certains changements sociaux menaçant la pérennité ou le succès d’une cérémonie peuvent impliquer de prendre davantage en compte le souhait des jeunes d’être initiés ou non (Werbner 2014), ou leurs centres d’intérêt, comme dans le cas du processus de ludification et de spectacularisation des cérémonies d’accès à la citoyenneté en Suisse (Csupor et al. 2016).
9Aucun des textes regroupés ici ne traite véritablement d’une initiation formelle accompagnant la période de transition vers l’âge adulte. Mais l’étude des pratiques de mendicité des enfants ġorbat d’Iran conduit Mitra Asfari à considérer que la période de l’enfance dédiée à cette activité quotidienne peut être analysée dans sa totalité comme une phase de liminarité qui est largement consacrée à expérimenter les limites de divers interdits. Accompagnés par des femmes de leur entourage dans les rues de Téhéran, filles et garçons, qui sont rarement scolarisés, sont alors plongés dans le monde des tāï, les non-ġorbat, pour mendier au sein d’un univers « autre » : la société iranienne majoritaire. Or, cette expérience quotidienne présente certains traits caractéristiques d’une période de marge : côtoyant les bords de routes et les carrefours, ils se situent dans des lieux de passage, où ils expérimentent la transgression. Transgression vis-à-vis de la loi iranienne interdisant la mendicité, et transgression des règles édictées par les femmes qui les encadrent et les soumettent régulièrement à leurs insultes et à leurs menaces. Dans cet entre-deux, ils expérimentent différents risques d’exclusion du groupe des ġorbat, réelle ou symbolique, tout en intégrant certains comportements et un état d’esprit vus comme caractéristiques de l’identité ġorbat : l’affirmation de soi par la répartie et l’esquive sont valorisées dès l’enfance, encourageant à la négociation et à la transgression. La pratique ritualisée de la mendicité dite adūri est ainsi plus qu’un rite du quotidien, et constitue une forme de socialisation par le biais d’une invisible initiation où chacun « se fait » (Fabre 2019). Cette initiation est caractérisée par l’exploration régulière d’un au-delà de la communauté3 en se conformant à des codes précis. Cet au-delà apparaît comme davantage en affinité avec les femmes, à l’image de ce que l’on constate dans d’autres contextes initiatiques confrontant les impétrants à un autre monde, non socialisé ou socialisé différemment.
Socialisation, institutions et transmission
10Si pour les enfants ġorbat, déroger aux règles édictées est institutionnalisé, dans d’autres rites du quotidien dont on peut dire également qu’« ils ne se voient pas » (Jeffrey 2014 : 74), et qui consistent en des « routines ordinaires du lien social » (Joseph 1998 : 42), c’est le respect des règles qui est particulièrement valorisé dans la construction de ce l’on peut désigner comme un « bon enfant » (Fechter 2014). De longue date, les pratiques ritualisées de la vie quotidienne, à commencer par les « rites de civilité » ont été analysées comme visant à « entretenir et à maintenir un ordre social propice à la vie commune » (Jeffrey 2014 : 75)4, cet ordre social étant toutefois soumis à une certaine plasticité. La manière même de se tenir et de se mouvoir fait l’objet, dès les premières années de vie, de « techniques du corps » (Mauss 1936) acquises, actualisant un « agir corporel commun » (Jeffrey 2014 : 78). Ces manières d’être ou habitus sont en partie inculqués dans le cadre d’institutions scolaires, par des adultes encadrants qui, par le biais de routines ritualisées, incitent à se plier à des normes ou règles supposées propices à la transmission de savoirs ou à la « pratique d’œuvres » (Garcion-Vautor 2003 : 145). Comme le souligne Alain Marchive, l’école « définit des conditions particulières de transmission des savoirs fondées sur l’organisation de l’espace et du temps, la définition des rôles et des places de chacun, le contrôle de la parole et du geste qui fondent l’ordre scolaire et en génèrent les diverses modalités » (2007 : 597). Cette « socialisation scolaire » (Garcion-Vautor 2003 : 146) passe donc largement par des tentatives de contrôle des corps et des comportements de la part des encadrants. De telles mesures sont également prises dès la crèche. Dans ce dernier contexte, l’intégration des règles se fait d’ailleurs souvent lors de conflits d’obéissance entre enfants et adultes qui construisent la subjectivité de chacun (Luciani 2024).
11L’article de Lisa Renard, consacré à la ritualité d’activités destinées à des enfants d’âge pré-scolaire (de 3 mois à 3 ans), observées dans des crèches d’Alsace bossue, rend compte de manière précise de la façon dont les tout-petits sont invités à se conformer à des normes comportementales. Son analyse d’ateliers d’éveil artistique et culturel, organisés souvent mensuellement, permet de comprendre que leur position de spectateurs, éventuellement participants, induit diverses formes d’ajustement des attitudes corporelles, résultant du mimétisme des adultes ou de demandes des professionnelles5. Cependant, la souplesse des dispositifs autorise certaines initiatives enfantines. Les enfants expérimentent ainsi une palette relativement large de postures, alternant entre immobilité attentive et engagement expressif, allant jusqu’à prendre une part active au déroulement de l’atelier en y injectant une part d’inattendu et de créativité. Ils contribuent ainsi à l’assouplissement du cadre formel du type de spectatorialité initialement imposé.
12Viola Teisenhoffer aborde d’une autre façon, dans sa contribution, le thème de la transmission des expériences et des savoirs. L’auteure montre comment, parmi des groupes néopaïens de Hongrie, qui cherchent à se réapproprier des pratiques spirituelles préchrétiennes en vue d’accéder à un mieux-être personnel et collectif, certaines idées et pratiques issues du monde de l’enfance sont réinterprétées et transmises entre adultes sous la forme d’enseignements ou de rituels. Il n’est donc plus question ici de rites de l’enfance à proprement parlé, mais de rites d’adultes inspirés par des thèmes, jeux, productions orales associés à l’enfance. Au sein de ces groupes néopaïens, les pratiques rituelles elles-mêmes n’accordent pas de place privilégiée aux enfants et sont surtout fréquentées par des adultes. Toutefois, les références à l’univers des enfants y sont singulièrement nombreuses, à commencer par le langage employé pour évoquer l’élèvement spirituel recherché : il fait référence à l’idée de « croissance » ou de « développement ». Les pratiques rituelles néo-chamaniques miment parfois la renaissance ou une gestation, s’appuient sur des chansons pour enfants ou intègrent des jeux. Les élites intellectuelles du mouvement ont souvent été fortement marquées, dans leur enfance, par des mythes et légendes relatifs aux anciens rois, aux Indiens d’Amérique, aux Hun et aux Magyar envisagés comme les ancêtres des Hongrois, et leurs enseignements actuels ainsi que les rituels qu’ils dirigent puisent dans cet imaginaire. D’ailleurs, certains enseignants promeuvent l’idée que les dessins des enfants contiendraient des symboles témoignant d’une sagesse originelle d’inspiration divine en lesquels il conviendrait de rechercher une vérité. Si les enfants peuvent ainsi apparaître comme la source d’un savoir fondamental, les participants à ce mouvement se trouvent également très souvent dans une position d’élève assimilable à celle qu’occupent les enfants dans un milieu scolaire. Les relations entre participants prennent ainsi très souvent la forme de rapports entre maître et élève, ou parent et enfant, que ce soit lorsque des experts en position d’aînés dispensent leurs enseignements, ou lors d’échanges d’expériences entre participants. L’enfance, les enfants et certains imaginaires qui leur sont associés apparaissent ainsi, parmi les néopaïens de Hongrie, comme des références ou ressources qui contribuent de manière importante à façonner les pratiques rituelles et les modes de transmission de savoirs, les enfants étant perçus comme en communication privilégiée avec le divin. L’auteure montre de manière novatrice que dans un tel contexte, c’est le monde de l’enfance dans son ensemble qui devient source d’inspiration pour les adultes, les enfants façonnant indirectement l’univers néopaïen.
Les enfants dans des rôles rituels insoupçonnés
13Dans d’autres contextes, les propriétés physiques ou spirituelles attribuées aux enfants, ou l’appartenance à une catégorie d’âge spécifique, à laquelle sont associées certaines représentations, destinent certains enfants à jouer des rôles cérémoniels importants. Il s’agit là d’une autre catégorie de rites de l’enfance assez peu étudiée. Chaque société possède ses propres définitions et scansions des premières années de la vie humaine (Peatrik 2003, Montgomery 2009), et certaines qualités associées à chaque âge ou/et genre peuvent ainsi conduire à faire participer les enfants à différentes catégories de rituels, en raison de la pertinence et de l’efficacité accordée à leur présence et à leurs actes. Dans certaines sociétés, à l’image des néopaïens de Hongrie, les plus jeunes sont pensés comme proches d’un monde invisible lié aux ancêtres, aux divinités ou à d’autres entités dont dépend le renouveau de la vie humaine et le bien-vivre sur terre. De ce fait, ils peuvent avoir la charge d’un culte de manière particulièrement autonome (Le Moal 1981 ; Jonckers 1988), ou certains d’entre eux peuvent être investis de messages à destination de l’humanité (Voisenat 2005). Certaines de leurs qualités physiques, telles que la vitalité ou la virginité peuvent aussi être perçues par les adultes comme les rendant aptes à jouer des rôles de médiateurs avec différents types d’espaces et de divinités ressources (Lorcy 2012 ; Jolly 2013 ; Daugey 2017). De plus, conjointement à leurs implications religieuses ou cosmologiques, il arrive que des rôles rituels occupés par des enfants constituent des formes de familiarisation à des enjeux politiques (Borneuf 2018 : 146), ou même de réinterprétation de mécanismes du pouvoir (Argenti 2001 : 79).
14Palmira La Riva González et Walter Aparicio Riveros analysent un exemple remarquable relevant d’une telle configuration. Ils montrent que dans la communauté andine de Ccachin, au Pérou, les garçons âgés de 10 à 17 ans peuvent intégrer de plein droit, s’ils en manifestent la volonté, le système d’autorités politico-religieuses « traditionnelles » appelé varayuq, parallèle au pouvoir étatique6. Chaque année, l’un d’entre eux est choisi pour jouer le rôle de regidor de pututu, c’est-à-dire de joueur d’une trompette cérémonielle correspondant à une impressionnante conque marine. Cette intronisation est un passage obligé avant d’accéder successivement à d’autres charges tout au long de la vie. Le regidor de pututu accompagne au quotidien l’autorité principale dans une fonction d’assistant et joue un rôle de messager. En faisant retentir son instrument, il avertit la communauté de la tenue de cérémonies ou de travaux collectifs ; il scande également les différentes étapes des temps forts de la vie de la communauté. Les auteurs montrent que l’intégration des garçons à ce système de charges politiques est indissociable d’une appréhension locale de l’agentivité de la personne comme faisant partie d’un tissu de relations avec les autres membres de la société et diverses composantes de l’environnement.
Conclusion
15Les différentes études présentées ici montrent que d’un contexte socio-culturel à l’autre, les rites de l’enfance ou inspirés par l’enfance ne constituent pas des isolats qui pourraient être étudiés indépendamment du cadre social plus large dans lequel ils s’inscrivent. Ils reposent sur des structures sociales élaborées en interconnexion et en co-construction avec les mondes des adultes (Ridgely 2012). Les pratiques dont il est question dans ce numéro sont toutes élaborées sous la direction d’adultes, et les enfants participent à différentes activités ritualisées parce que les adultes les y invitent. Mais ces invitations témoignent de conceptions à chaque fois spécifiques d’une définition de l’enfance et de l’agentivité des enfants. Les auteurs des différents articles témoignent ainsi de modalités diverses d’interventions et de prises de décisions des enfants ayant des effets sur leur vie quotidienne et sur leur propre destin, ainsi que sur la vie des adultes qui les entourent. Elles montrent que, dans bien des domaines, il peut être éclairant de partir du regard des enfants pour saisir les logiques de pratiques non exclusivement enfantines (James 2007). Leurs contributions posent les jalons de recherches futures dans des domaines jusqu’à présent peu explorés d’un point de vue anthropologique, tels que la participation des enfants à la vie politique, les statuts des enfants dans les nouvelles spiritualités d’inspiration New Age, la vie des enfants dans les crèches, les relations des enfants aux animaux (sur un plan spirituel ou matériel) – ou encore les initiations invisibles inscrites dans le quotidien.
Bibliographie
Argenti N. 2001 « Kesum-body and the places of the gods : the politics of children’s masking and second-world realities in Oku (Cameroon) », Royal Anthropological Institute (N. S.) 7 : 67-94.
Binkley D.A. 2006 « From Grasshoppers to Babende : The Socialization of Southern Kuba Boys to Masquerade » (105-115), In S. Ottenberg & D. Binkley (eds.) Playful Performers : African children’s masquerades. New Brunswick : Transaction Publishers.
Bonnet D. 1994 « L’éternel retour ou le destin singulier de l’enfant », L’Homme 34(3) : 93-110.
Bonnet D. & Pourchez L. 2021[2007] Du soin au rite dans l’enfance. Ramonville Saint-Agne : Érès / IRD Éditions.
Borneuf A.-F. 2018 « Une voie/voix pour devenir adulte : le chant de la vara à Fiumedinisi (Sicile) », Cahiers d’ethnomusicologie 31 : 137-151.
Cameron E.L. & Jordán M.A. 2006 « Playing with the Future: Children and Rituals in North-Western Province, Zambia » (237-245), In S. Ottenberg & D. Binkley (eds.) Playful Performers : African children’s masquerades. New Brunswick : Transaction Publishers.
Cartry M. 1973 « Le lien à la mère et la notion de destin individuel chez les Gourmantché » (255-282), In La notion de personne en Afrique noire. Paris : Éditions du CNRS.
Casas Sánchez N. 2021 « ‘Vengo a ver a Santito Dios’ : Nociones y prácticas en torno a la religiosidad infantil en Tultepec Estado de México », Thèse de doctorat en anthropologie, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis.
Csupor I., Felder M. & Ossipow L. 2016 « Scène et coulisses des cérémonies d’accession à la majorité civique et civile à Genève », ethnographiques.org 33 [https://www.ethnographiques.org/2016/Csupor-Felder-Ossipow]
Daugey M. 2017 « Emplir les corps des dieux pour rassasier les hommes : étude de manipulations rituelles de bière de sorgho (pays kabye, Togo) », Civilisations 66 (1-2) : 59-75.
Daugey M. 2019 « Parrainage initiatique et confiage rituel. Une relation de pseudo-parenté du point de vue des enfants (pays kabyè, Togo) », AnthropoChildren 9. [https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=3297]
Daugey M., Razy É. & Campigotto M. 2020 « Les enfants dans les rites. Des sujets, des acteurs ou des objets », L’Homme 234-235 : 51-70.
Delalande J. 2007 « La petite souris, ou les aventures d’un rituel enfantin », Momento, Diálogos em Educação 18 : 51-69.
Elias N. 1973 La civilisation des mœurs. Paris : Calmann-Lévy.
Fabre D. 2019 L’invisible initiation. Paris : Éditions de l’EHESS.
Fechter A.-M. 2014 « ‘The good child’ : Anthropological perspectives on morality and childhood », Journal of Moral Education 43(2) : 143-155.
Garcion-Vautor L. 2003 « L’entrée dans l’étude à l’école maternelle. Le rôle des rituels du matin », Ethnologie française 33 (1) : 141-148.
Gottlieb A. 2004 The Afterlife Is Where We Come From. The Culture of Infancy in West Africa. Chicago : University of Chicago Press.
Hamberger K. 2021 « Les espaces initiatiques comme fabriques du genre. Parcours ouest-africains », L’Homme 239-240 : 267-322.
James A. 2007 « Giving Voice to Children’s Voices : Practices and Problems, Pitfalls and Potentials », American Anthropologist 109 (2) : 261-272.
James A. & Prout A. (eds.) 1996 Constructing and Reconstructing Childhood : Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London : The Falmer Press.
Jeffrey D. 2014 « La banalité des rites quotidiens », Sociétés I (123) : 73-81.
Jolly E. 2013 « Courir ou danser entre deux mondes : les performances rituelles des enfants dogon (Mali) » (201-227), In M. Coquet & C. Macherel (eds.) Enfances. Pratiques, croyances et inventions. Paris : CNRS Éditions.
Jonckers D. 1988 « Les enfants de Nya : les activités religieuses des jeunes garçons minyanka », Journal des africanistes 58(2) : 53-72.
Joseph I. 1998 Erving Goffman et la microsociologie. Paris : Presses universitaires de France.
Katz E. 2007 « Rites de vie, rites de mort (enfants mixtèques du Mexique) » (281-300), In D. Bonnet & L. Pourchez (eds.) Du soin au rite dans l’enfance. Ramonville Saint-Agne, Érès / Paris : IRD.
Kermani Z. 2013 Pagan Family Values. Childhood and the Religious Imagination in Contemporary American Paganism. New York & London : New York University Press.
Lallemand S. 1979 « L’enfant dédoublé », Nouvelle revue de psychanalyse 19 : 211- 228.
Lancy D.F. 2012 « Unmasking children’s agency », AnthropoChildren 1(2). [https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=1253]
Lorcy A. 2012 « ‘Faire la joie’ : les enfants dans les rituels funéraires (Noirs du littoral equatorien) », AnthropoChildren 2. [https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=1441]
Le Moal G. 1981 « Les activites religieuses des jeunes enfants chez les Bobo », Journal des africanistes 51 (1-2) : 235-250.
Luciani P. 2024 « Normes et conflictualité à la crèche. Quelques observations anthropologiques auprès des bébés » (99-110), In C. Zaouche-Gaudron, A. Dupuy, E. Gallant & M. Dajon (eds.) L’enfant dans son environnement. Toulouse : Éditions Érès.
Marchive A. 2007 « Le rituel, la règle et les savoirs. Ethnographie de l’ordre scolaire à l’école primaire », Ethnologie française 37(4) : 597-604.
Mauss M. 1936 « Les techniques du corps », Journal de Psychologie XXXII(3-4).
Montgomery H. 2009 An Introduction to Childhood: Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Oxford: Wiley, Blackwell.
Oswell D. 2013 The Agency of Children : From Family to Global Human Rights. Cambridge, New York : Cambridge University Press.
Peatrik A.-M. 2003 « L’océan des âges », L’Homme 167-168 : 7-23.
Rabain J. [1979]1994 L’enfant du lignage. Du sevrage à la classe d’âge chez les Wolof au Sénégal. Paris : Payot.
Razy É. 2007 Naître et devenir. Anthropologie de la petite enfance en pays soninké (Mali). Nanterre : Société d’Ethnologie.
Razy É. 2008 « Comment ‘prendre corps’ ? L’exemple du bébé soninké », In M. Manoha & A. Klein (eds.) Objet, bijou et corps. In-corporer. Paris : L’Harmattan.
Razy É. 2022, 13 mai De l’expérience du dessin d’enfant en anthropologie. Jalons épistémologiques, questions d’éthique (Elodie Razy). [Vidéo]. Canal-U, R-EVE. [https://www.canal-u.tv/138353]
Ridgely S. B. 2012 « Children and Religion », Religion Compass 6(4) : 236-248.
Saladin d’Anglure B. 1998 « Entre forces létales et forces vitales. Les tribulations du fœtus et de l’enfant inuit » (39-58), In C. Legrand-Sébille, M.-F. Morel & F. Zonabend (eds.) Le foetus, le nourrisson et la mort. Paris : L’Harmattan.
Tauber É. 2011 « ‘Te souviens-tu du temps où on allait vendre et mendier ?’ La vie économique des femmes sinti d’Italie du Nord » (115-139), In M. Stewart & P. Williams (eds.) Les Tsiganes en Europe. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
Turner V. 1990 Le phénomène rituel. Structure et contre-structure. Paris, Presses universitaires de France.
Van Gennep A. 1991 [1909] Les rites de passage. Paris : A. et J Picard.
Voisenat C. 2005 « Des enfants nouveaux pour un monde nouveau ou comment peut-on être indigo ? » (129-177), In P. Lagrange & C. Voisenat (eds.) L’ésotérisme contemporain et ses lecteurs : Entre savoirs, croyances et fictions. Paris : Éditions de la Bibliothèque publique d’information.
Walentowitz S. 2005 « La vie sociale du fœtus. Regards anthropologiques », Spirale 36 : 125-141.
Werbner P. 2014 « Between ontological transformation and the imagination of tradition : Girl’s puberty rituals in Twenty-first Century Botswana », Journal of religion in Africa 44 : 355-385.
Zempléni A. 1991 « Initiation » (375-377), In P. Bonte & M. Izard (eds.) Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie. Paris : PUF.
Notes
1 Pour un état des lieux à ce sujet, cf. Daugey et al. (2020).
2 La troisième édition, de 2021, intitulée « Les enfants dans les rites de l’enfance » a été organisée par Marie Daugey et Élodie Razy. La quatrième édition, de 2022, intitulée « Les enfants dans les rites en Mésoamérique et ailleurs », et a été organisée par Neyra Alvarado Solís, Marie Daugey, Olivia Fierro, Mayra Muñoz, Élodie Razy, Charles-Édouard de Suremain et Lorena Ulloa.
3 Comme l’a mis en évidence Elisabeth Tauber (2011) pour les populations tsiganes, la pratique de la mendicité, et par extension la pérennité du mode de vie de ceux qui la pratiquent, ne sont possibles que par la mise en relation avec la population majoritaire.
4 L’auteur se réfère à Norbert Elias (1973).
5 Dans un registre comparable, Élodie Razy (2022) a pu montrer que les dessins d’enfants – activité artistique souvent envisagée en occident comme le propre de l’enfance – font pareillement l’objet de normes et de règles à respecter dans le milieu scolaire ou familial car ils sont envisagés comme une activité d’apprentissage.
6 Voir Norma Casas Sánchez (2021) pour une situation comparable au Mexique.