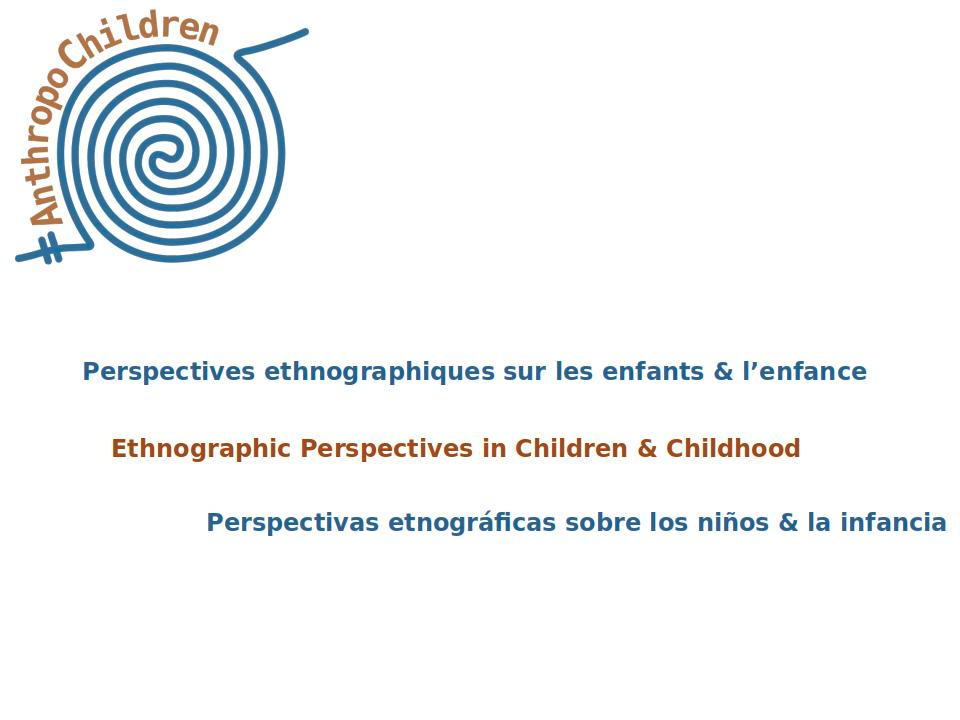- Portada
- N° 13 (2025) / Issue 13 (2025)
- Les enfants face au droit du sol à Mayotte
Vista(s): 127 (0 ULiège)
Descargar(s): 0 (0 ULiège)
Les enfants face au droit du sol à Mayotte

Tabla de contenidos
1À Mayotte, les étrangers ne bénéficient pas des mêmes droits que dans les autres départements français, en raison d’une législation dérogatoire particulièrement restrictive à l’égard des mineurs. Alors qu’en France le droit du sol permet aux enfants nés sur le territoire de parents étrangers d’acquérir la nationalité française à partir de l’âge de 13 ans, à Mayotte, ce droit n’existe plus dans les mêmes termes, à la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur en 2019. La précarisation du statut et du droit des mineurs s’inscrit dans le cadre d’une politique de dissuasion et de lutte contre l’immigration clandestine en provenance des Comores voisines, qui freine leur poursuite d’études et, de manière plus large et durable, leur insertion socio-professionnelle. La relégation de ces enfants aux marges d’une société dans laquelle ils sont nés et ont grandi, sans avoir jamais connu les Comores, les renvoient vers un double statut d’étranger.
Défaire les droits des mineurs : une entreprise de marginalisation systémique
2Dans un contexte de forte pression migratoire (particulièrement comorienne) et démographique, les mineurs étrangers nés à Mayotte sont spécifiquement ciblés par la législation dérogatoire en vigueur, laquelle vise à tronquer leur « droit de naissance ». L’État français crée un précédent à Mayotte : l’importante réforme du droit du sol, introduite par la loi du 10 septembre 2018, « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » ne garantit plus l’accès à la nationalité française de plein droit pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers, créant ainsi de nouvelles singularités ultramarines. Plébiscitée par les élus mahorais et validée par le Conseil constitutionnel, cette adaptation exceptionnelle du droit à la nationalité porte atteinte aux principes d’indivisibilité de la République et d’égalité devant la loi, faisant de Mayotte un territoire d’exception. Depuis le 1er mars 2019, date d’application des amendements (rétroactifs) portés par les élus et sénateurs, la régularité de séjour des parents est une condition sine qua non : un enfant né sur le territoire après le 1er mars 2019 ne pourra prétendre à l’acquisition de la nationalité française seulement s’il peut prouver qu’au moment de sa naissance, l’un de ses parents était en situation régulière depuis au moins trois mois, avec une résidence stable. Pour les enfants nés avant le 1er mars 2019, il faudra apporter la preuve du séjour régulier de l’un des parents pendant cinq ans.
3Par conséquent, le nombre d’acquisitions de la nationalité française a considérablement baissé dans le département : de 2 829 en 2018, il passe à 446 en 2020, d’après les chiffres communiqués par le Ministère de la justice1. Plus récemment, les débats renouvelés autour de la récente proposition de loi visant à renforcer davantage les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte révèlent la permanence des tensions au sujet de l’identité française et de l’acquisition du droit du sol sur le territoire national. Cependant, cette réforme, adoptée dans un objectif de lutte contre l’immigration en provenance des Comores et de limiter l’attractivité de Mayotte dans la région, ne semble pas avoir eu d’effet sur les flux migratoires, ces derniers demeurant soutenus.
4L’entreprise d’effacement progressif du droit du sol, devenu inaccessible pour de nombreux enfants nés à Mayotte, contribue à leur marginalisation au sein de la société. Désavoués par l’État français qui ne les reconnaît plus comme nationaux légitimes de plein droit, ils prennent part à une dynamique de déni d’appartenance citoyenne : certains confient se sentir d’abord Comoriens, plus proches de l’origine et de la nationalité de leurs parents, faute d’avoir obtenu une carte d’identité française. Nés à Mayotte de parents étrangers, ils y ont grandi et y ont été scolarisés depuis l’école élémentaire. Pourtant, ils ne sont pas Français. À l’approche de leur majorité et des examens du baccalauréat, ils redoutent de ne pouvoir poursuivre leurs études faute d’une situation administrative régulière.
5Au sein d’une même fratrie, les enfants disposent souvent de statuts différents en fonction de leur lieu de naissance et de la situation administrative de leurs parents à ce moment-là. Dans le cadre de nos recherches, beaucoup de jeunes majeurs ont témoigné de cette situation : cadets de leur fratrie, ils ne bénéficient pas du même statut ni des mêmes droits que leurs aînés. En effet, ceux qui sont nés à Mayotte avant 2019 et qui ont atteint leurs 13 ans avant le passage de la réforme ont pu bénéficier de leur droit du sol et sont français. En revanche, ceux nés à Mayotte à partir de 2007, qui avaient donc 12 ans en 2019 et ne pouvaient pas encore solliciter la nationalité française par déclaration, voient leur avenir citoyen déterminé par le statut administratif de leur parent. Souraya est née en 2005, elle est la dernière d’une fratrie de cinq enfants. Découragée par sa situation, elle explique :
« Tous mes frères et sœurs sont Français, il n’y a que moi qui suis sans papiers. Mes parents ont un titre de séjour, mais quand j’ai demandé ma nationalité, ils n’avaient pas les cinq ans [requis par la loi], alors on m’a refusé et on m’a dit que je devais demander un titre de séjour. Tout le monde dans ma famille a une situation, sauf moi. Si je me fais arrêter par la police, ils vont m’envoyer à Anjouan alors que j’y suis jamais allée. J’ai peur de sortir de chez moi, même pour aller en cours. »
6Ces altérations de la loi ne sont pas toujours comprises par les familles, qui peinent à assimiler le fait que leur enfant, né sur un territoire français et ne l’ayant jamais quitté, ne sera pas Français de plein droit. Cette rupture d’égalité, qui désoriente les jeunes eux-mêmes, ne leur permet pas d’appréhender avec sérénité leur avenir dans la société mahoraise. À leur majorité, ils rejoignent la cohorte de « clandestins » redoutant de se faire interpeler par la police. Ils doivent alors entreprendre des démarches de régularisation administrative auprès de la préfecture et, pour cela, faire établir un document de nationalité comorienne, ce qui apparaît aux yeux de ces adolescents comme un non-sens. « Je ne suis pas Comorienne, je suis née à Mayotte, je ne suis jamais allée aux Comores ! Pourquoi je devrais avoir une nationalité comorienne ? » s’étonne Faïka, jeune bachelière de 19 ans. Comme elle, de nombreux jeunes majeurs, défaits de leur droit du sol, ne comprennent pas les nouveaux rouages administratifs et législatifs français. De surcroît, pour n’avoir jamais quitté le territoire mahorais, ils disposent comme seul et unique document d’état civil leur extrait d’acte de naissance. Or, le cadre légal français exige que, pour toute demande de titre de séjour, soit présenté un document de nationalité avec photo, de type passeport, carte nationalité d’identité ou carte consulaire. Si les deux premiers documents ne se délivrent qu’en présence de l’intéressé (ils nécessitent une prise d’empreintes biométrique), le troisième peut être réalisé à distance, auprès de l’ambassade des Comores à Paris par exemple. Jusqu’à l’automne 2024, la préfecture refusait (de manière abusive et illégale) les cartes consulaires pour l’enregistrement des premières demandes de titre de séjour : par conséquent, de nombreux jeunes étrangers nés à Mayotte se retrouvaient en situation d’errance administrative. Les plus désespérés allaient jusqu’à effectuer un aller-retour clandestin jusqu’aux Comores pour faire établir un passeport, avant de revenir déposer leur demande de titre de séjour. Or, présenter un passeport établi récemment pouvait constituer un motif de rejet de leur demande car, de fait, le document ne prouvait pas l’absence d’attaches avec les Comores, témoignant d’une rupture avec résidence stable et habituelle à Mayotte depuis leur naissance.
7Cette catégorie de jeunes vient questionner les conséquences des frontières politiques et administratives sur les trajectoires individuelles de ces nouvelles générations « post-frontières », nées après l’établissement de celles-ci. En outre, le statut administratif de ces enfants les rive au territoire lorsque le reste de leur famille est en mesure de voyager légalement vers un autre territoire français2, produisant ainsi une catégorie d’exception : celle de mineurs sans représentants légaux à Mayotte mais qui, d’un point de vue juridique et administratif, ne sont pas considérés comme celle de mineurs non accompagnés (MNA), l’un des parents se trouvant en territoire français.
Entre identité administrative et filiation culturelle, la recherche d’une appartenance légitime
8Les enfants nés à Mayotte de parent(s) Comorien(s), dont certains sont français par droit du sol ou du sang, font face à un dilemme identitaire qu’ils n’expriment pas tous de la même manière. Nous avons établi une typologie qui reprend les trois grandes tendances observées chez les enfants et adolescents rencontrés au cours de nos enquêtes.
-
Certains se disent Mahorais (avec ou sans nationalité française) car ils sont nés sur le territoire. Mayotte est pour eux le lieu de leur enfance, là où ils ont grandi, ont été scolarisés et où ils possèdent leurs repères. Leur construction identitaire est liée à un sentiment d’appartenance territoriale. De plus, les Mahorais ont un statut social, politique et économique supérieur à celui des Comoriens, conduisant une partie de ces jeunes à s’identifier aux Mahorais par rejet d’une identité comorienne marginalisée, privée de prestige et de pouvoir. Nous verrons un peu plus loin que cette honte de se reconnaître Comoriens s’observe surtout en milieu scolaire : la dévalorisation associée à l’identité comorienne, et plus précisément anjouanaise, conduit de nombreux jeunes à dissimuler leurs origines, ou leur statut administratif, pour avoir intériorisé les représentations négatives véhiculées dans la société à propos de cette catégorie de population. L’association entre origine et statut participe au façonnement d’une identité dépréciée : dans l’esprit collectif, être Anjouanais est synonyme de « clandestinité ». Houdade, pourtant Grand-Comorien, résume ce lien qui oblitère toute identité sociale : « Les gens qui n’ont pas de papiers, c’est des Anjouanais. Même moi je suis un Anjouanais parce que j’ai pas de papiers. »
-
D’un point de vue administratif, une autre catégorie de jeunes se distingue par leur revendication de la nationalité française, qu’ils affichent avec fierté, conscients des possibilités dont ils pourront bénéficier en termes de mobilité, de poursuite d’études ou d’aide sociale, par exemple.
-
D’autres, à l’inverse, ne se reconnaissent pas dans cette identité française, acquise par droit du sol ou du sang, et se raccrochent à la nationalité de leur(s) parent(s) en se revendiquant fièrement Comoriens : « Je me vois comme un Comorien même si je suis né ici » ; « Sur les papiers c’est écrit ‘Français’ mais je suis pas un Français car ma mère a galéré pour venir ici », témoignent des collégiens interrogés sur leur sentiment d’appartenance citoyenne. La honte ou le refus de se dire Français évoque de prime abord une contradiction : à la fois désireux de s’intégrer dans la société et de bénéficier des mêmes opportunités et droits que leurs camarades nationaux, ils repoussent cette identité qu’ils n’assument pas. À Mayotte, où la présence des étrangers est sujette à contestation et à un profond rejet, il est difficile pour ces descendants de migrants de se sentir légitimement Français alors que leurs parents éprouvent les stigmates de l’exclusion. Cette tendance témoigne également de l’attachement symbolique aux origines familiales et de la volonté d’asseoir sa légitimité à appartenir à cette identité communautaire.
Être Français par droit du sol à Mayotte : des « Français de papiers » ?
9Au-delà de leur naissance sur un sol français et d’une nationalité obtenue de plein droit, les Comoriens revendiquent leur filiation culturelle. Le discours des jeunes qui sont titulaires de la nationalité française, sans pour autant ressentir un sentiment de citoyenneté, révèle leur inscription dans une catégorie administrative sans projection dans l’identité nationale. Bachir, âgé de 17 ans lors de notre première rencontre, est arrivé très jeune sur le territoire et y a passé toute son enfance. Pourtant, il ne se sent pas Mahorais :
« Mes parents sont nés là-bas [aux Comores], je me considèrerai pas Mahorais, toujours Comorien. Tout le monde pense comme ça, parce que leurs parents sont nés aux Comores. Quand on demande : ‘tu viens d’où ?’ la personne va répondre la ville d’où vient sa mère, aux Comores. »
10Cette forme de « solidarité dans l’exclusion » (se sentir solidaire d’un groupe socialement exclu) marque une volonté de ne pas se distinguer du reste du groupe familial, alors que le statut administratif et les droits politiques divergent. Par exemple, les frères cadets de Bachir, nés à Mayotte, refusent de se déclarer Mahorais : « Ils ne disent pas qu’ils sont nés ici ; ils ne disent pas qu’ils sont Mahorais (rires). On a honte parce que les Mahorais nous attaquent. » Ces propos éclairent sur la double facette de la construction identitaire de ces jeunes, nés dans un entre-deux, dans les marges interstitielles (re)négociées autour de la frontière : à la fois honteux de se déclarer Mahorais sur un territoire qui ne les considère pas comme tels et leur renvoie avec virulence leurs origines comoriennes, et fiers de se rattacher aux origines de leurs parents, qu’ils revendiquent comme un étendard derrière lequel ils peuvent se sentir légitimes, quitte à demeurer dans leur statut d’étranger (c’est l’inversion du stigmate). Cette question de la légitimité semble déterminante dans le processus de construction identitaire des Comoriens nés à Mayotte, ceux-ci ressentant profondément l’absence de légitimité accordée par la société mahoraise à leurs parents. Ce processus les conduit à ne pas se sentir légitimes sur le territoire qui les a vus naître. « Las de cette politique d’inimité à l’endroit des étrangers, certains y renoncent et intègrent leur label juridique : ils sont Anjouanais et resteront à jamais des surnuméraires à Mayotte », résume Nicolas Roinsard (2022 : 271).
11Prenons l’exemple de Farouk, adolescent français, né à Mayotte de parents comoriens en situation régulière. Il est le seul de sa famille à détenir ce statut considéré comme privilégié par son entourage. Alors que nous réalisions un entretien avec sa sœur aînée Mounira, il entre dans la pièce et la chahute en shimaoré (ou mahorais, l’une des langues parlées à Mayotte), s’amusant de l’entendre parler en français. Elle lui renvoie alors son statut de « Français avec la carte d’identité », associé pour elle à une image de « fainéant » car titulaire de droits dont il ne tire pas profit. De fait, le jeune garçon vient de terminer sa scolarité et n’entreprend pas activement de recherche d’emploi ou de formation. Il réplique alors, piqué au vif : « Je suis pas Français moi ! Je suis Comorien. » Ce débat sur l’affiliation nationale et les représentations associées aux identités revendiquées, ou reniées, fait émerger une hiérarchisation concurrentielle des statuts : sur les plans administratif et politique, être Français est un atout, alors que, sur le plan social et symbolique des valeurs, être Comorien prime.
12L’expression « français de papiers », utilisée par la population pour désigner les enfants devenus français par droit du sol, rappelle la difficile intégration des enfants issus de la migration. Le statut juridique et/ou administratif des Comoriens n’est pas synonyme d’intégration privilégiée : la naissance sur le sol mahorais ou l’accès à la nationalité française ne les rendent pas « Mahorais ». Cette distinction d’ordre socio-culturel rappelle l’une des singularités du contexte insulaire. L’exemple que fournit Naïssa, mère de famille mahoraise, illustre cette distinction :
« Un jour j’ai demandé à une dame réunionnaise qui ne savait pas faire la différence entre un Mahorais et un Comorien : ‘si un couple mahorais a un enfant à la Réunion, l’enfant sera Réunionnais ?’ ; ‘Non ! Jamais !’ Voilà, même chose avec ces enfants nés de parents comoriens à Mayotte, qui ne sont pas Mahorais. Eux qui sont fiers d’être Réunionnais, s’ils ont un enfant à Mayotte, ils ne vont pas dire qu’il est Mahorais ; ils dénigrent les Mahorais. Ils vont rester Réunionnais. Alors pourquoi eux ils ne resteraient pas Comoriens ? »
13Ce changement de niveau entre catégorie administrative et filiation culturelle renvoie à celui qui distingue identité mahoraise et identité administrative. La filiation insulaire culturelle et familiale semble transcender le lieu de naissance et la nationalité afférente. Nous retrouvons ce cloisonnement entre identité administrative et identité socio-culturelle chez les Comoriens naturalisés qui, devenus adultes, prennent la mesure des enjeux liés à leur statut de binationaux. Moinadjoumoi, naturalisée française après une scolarité compliquée par sa situation administrative, nourrit une forme de rancœur envers une société qui a freiné son insertion professionnelle : « moi je suis Anjouanaise. (…) je ne suis pas une Mahoraise, je suis Française. Je suis fière d’être Française parce que je suis intégrée. (…) Je ne suis pas Mahoraise, hamdoullah ! (rires) Sinon j’aurais été comme eux ! J’aurais eu une maladie d’être Mahoraise. » Dans le discours de Moinadjoumoi, l’identité mahoraise est dissociée de l’identité française, cette dernière étant pleinement investie alors que la première est repoussée pour être symboliquement le lieu du rejet. Comme la plupart de ses compatriotes binationaux, la jeune femme se positionne au carrefour entre sentiment d’appartenance légitime à la société et conscience d’une relégation fondée sur l’origine : elle contourne l’identité mahoraise pour s’inscrire d’emblée dans la citoyenneté française.
14Les bouleversements que connait Mayotte depuis environ trois décennies ont fragilisé le tissu social local, et la société peine à absorber ses nouveaux membres, politiquement illégitimes. Ce qui explique, comme le développe Denis Salas (1997 : 66) à propos de la délinquance juvénile en métropole, que, dans un monde fait de précarités où les identités ne sont plus soutenues par le lien social, pour beaucoup de jeunes, c’est l’assignation à un territoire qui tient lieu d’identité. L’écho de ces analyses dans le contexte de Mayotte nous amène à considérer la revendication de l’identité comorienne par les jeunes nés à Mayotte comme un processus né de l’assignation exogène au pays de leurs parents : pour les Mahorais, leur lieu de naissance, leur statut administratif et leur nationalité ne pèsent pas lourd face au poids de leurs origines familiales. Cette identification culturelle tient lieu d’ancrage territorial et procure une identité légitime et rassurante (filiation). Le sentiment d’appartenance national pour les enfants nés à Mayotte de parents Comoriens répond ainsi à des logiques de construction identitaire hétérogènes. L’acquisition de la nationalité française de plein droit et la possession d’une carte d’identité française ne revêt pas le même symbolisme chez tous les enfants de la « seconde génération ». Par conséquent, selon Denise Jodelet (1996), cette façon de s’identifier à un groupe plutôt qu’à un autre est tributaire du statut dont celui-ci jouit socialement.
Mayotte, territoire d’expérimentation postcolonial ?
15La « frontière de la nationalité » pèse lourd sur le devenir de ces jeunes et, en ce sens, Mayotte devient un « laboratoire où s’expérimentent des mesures de durcissement des frontières de la Nation » (Roinsard 2022 : 183), rappelant que les analyses d’Emmanuelle Saada (2007) sont toujours d’actualité : le sol colonial n’a pas les mêmes effets en matière de droits que le sol métropolitain, et les moyens mis en œuvre s’inscrivent dans la continuité des dispositions coloniales en matière d’articulation entre filiation et citoyenneté. En contraignant l’accès à la nationalité française des étrangers qui ne sont pas considérés dans le même rapport d’extranéité que ceux présents sur le sol métropolitain, nous assistons à l’édification de ce que l’auteur nomme : « un droit postcolonial » (Roissard 2022 : 188 et Saada 2007). Ainsi, sur le modèle de l’« enfant de la Nation » (Bonnet et al. 2012), l’État comme principal garant des droits ne place pas l’enfant au centre des politiques, élaborées au prisme d’une volonté de dissuasion migratoire. Dans ce contexte, il est permis de s’interroger : quelle(s) enfance(s) l’État contribue-t-il à créer ?
Bibliographie
Bonnet D., Rollet C., Suremain (de) Ch.-É. (eds.) 2012 Modèles d’enfances. Successions, transformations, croisements. Paris : Éditions des Archives Contemporaines.
Jodelet D. 1996 « Les processus psycho-sociaux de l’exclusion » (66-77), In S. Paugam (ed.) L’exclusion : l’état des savoirs. Paris : La Découverte.
Roinsard N. 2022 Une situation postcoloniale. Mayotte ou le gouvernement des marges. Paris : Éditions du CNRS.
Saada E. 2007 « Un droit postcolonial », Plein droit, 74(3) : 13-16.
Salas D. 1997 « La délinquance d’exclusion », Les cahiers de la sécurité intérieure 29 : 61-76.
Notes
1 Assemblée nationale, question écrite n°5551 : Statistiques sur les acquisitions de nationalité à Mayotte (https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-5551QE.htm)
2 Les inégalités de statuts entre les membres d’une fratrie de la même famille nucléaire sont à l’origine de ruptures parfois définitives lorsque les enfants laissés à Mayotte ne parviennent pas à régulariser leur situation et que leurs parents refont leur vie dans un autre département français.